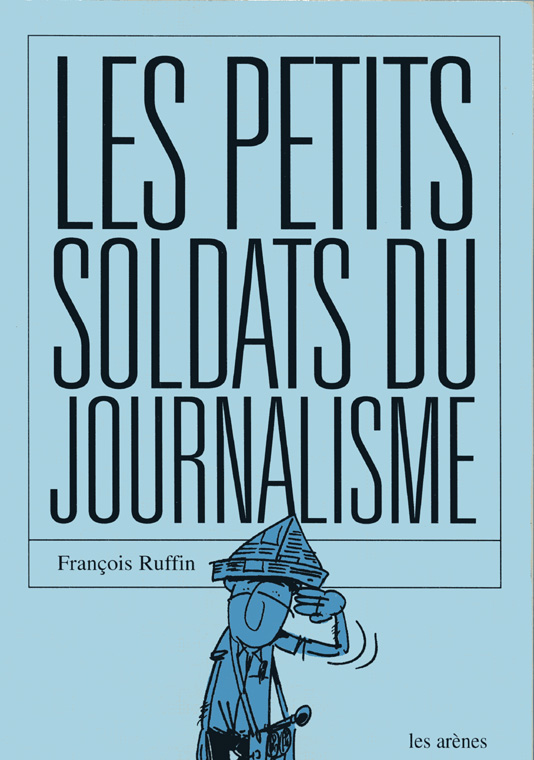
Vous avez comme tout le monde éprouvé ce profond vertige en regardant votre journal télévisé : égrenage de marronniers insignifiants, analyse d’un insupportable conformisme, absence d’esprit critique, et en prime le sourire patelin du lecteur de prompteur. Télécommande en main, vous changez dans la seconde de chaîne, et vous tombez sur le même sujet exactement, accompagné d’un commentaire similaire. Après une demi-heure de zapping frénétique, la situation ne fait que se confirmer.
La revue L’Etudiant assure en ces termes la promotion de ce centre de formation : « le CFJ est au journalisme ce que Sciences-Po est à l’administration : une école d’excellence ». La preuve en est qu’ « y sont passés : Pierre Lescure, PDG de Canal+, Laurent Joffrin, Directeur du Nouvel Observateur, B. Pivot, P. Gildas, PPDA, D. Pujadas, FOG, directeur du Point, G. Carreyrou, J.M Helvig, rédacteur en chef de Libération, G. Holtz.
La première condition de la soumission de nos journalistes est économique.
Notre auteur ne le comprend qu’avec les premiers stages qui le mettent en présence des gens de métier. Là, c’est la révélation. Page 197, quelques statistiques remettent les pendules à l’heure : « La précarisation de l’emploi s’accélère : + 51% de pigistes entre 1991 et 1999 ; un journaliste sur cinq. En 1993, seulement un étudiant sur quatre se voyait proposer une embauche au terme de son stage de fin de formation de l’une des plus prestigieuses écoles de journalisme. Un an après la sortie, 48% des anciens n’occupent toujours aucun poste fixe. »
Autrement dit, pour des fils et filles de petits bourgeois ayant accompli le rêve impossible de Papa Maman, c’est la désillusion. Ils pensaient rompre avec le train-train des classes moyennes d’où ils étaient issus, alors qu’à leur sortie de l’école, c’est la pauvreté qui les guette. « Le métier sert de déversoir pour les facs de Lettres, d’Histoire, de Sciences-po engorgées, ces filières n’offrant comme débouchés que la charge (jugée pantouflarde et peu valorisante) de professeur. » note Ruffin. Ou encore : « 54 enfants de profs, médecins, magistrats, ingénieurs, commerciaux,… rejetons des classes moyennes, pour qui se tourner vers le journalisme, c’est déjà une aventure. Plus artiste que l’enseignement. Plus bohême sauf exception que les métiers des parents. Le diplôme du CFJ rassure la famille et ouvre la porte à une ascension bien visible".
Sabine, boursière : « je suis consciente d’être une privilégiée. Pendant deux ans, je me suis battue pour arriver là. Ma mère vit seule, elle a fait des sacrifices pour que je rentre ici. Je suis passée par une prépa à Ipésup où j’ai laissé 7000 francs. »
Bref, nos lecteurs de prompteurs sont menacés par la précarité tout simplement, ce que note Pierre Bourdieu, dans cette incroyable formule (page 203) : « c’est une profession très puissante composée d’individus très fragiles ».
Pas de grèves à l’horizon, cependant, car nos élèves n’ont pas perdu l’espoir de réaliser leur rêve de gosse, être PPDA dans sa petite lucarne, avec son énorme salaire : « …un mirage que nos rencontres avec Joffrin, Génestar, Lescure, Plénel, ne dissipent pas : pour eux, la précarité n’existe pas. Ils ne la voient pas, étant assis dessus. »
Résumons : la fortune et la gloire pour les uns, le déclassement dans un total anonymat pour les autres. Cela explique peut-être certaines attitudes, comme celle expliquée par A. Accardo, dans journalistes précairesje parais sous mon meilleur jour, juste ce qu’il faut, pas un mot plus élevé qu’un autre, normal. Parce que, même quand on a du caractère, faut savoir niveler tout ça. Le CDD, il faut qu’il donne l’impression d’être bien dans cette rédaction, qu’il lance des sourire aux uns et aux autres, qu’il soit souple…Le profil type, c’est d’être gentil avec tout le monde (citée page 215) : « ».
Deuxième constat : la culture et le travail ne semblent pas être au cœur des préoccupations des formateurs.
On croyait l’avoir remarqué, mais cela va mieux en le disant : l’auteur cite, à la page 106, cette réflexion de B. Frappat, dans imprimatur, n°20, de février 1993 : « l’absence de recul historique, de connaissances juridiques, le manque d’épaisseur culturelle des journalistes sont des vices de la profession qu’on ne cite pas assez souvent ».
Choses vues (et entendues) au CFJ : « Jamais un permanent ne nous a conseillé la lecture d’un ouvrage » (page 96).
Pas de bibliothèque bien fournie, et peu d’enseignement général : « L’enseignement théorique survit à peine. Une heure d’histoire le lundi, une autre d’économie, 5 jours sur la justice et c’est tout pour la première année. Puis deux remarquables semaines en seconde année, l’une sur la géopolitique, l’autre sur les religions. Point.barre. »
Dominer son sujet ne semble pas indispensable pour en parler : « Lors d’un cours d’agence, le jargon financier s’étalait tout au long d’une dépêche. L’intervenante nous traduisait ces termes un à un, patiemment : actifs, compte d’exploitation, résultat brut, fonds de roulement… même en français, ces mots restaient pour nous de l’hébreu. En dix minutes, cette journaliste du Figaro tenta alors de délivrer des rudiments de comptabilité. Un survol. « Le mieux, bien sûr, serait qu’on vous enseigne ça sérieusement, concéda-t-elle. Mais ce n’est pas grave. Pour vous aider, vous aurez toujours les dossiers de presse des entreprises. Vous pourrez leur téléphoner pour qu’elles vous expliquent » (Page 97). » SIC !
L’hétérogénéité des cursus ne donne lieu à aucun cours complémentaire : « vous avez été accepté ici, donc on estime que vous avez un solide bagage. Inutile de revenir dessus. »
Il semble d’ailleurs que le vice soit chronique : « De fait, le quiz d’actualité constitue l’épreuve phare du concours d’entrée. (…) qui nécessite d’avoir fiché Libération ou Le Monde pendant 6 mois ».
Plus grave encore, on enseigne à ces jeunes gens le mépris du lectorat : « le lecteur type est non seulement semi-demeuré ( « ce n’est pas un imbécile, mais bon, il faut vous mettre à son niveau, en général très très bas ») mais également distrait (« n’oubliez jamais dans quelles conditions il vous lit : parfois dans le métro, avec du bruit, de l’agitation, des gens autour ou avec la télé qui marche… il dépasse rarement les premières lignes. Donc, on ne vous le répètera jamais assez : faites simple, très simple. Et super court aussi. » Dans ces conditions, à quoi bon en effet forcer son talent ?
Troisième leçon : pour formater nos futures grandes consciences médiatiques, il faut leur apprendre à obéir ; d’où un certain caporalisme infantilisant (page 191) : « Chaque matin, un enseignant fait l’appel. Rebelote l’après-midi ! Un cahier à signer circule deux fois par jour. Et le soir, lors des rencontres, une prof cache un trombinoscope sous son coude, dévisage les présents et relève les noms des tire-au-flanc qui ont profité de la pause pour s’éclipser. « Tous les cours, conférences et TP sont obligatoires » (règlement intérieur). »
Ils apprennent ensuite les rudiments de leur futur travail : la réflexion cède le pas à une continuelle effervescence collective : « premier rituel, qui marque un élève au fer rouge : la revue de presse matinale, ou de l’art d’être efficace les yeux collés. Toute l’année se succèdent une demi-douzaine de vaillants lève-tôt, sur le pont dès 6 heures pour concocter un savant digest de l’actualité. » (page174).
Les intervenants nous contraignent à une pratique machinale, quasi tayloriste.
Une litanie de réunions pour rythmer la journée : « 8 heures, première conférence de service, note une doctorante en visite au CFJ. 9 heures, première conférence de rédaction. 10 heures, deuxième conférence de service.14 heures, deuxième conférence de rédaction. 14h 30, troisième conférence de service.18 heures, troisième conférence de rédaction. Hors de ces mornes assemblées, on reste ici du matin au soir, sans rien écrire. On se tourne les pouces. On envoie des e-mails. » (P.177).
Extrait de la revue interne CFJ-notre journal : « tapotement constant sur les i-macs bleus disposés en arc ce cercle, courses poursuites à travers les étages, discussions animées autour d’un café serré, ponctuées de bruyants fous rires, projets d’articles, rêves futiles de vacances, un libé solidement accroché à la main…scènes de la vie ordinaire d’un étudiant du CFJ. » (page183).
L’apparence semble plus compter que la réalité. Ruffin recourt à nouveau à Alain Accardo, qui dans Journalistes précaires donne la parole à Pascal, un pigiste : « on ne travaille pas beaucoup dans les médias. On brasse beaucoup d’air, ou fait beaucoup de gestes, on prend beaucoup la pose, on s’agite beaucoup, mais on ne travaille pas beaucoup. »
Quatrième leçon : où prendre ses sources ?
L’information circule souvent en circuit fermé. Ainsi, à propos de l’affaire du sang contaminé : « Ces journalistes, les plus généralistes ou les plus politiques (éditorialistes) ont tendance, bien plus que les journalistes médicaux, à avoir comme source d’information principale les autres médias. Finalement, ils ne connaissent bien souvent l’affaire qu’à travers ce qu’en ont dit les confrères. C’est d’ailleurs ce qui explique que les erreurs des uns sont reprises par les autres. (…) Un discours évident, également, chez les éditorialistes qui, lors des débats, tranchent facilement des problèmes scientifiques complexes, déterminent les responsabilités » (page130). Cette situation a souvent pour cause le manque de travail ou l’inculture : « Le CFJ forme, justement, pour ce profil de généralistes. Issus de sciences-po ou de filières littéraires, nous ne possédons aucun savoir spécifique, juste une vague culture générale » (page132).
Et ces pratiques sont enseignées au CFJ : « Au lancement de l’hebdo (Combat, le journal interne au CFR), le responsable des secrétaires de rédaction nous encourageait et nous fixait un but : « les années précédentes, on a conçu des productions vraiment synchro avec les concurrents. On était sur la même actu que l’Express ou le Point. On n’avait rien manqué. J’espère que notre produit sera aussi performant cette fois-ci. » Ou encore : « Un rituel, en télé, témoigne de ce souci constant : pour préparer notre JT de 18 heures, le chef d’édition observe les 13 heures de TF1 et de France 2, garde un œil sur i-Télé et LCI, relève les différents sujets, note leur ordre d’apparition…que nous reproduirons fidèlement le soir même. » (page76).
L’approximation semble souvent la rançon de la promptitude à boucler : « En radio, Benoît chroniquait un ouvrage sur la guerre d’Algérie : - poursuis ton papier sur le livre de Jacques Duquesne, lui conseille une intervenante de France Culture. - Mais je ne l’ai pas ouvert. -Pas la peine il faut faire vite. Lis juste une critique du Monde. »
Au besoin, on apprend même à tricher carrément : pour construire un micro-trottoir concernant une enquête sur la circulation : « ne vous faites pas chier, dit la responsable, c’est un sujet où on peut tout faire en interne. (…) Pour les cyclistes on a interrogé Stan, un élève de l’école ; pour les scooters, j’ai téléphoné à une cousine –pas bavarde donc on a inventé le reste. Pour le métro c’est quelqu’un de la famille de David. Pour la photo, c’est une amie de la maquettiste. Pour la voiture, c’est notre responsable en personne qui nous a servi d’automobiliste bougon. En une heure tout était bouclé. » Certes, il s’agissait d’un exercice, mais est-on sûr que la pratique ne perdure pas ensuite, au sein d’une vraie rédaction ? Certains de ces fameux micro-trottoir du 20 heures sentent un peu le fabriqué.
Dernière remarque : qui paie ?
On sait que les grands journaux sont financés en majorité par la publicité. En somme, le lecteur achète des encarts publicitaires avec des articles à l’intérieur. Depuis les gratuits, il n’achète même plus rien du tout. De fait, son journal a une valeur identique à celle du dépliant publicitaire que le supermarché fait déposer dans sa boîte aux lettres.
Pour l’école, même tendance : « Depuis sa fondation, le Centre était gouverné paritairement. Une moitié de syndicalistes, une autre de patrons. Mais au printemps 98, dépôt de bilan…privatisation : aides (7 millions de francs) de Canal+, RMC, La Vie du Rail, TF1, Bayard Presse, F2, F3, Le Nouvel Observateur, Hachette, Havas. » Les généreux donateurs sont : « J.Seydoux (PDG de Pathé-Chargeurs et actionnaire de Libération), Vincent Lalu (dt de la vie du rail), Jean-Michel Bloch-Lainé (ex-pdt de la banque Worms), Pierre Feydel (directeur de l’Usine Nouvelle), Pierre Lescure (pdg alors de canal+, puis pdt du groupe CFPJ). »
Il en résulte une culture assez typée. Voici selon Ruffin un florilège de remarques recueillies au cours d’un séminaire de formation : « La part de marché des politiques, des médias, des soft-drinks, c’est pareil. » « Le seul critère, c’est le résultat, l’audience ou la vente. » « Mon patron déclarait : je suis un lessivier de la presse et je le revendique ». « Nous ne vendons pas des produits, nous vendons des audiences. » « On est dans l’univers de l’information, donc de la marchandise ». « Dans les médias, on est dans la même logique que le PDG de Procter. » « Le Monde est une marque et une marque très forte. » Une ex-responsable de la publicité au Monde déclare : « la France est un peu sous-développée sur le plan publicitaire, et c’est dommage. J’espère qu’elle va rattraper son retard, c’est la seule garantie réelle, profonde, d’une presse indépendante » (page136). « En sortant de cette école, vous pouvez écrire des articles dans la presse, mais c’est pas révolutionnaire. Ou alors, vous pouvez devenir manager et gérer un projet. Et là, il reste des segments de marché à investir » (page 139).
Voilà. Vous saurez peut-être un peu mieux pourquoi votre télé ou votre journal de province ressemblent à ce qu’ils sont. Finissons sur une note d’humour, en citant le discours de rentrée de la directrice du CFJ : « Bienvenue dans cette école de la liberté et du courage, dans cette école née de la Résistance, fondée à la Libération par Philippe Viannay et Jacques Richet…j’espère que vous saurez vous montrer dignes de ce lieu qui reste ancré sur ces valeurs citoyennes : l’éthique, la déontologie, la démocratie… » (page116).

