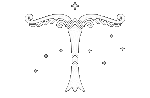Dans les relations d'État à État, l'expérience fournira toujours des leçons utiles pour les situations de crise d'envergure. C'est pratiquement la seule chose sur laquelle on peut compter, car il est incongru et même dangereux de relativiser le réalisme pour adopter des approches hautement conjecturales ou peu familières. C'est pourquoi l'éternel Niccolo Machiavel a dit (ou plutôt a prévenu) qu'il vaut mieux « chercher la vraie réalité des choses que leur simple imagination », et ne pas se référer aux « principautés qui sont gouvernées par une raison plus élevée que celle que l'esprit humain peut atteindre ».

Dans les relations internationales, il existe des cas où l'expérience a été omise. Par exemple, lorsque la Société des Nations a été créée après la Première Guerre mondiale, le mécanisme de sécurité collective était alors considéré comme la clé pour empêcher les pays de retomber dans la confrontation armée. Mais cela exigeait quelque chose que l'expérience historique ne soutenait pas: que tous les acteurs aient les mêmes intérêts et des perceptions identiques de la sécurité. Au départ, comme le fait remarquer à juste titre l'historienne Margaret MacMillan, la coopération internationale était prometteuse, mais plus tard, lorsque les intérêts ont commencé à se croiser et que l'Allemagne, avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, a œuvré diplomatiquement pour qu'il n'y ait pas d'affirmation définitive des frontières en Europe de l'Est, la coopération s'est affaiblie, a été remplacée par la politique de l'apaisement et le monde s'est dirigé vers des perturbations sans précédent.
Aujourd'hui, dans le monde incertain du XXIe siècle, les bonnes vieilles approches, pleines d'espoir quant à l'orientation des relations internationales, se sont effondrées, la pandémie a encore réduit l'espace de coopération entre les États, la méfiance et le nationalisme ont augmenté, et ces approches ténues qui tendent à considérer les diagonales entre les États, c'est-à-dire les équilibres nécessaires, même dans des contextes de forte rivalité, s'estompent.
C'est précisément dans cette perspective que les scénarios qui se dessinent d'ici 2030 ou 2040 offrent très peu de possibilités de consensus: tout au plus, une poursuite sans amélioration des relations entre la Chine et les Etats-Unis, centres entre lesquels une nouvelle bipolarité pourrait émerger avec des sphères d'influence peut-être plus flexibles. Mais il s'agirait d'une bipolarité plus grande et moins statique que celle connue au 20ème siècle, car la Chine pourra promouvoir des institutions et des biens publics d'une manière que l'Union soviétique ne pouvait pas, c'est-à-dire en créant des « sources douces » de pouvoir à partir de la place d'un pays qui a construit un pouvoir agrégé, c'est-à-dire non pas dans tous, mais dans plusieurs des segments du pouvoir international. Dans un tel monde binaire, les pays situés dans n'importe quelle géographie rejoindraient l'un ou l'autre bloc.
Mais des scénarios « moins stables » sont également envisagés, dans lesquels la concurrence et la rivalité, immuables dans les relations interétatiques, finissent par entraîner ces acteurs dans la confrontation. Il y a plusieurs théâtres potentiels ici, mais les experts estiment que la grande région Océan Indien-Océan Pacifique pourrait être la source d'une perturbation incontrôlable.

Certes, il s'agit d'une aire géopolitique où les acteurs pivots et les acteurs géostratégiques interagissent continuellement, c'est-à-dire que certains sont importants en raison de leur emplacement, mais d'autres projettent leur pouvoir à l'échelle régionale, continentale et mondiale.
Mais il existe une autre zone où la situation s'est sensiblement détériorée et où les querelles sont également en hausse: l'aire géopolitique de l'Europe de l'Est.
Dans cette région, plusieurs parties s'affrontent, mais elles peuvent être réduites à deux: l'Occident et la Russie. Ce qui est inquiétant dans cette nouvelle rivalité (et non cette « nouvelle guerre froide »), c'est qu'elle a pris un caractère de plus en plus irréductible, car vu l'état de la rivalité, il est très difficile d'envisager des stratégies de sortie de la part des acteurs concernés. Il existe encore des limites fragiles pour s'asseoir et discuter, mais elles s'estompent rapidement.
L'arrivée d'une administration démocrate rend la situation plus difficile, car Biden laisse entendre qu'il existe désormais un « front intérieur uni » aux États-Unis face à la Russie: Dans le passé, pendant la présidence de Trump, il y avait des approches au sein de l'exécutif qui visaient l'obtention d'une certaine détente avec la Russie, parce que si trop de pression était exercée sur la Russie, cela renforcerait non seulement le facteur nationaliste, anti-occidental, conservateur et même révisionniste en Russie, mais, en plus, le pays-continent pourrait se déplacer de plus en plus vers l'Asie, et même cultiver une plus grande coopération ou une concorde stratégique avec les acteurs de l'OTAN mécontents de l'attitude prise par l'Occident, par exemple, la Turquie.
Sous l'administration américaine actuelle, la stratégie initiée jadis sous Clinton est reprise: étendre l'OTAN indéfiniment. C'est une stratégie qui laisse la Russie, pour laquelle les républiques de Biélorussie, d'Ukraine et de Géorgie font partie de son « étranger proche » donc de ses intérêts vitaux, c'est-à-dire des intérêts pour lesquels la Russie ferait, si nécessaire, la guerre pour les préserver, tout comme les États-Unis, la Chine, l'Inde, la Turquie, etc., c'est-à-dire les grandes et moyennes puissances prééminentes par rapport aux zones adjacentes à leurs frontières. Aucun de ces centres de pouvoir ne pense et n'agit en termes de « pluralisme géopolitique », une catégorie qu'ils proclament à leurs rivaux, mais qui n'existe pas dans l'histoire des relations interétatiques.


Mais en Russie, le sens territorial, l'insécurité de se limiter à tant d'acteurs et le poids du passé la distinguent géopolitiquement des autres. Cette sensibilité était bien connue de l'expert américain George Kennan, un diplomate réaliste dont l'énorme connaissance de la Russie l'a conduit, outre à former le premier groupe de soviétologues, à soutenir, après la Seconde Guerre mondiale, et alors que les États-Unis jouissaient d'une suprématie militaire incontestée, que la nouvelle superpuissance ne devait pas être envahie mais contenue. Une stratégie d'encerclement vigilante devait être exercée depuis toutes les zones proches de sa frontière.
Kennan, qui est décédé en 2005 à l'âge de 101 ans, non seulement ne s'est jamais écarté de sa conception initiale, mais a également déconseillé à l'OTAN de s'approcher des « zones rouges géopolitiques » de la Russie.
Mais il y a longtemps que les États-Unis ont choisi d'ignorer ce grand expert, ainsi que d'autres ressortissants de stature stratégique égale. Elle l'a également fait en relation avec l'un des grands de la pensée militaire, Carl von Clausewitz, un Prussien qui, entre autres considérations affirmatives, mettait en garde contre le fait de dépasser les termes de la victoire au-delà de ce qui était souhaitable, car cela pourrait non seulement compromettre cette victoire, mais aussi créer une nouvelle grande instabilité internationale.

Le point de vue de Clausewitz était que la stratégie est vitale, mais qu'en fin de compte, c'est la politique qui doit prédominer. Les États-Unis n'ont pas toujours inversé les termes: par exemple, lors de la guerre du Golfe de 1991, l'objectif était de chasser l'Irak du Koweït, et non d'aller plus loin. Si la stratégie avait alors prévalu, les États-Unis n'auraient pas retenu leurs armées jusqu'à l'occupation de Bagdad (une décennie plus tard, la logique militaire l'emporterait, poussant l'Irak dans un état de fission et d'instabilité qui a fini par être « fonctionnelle » pour les puissances régionales ennemies des États-Unis).
Faisant fi de ces maximes stratégiques, les États-Unis semblent prêts à réaliser une « victoire II » contre la Russie : s'il y a 30 ans, ils ont vaincu l'URSS pendant la guerre froide, ils veulent aujourd'hui faire de même avec la Russie sous le commandement de Poutine.
Il s'agit d'aller au-delà de l'endiguement, en visant à affecter le « centre de gravité » de la Russie, c'est-à-dire ses intérêts vitaux et ses atouts territoriaux fondés sur la profondeur - sans doute une stratégie que le Suisse Antoine-Henri Jomini, autre grand penseur militaire du XIXe siècle, recommanderait contre une puissance avec laquelle il est en guerre.
L'Occident et la Russie ne sont pas en guerre. Il existe un dangereux état de discorde entre eux, mais il y a encore des ponts entre eux et la « culture stratégique » de l'époque bipolaire perdure. Mais si l'Occident persiste à ignorer les leçons de l'histoire, la « paix chaude » qui existe aujourd'hui pourrait rapidement laisser place à la première perturbation interétatique majeure du XXIe siècle.

Alberto Hutschenreuter
Alberto Hutschenreuter est titulaire d'un doctorat en relations internationales. Professeur à l'Institut national du service extérieur. Son dernier livre s'intitule Ni guerra ni paz, una ambigüedad inquietante, Editorial Almaluz, Buenos Aires, 2021.
Source : https://nomos.com.ar/2021/05/07/occidente-continua-desoyendo-a-clausewitz-y-a-kennan