
Pour évoquer Tara, la plantation de Scarlett O’Hara dans Autant en emporte le vent, Margaret Mitchell s’est inspirée de la propriété de ses arrière-grands-parents, « Fitzgerald Farm », dans le comté de Clayton, à une heure de route d’Atlanta.
Lorsque Margaret Mitchell était enfant, sa mère l’avait emmenée en promenade dans le comté de Clayton, lui faisant admirer les belles maisons à colonnes doriques qui avaient échappé à la fureur des Yankees. La petite fille imaginait alors les grandes fêtes qui s’y donnèrent, nourrissant ainsi, sans le savoir, l’imaginaire qui lui servira à écrire sa grande saga, son chef-d’œuvre.
Eléments essentiels de la résistance des Sudistes à l’avance nordiste, les marais de Clayton. C’est là – historiquement – que les populations confédérées se réfugièrent lors de l’avance yankee en Géorgie. C’est là – dans le livre – que Margaret Mitchell situe les pages les plus fortes de son roman-fleuve. Sachant que les Nordistes avaient ordre de pratiquer la politique de la terre brûlée, les Géorgiens partirent, avec leur bétail, se cacher dans les marécages et les bayous où les soudards de l’Union n’osèrent guère s’aventurer.
Atlanta est incendiée en 1864. En mai 1865, le Sud a cessé de se battre. Soixante-dix ans plus tard, Autant en emporte le vent viendra témoigner que The South Will Rise Again.
Margaret Mitchell est née en 1900. L’incendie d’Atlanta est encore vécu comme un traumatisme par les survivants. Elle n’oubliera jamais cette vision d’horreur qu’on lui raconte. Ce n’est pas seulement une ville qui disparaît dans les flammes. C’est un monde. Une manière d’être et de vivre. Quand Harold Latham, directeur littéraire et vice-président des éditions McMillan, reçoit de la part de Margaret Mitchell, en 1935, les vingt grosses enveloppes contenant des milliers de pages, il n’a jamais eu entre les mains un manuscrit aussi volumineux.
Descendu de New York en Géorgie, pour y découvrir de jeunes auteurs, il avait rencontré Margaret Mitchell. Comme il savait qu’elle avait écrit « quelque chose », il lui demanda de lui montrer son texte. Quand elle cède enfin, elle lui apporte dans le hall du Georgian Terrace Hotel, à Atlanta, les vingt enveloppes contenant les 63 chapitres d’Autant en emporte le vent. Et lui explique qu’elle l’a écrit de 1926 à 1929, tapant des premières heures du jour à la nuit sur sa Regmington portative. Bloquée chez elle par une entorse grave compliquée d’une arthrite, elle s’est amusée, sur les conseils de son mari, à raconter la vie et la mort de ce Sud qu’elle porte – et supporte – au plus profond de son cœur.
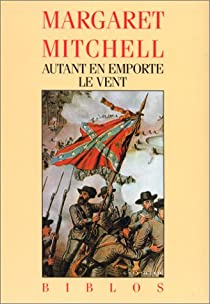
Margaret Mitchell a été bercée toute son enfance par des histoires d’honneur et de combats. En même temps qu’elle apprend à lire, elle apprend le nom des batailles. Elle connaît par cœur les chants confédérés – à commencer par l’hymne sudiste, I Wish I Was In Dixie – que sa mère lui chante le soir pour l’endormir. Le dimanche après-midi, elle écoute de toute son âme les vétérans raconter et raconter encore la bataille d’Atlanta.
Un jour qu’elle revient de l’école, elle déclare à sa mère :
– Je n’aime pas l’arithmétique, je ne retournerai pas à l’école.
Une déclaration péremptoire. Qui lui vaut d’abord une bonne fessée. Puis, ayant fait atteler une voiture, sa mère l’emmène en direction de Jonesboro, dans le comté de Clayton. Pour lui montrer d’abord une plantation ruinée.
– Regarde, autrefois des gens fortunés habitaient ici. Ils n’ont pas su faire face. Regarde cette maison au contraire. Elle se tient fière et droite comme ses occupants. N’oublie jamais ça. Le monde dans lequel vivaient ces gens était semblable au tien aujourd’hui. Ce monde s’est dérobé sous leurs pieds. Un jour viendra où le tien aussi se dérobera. Et que Dieu te protège si tu n’as pas une arme pour te défendre. L’éducation, voilà ton arme !
Margaret a compris la leçon. Elle s’accroche à l’école. Mais pas seulement. Un jour – comme Bonnie, la fille de Scarlett et de Rhett Butler – elle tombe de son cheval. Elle n’en mourra pas, comme Bonnie, mais elle sera grièvement blessée aux jambes. A peine guérie, elle remontera à cheval sans manifester la moindre peur.
Les personnages d’Autant en emporte le vent sont des personnages de fiction, bien sûr. Il n’empêche que ce jeune lieutenant, Clitford Henry, dont elle tombera amoureuse lors d’un bal, rappelle énormément Ashley Wilkes. Le lieutenant Henry sera tué en France pendant la Grande Guerre, juste avant l’armistice.
Après la mort de sa mère, victime d’une épidémie de grippe espagnole, elle interrompt ses études au Smith College (Massachusetts) et rentre à Atlanta s’occuper de son frère et de son père. Elle a 20 ans. Elle est menue – le tour de taille le plus minuscule de Géorgie – et jolie comme un cœur. Comme Scarlett ? Comme Scarlett.

Et comme Scarlett, Margaret fait quelque peu scandale dans la High Society d’Atlanta. Elle fume, boit des cocktails, lit tout ce qui lui tombe sous la main et danse le charleston. Et elle est très courtisée. Elle écrit à l’un de ses flirts : « Je réalise, à présent, que jamais je ne pourrai épouser aucun d’entre eux. Ce ne sont que des amis. Comprends-tu ? Pourtant, Al, je sais que mon bonheur est auprès d’un mari et d’enfants. Je ne crois pas beaucoup au bonheur. Mais mes meilleures chances de l’atteindre sont dans l’amour et je suis incapable d’aimer. »
Et pourtant… Pourtant elle rencontre bientôt Red Upshaw. Clitford Henry, c’était un peu le doux et mièvre Ashley Wilkes. Red Upshaw, rebelle, dandy, pas très « moral », c’est Rhett Buttler. Malgré l’opposition de son père, qui voit d’un sale œil ce séducteur patenté, elle épouse Red. Et ce qui devait arriver arriva. Lassé de cette vie routinière, Rhett – pardon, Red – abandonne Scarlett – pardon, Margaret. Une autre serait brisée. Pas Margaret. Comme Scarlett, elle fait face. Et devient l’un des journalistes-vedettes de l’Atlanta Journal.
Le 4 juillet 1925, elle épouse John Marsh. Il n’a pas la séduction de Red Upshaw. Mais il est tendre et attentionné. Le couple s’installe dans un appartement de Crescent Avenue. C’est là qu’elle commencera d’écrire Autant en emporte le vent. Avec l’aide de John qui, dès qu’un chapitre est terminé, le lit et suggère quelques corrections. Peu sûre de son talent, elle confiera à l’un de ses amis, Franklin, à quelques semaines de la parution du livre :
— Si mon roman se vend à mille exemplaires, j’en serai satisfaite.
Le livre terminé, elle l’enferme dans un tiroir. Il va y dormir six ans. Jusqu’à ce que Harold Latham, des éditions McMillan, lui force la main comme nous le racontons plus haut.
Le livre paru, la vie de Margaret devient un tourbillon. Personnage public, elle n’aspire cependant qu’à une vie retirée et paisible. Elle explique :
— Mon livre appartient à quiconque a les moyens de l’acheter. Mais rien de ce qui est à moi n’appartient au public.
Elle ne supporte pas les interviews répétitives, les coups de téléphone incessants (un toutes les trois minutes), les déluges de télégrammes (un toutes les sept minutes). Mais elle ne peut guère échapper à sa gloire. Auteur mythique, elle a donné aux Sudistes le livre qui les venge de toutes les humiliations que les Yankees leur ont fait subir. Et le film, le grand film de Victor Fleming, fera le reste. Comme les vétérans sudistes après la reddition des Etats confédérés, Margaret Mitchell pouvait dire : « Ils se sont peut-être rendus. Pas moi… »
« Gone With The Wind »
Scarlett O’Hara… Cette petite chose précieuse, raffinée, se révèle dans l’épreuve une digne héritière des pionnières et de ses ancêtres irlandais. Face à l’envahisseur yankee, les élégants cavaliers s’étaient transformés en guerriers redoutables. Scarlett, elle, défendra bec et ongles sa terre contre les carpetbaggers et les scalawags.

Gone with the Wind… Mille pages. Un film de 222 minutes pour un budget de 3 700 000 dollars, 59 rôles principaux. Un fantastique succès qui allait battre, dès sa présentation publique le 15 décembre 1939 au Grand Théâtre d’Atlanta, tous les records de recettes et rester en tête du box-office pendant plus de vingt ans.
Dès la lecture du roman, David O. Selznick, directeur de la toute jeune Selznick International Pictures, décida que Clark Gable était fait pour le rôle de Rhett Butler. Mais à qui confier le rôle de Scarlett O’Hara ? Bette Davis ? La Warner Bros, qui l’avait sous contrat, était prête à assurer la distribution du film et son financement. En échange de 25 % des recettes et l’engagement du couple Bette Davis-Errol Flynn.
Tallulah Bankhead ? Elle avait pour elle d’être une vraie fille du Sud. Contre elle, son âge. Katharine Hepburn ? « Pas assez de sex-appeal », trancha Selznick. Le public se passionna pour cette quête, pariant tour à tour sur Lucille Ball, Myriam Hopkins et Norma Shearer, une « vieille » de 37 ans… On retint même un temps Paulette Godard qui fut envoyée dans le Sud pour perfectionner son accent.
Et puis vint Vivian Leigh. Pour en arriver là, Selznick avait interviewé 1 400 candidates et 90 d’entre elles avaient tourné un bout d’essai… Le tournage proprement dit commença le 26 janvier 1939. Les équipes travaillaient 16 heures par jour et 6 jours par semaine. Les agences durent pour le tournage de la scène située dans la gare d’Atlanta, fournir 2 500 figurants en moins de 24 heures. Elles en furent incapables et il fallut recourir à l’utilisation de 1 000 mannequins pour figurer les blessés.

La « première » du film se déroula à Atlanta, ville martyre. Dans une ambiance surchauffée. Le gouverneur de l’Etat de Géorgie avait déclaré le 15 décembre 1939 jour férié et le maire de la ville avait prévu trois jours de festivités. Les billets vendus un dollar et demi se revendirent plus de 200 dollars au marché noir.
En 1940, Autant en emporte le vent obtenait dix oscars pour : le meilleur film ; la meilleure actrice (Vivian Leigh) ; le meilleur second rôle (Hathie McDaniel, « Mamma ») ; le meilleur metteur en scène ; le meilleur directeur de la photographie ; le meilleur scénario ; mention spéciale pour la couleur (une nouveauté en 39) ; la meilleure direction artistique ; les meilleurs effets spéciaux ; le meilleur montage.
Avec son roman, Margaret Mitchell avait donné au Sud son Iliade. Avec le film, Selznick l’inscrivait dans la légende des Siècles.
A. Sanders
