
Copie d'après Jan van Huchtenburgh (Haarlem 1647-Amsterdam 1733) - La Bataille de Malplaquet, 1709
Malplaquet est une défaite militaire de Louis XIV que celui-ci parvient à retourner en victoire. Clément Oury revient sur les conséquences de cette bataille et pourquoi elle est importante pour la France.
Clément Oury est conservateur des bibliothèques, archiviste paléographe (prom. 2005) et docteur en histoire de l’université Paris IV (2011). Sa thèse, menée sous la direction d’Olivier Chaline, est consacrée aux Défaites françaises de la guerre de Succession d’Espagne (1704-1708).
Entretien réalisé par Anne de Bongain.
Qu’est-ce qui vous a motivé à écrire sur la bataille de Malplaquet et son impact sur le règne de Louis XIV ?
Ce sont les éditions Perrin et le directeur de la collection « Champs de bataille », Jean Lopez, qui m’ont proposé de travailler sur cette bataille. J’ai immédiatement dit oui : je connaissais bien le sujet, puisque mon doctorat d’histoire portait sur la guerre de Succession d’Espagne (1701-1714, soit la fin du règne de Louis XIV) ; et plus spécifiquement sur les défaites subies par les Français durant la catastrophique période 1704-1708, où ils sont battus sur tous les fronts.
Un ouvrage sur Malplaquet (11 septembre 1709) me permettait, dans la lignée de mes travaux précédents, de mettre l’événement-bataille au cœur de l’étude historique : le contexte dans lequel elle s’inscrit, son déroulement et son schéma tactique, pourquoi et comment les soldats combattent, ses conséquences militaires et diplomatiques, et enfin la mémoire de la bataille. Et quel meilleur objet d’étude que Malplaquet ? C’est la bataille la plus importante de toute la guerre, et l’une des plus féroces de l’Ancien Régime, que ce soit du point de vue des enjeux, des effectifs (il y a plus de troupes qu’à Austerlitz ou Waterloo), ou de l’ampleur des pertes. Tous ceux qui y ont participé reconnaissent qu’ils n’ont jamais vécu un tel combat.
Comment avez-vous abordé la recherche pour ce livre, notamment en ce qui concerne l’accès aux archives des différents pays belligérants ?
Mon objectif était de m’appuyer sur les témoignages et les sources les plus diversifiés possibles. En effet, on retrouve à Malplaquet des soldats de toute l’Europe, ou presque, puisque la « Grande Alliance » réunie contre Louis XIV réunit une dizaine d’États différents. Il me semblait essentiel de prendre en compte tous les points de vue, à rebours d’une histoire militaire qui s’intéresse trop souvent à une seule nation – généralement celle de l’auteur de l’ouvrage. Je voulais aussi dépasser l’étude de la bataille telle qu’elle peut être perçue par les généraux, pour m’intéresser à l’expérience de tous les types de combattants, sans oublier les nombreux civils qui accompagnent les armées. Je me suis donc appuyé sur des archives et correspondances conservées à Londres, La Haye, Vienne, Copenhague, Berlin, Dresde ou bien entendu Paris ; et j’ai utilisé aussi bien les mémoires du maréchal de Villars que ceux d’officiers régimentaires, voire de simples soldats. Enfin, je ne me suis pas contenté des récits et des témoignages : je les ai croisés avec des sources plus administratives, comme les rapports des intendants d’armée (chargés de la logistique) qui décrivent par exemple l’état matériel des troupes ou la situation des hôpitaux après la bataille.
Vous mentionnez que la défaite de Malplaquet a permis à Louis XIV de conserver les principales conquêtes de son règne. Pouvez-vous développer cette idée ?
Il suffit de rappeler le contexte. Au début de l’année 1709, des négociations de paix se déroulent à La Haye. Louis XIV, bien conscient de la situation dramatique de son royaume, est prêt à des concessions douloureuses : il est résolu à abandonner toutes les conquêtes qu’il a réalisées sur les frontières nord et est de la France, dont Lille et l’essentiel de l’Alsace. Il accepte aussi que son petit-fils, Philippe V, renonce au trône d’Espagne qui lui avait été légué par le testament du précédent roi. Mais les Alliés ajoutent au dernier moment une clause inacceptable : ils veulent que les troupes françaises se chargent d’aller chasser Philippe V de Madrid, et donc que Louis XIV se retourne contre son propre petit-fils ! Cette dernière exigence fait avorter les négociations.
On peut raisonnablement penser que, si Malplaquet avait abouti à un désastre pour les armées françaises, le roi aurait été forcé de boire la potion amère que lui réservaient les Alliés. Mais l’issue indécise de la bataille permet aux Français de tenir quelques années supplémentaires, et d’engager des pourparlers séparés avec un des membres de l’Alliance, la Grande Bretagne. Ce retournement, qui n’aurait pas été possible sans Malplaquet, permet d’obtenir une paix de compromis puisque la France conserve les conquêtes de Louis XIV et que Philippe V reste roi d’Espagne, même s’il perd quelques pans de son empire.
La bataille de Malplaquet est souvent perçue comme une défaite pour la France. Quelles nuances apportez-vous à cette vision traditionnelle ?
Il faut d’abord le reconnaître : la bataille de Malplaquet est, au plan tactique comme à l’échelle de la campagne, une défaite. À l’issue du combat, les troupes françaises, qui étaient pourtant solidement retranchées, ont été chassées du champ de bataille par des Alliés supérieurs en nombre. Ceux-ci sont ensuite libres de faire le siège de Mons, la forteresse que les Français voulaient protéger. Les généraux français eux-mêmes, dans leurs lettres à Louis XIV, admettent qu’ils ont été battus.
Et pourtant ! Cette défaite a toute la saveur d’une victoire. Si les Français ont été repoussées, les Alliés ont subi des pertes très supérieures. La place de Mons, que les Alliés finissent par prendre, n’a pas une importance stratégique majeure. Contre toute attente, malgré leur misère et leur infériorité numérique, les troupes de Louis XIV se sont retirées en bon ordre. Plus important encore : alors que les Français se réjouissent, le doute gagne le camp adverse. Les Alliés s’imaginaient que la campagne serait facile. Ils doivent déchanter, comprenant que la guerre peut se poursuivre encore longtemps. Mais sont-ils toujours prêts à en payer le coût ?
En vous appuyant sur les points de vue des combattants, du général au soldat, comment avez-vous réussi à restituer la dimension humaine et tragique de cette bataille ?
En restant fidèle aux sources. Les batailles de l’Ancien Régime sont, c’est vrai, moins bien documentée que celles de la Révolution et surtout de l’Empire. Et pourtant, pour qui sait chercher, les éléments ne manquent pas. J’ai ainsi retrouvé une soixantaine de témoignages, griffonnés au soir de la bataille ou publiés dans des Mémoires plusieurs décennies plus tard. Les propos des généraux en chef sont un peu désincarnés et se contentent de décrire le schéma tactique de la bataille. Mais dès qu’on lit les récits des officiers, on se retrouve plongé au cœur des combats. J’ai ainsi pu décrire comment s’affrontent deux bataillons d’infanterie qui se tirent dessus, en rase campagne, à courte distance, ou étudier le fonctionnement d’une charge de cavalerie – qui n’a pas grand-chose à voir avec l’image romantique d’une horde de centaures au galop que nous a léguée le cinéma.
J’étudie aussi la perception du combattant : ce qu’il voit – ou ne voit pas, le champ de bataille étant vite recouvert de fumée –, ce qu’il entend, et autant que possible, ce qu’il ressent. C’est une des questions qui m’a tenu à cœur : pourquoi, dans des circonstances épouvantables, des soldats tiennent leur position : par peur des sanctions ? par patriotisme ? par solidarité avec les camarades ? Il y a en fait un peu de tout cela, mais dans des proportions qui ne sont pas simples à évaluer.
Dans votre livre, vous évoquez le Grand Hiver de 1709. Quel rôle a joué cet événement climatique dans le contexte militaire de l’époque ?
On ne saurait exagérer ce qu’a été le Grand Hiver. En une nuit de janvier, sur l’ensemble du territoire ou presque, la température chute de 20 degrés. La Seine, la Garonne, le Rhône sont pris dans les glaces, et à Versailles, le vin gèle dans les carafes. Pire encore : il y a pendant plusieurs semaines une série de gels et de dégels qui détruit la totalité des récoltes du royaume. La famine qui s’ensuit fait, sur les deux années 1709 et 1710, plus de 600 000 victimes. Ce phénomène climatique exceptionnel concerne toute l’Europe, mais c’est la France qui est la plus touchée. Le pire est qu’elle ne peut pas importer de grains depuis des régions plus éloignées, car les marines anglaises et hollandaises bloquent tout convoi venant de la Méditerranée ou de la Baltique. Cette situation, dans un pays financièrement épuisé par la guerre, est explosive, et les émeutes se multiplient à Paris comme dans les provinces.
Le Grand Hiver a pourtant, si l’on ose dire, quelques effets positifs. Ceux qui n’ont plus rien s’engagent pour manger – l’armée est encore ravitaillée tant bien que mal. Le manque d’herbe pour les chevaux retarde la mobilisation des forces adverses, faisant gagner quelques précieuses semaines de répit aux Français. Surtout, signe de la solidité du système politique louis-quatorzien, cette série de crises – militaire, climatique, politique – ne dégénère pas en révolte générale. Au début de l’année 1709, les Alliés étaient convaincus que la France était au bord du gouffre et que ce « royaume croulant » (selon les mots du premier ministre britannique) allait vite s’effondrer. Sa résistance inattendue démontre aux Alliés que la population française n’est pas, comme ils le pensaient, massivement hostile au régime, en tous cas pas au point de prêter main-forte à ses ennemis.
Le maréchal de Villars est une figure centrale de votre ouvrage. Quelles qualités ou stratégies ont fait de lui un leader efficace malgré les circonstances difficiles ?
Ses meilleures qualités, ce sont encore ses défauts ! Je m’explique : Villars est incontestablement un bon général. Encore peu connu au début de la guerre, il montre rapidement de grandes qualités : il est vif, audacieux, manœuvrier, et fait toujours preuve d’un grand courage physique, en n’hésitant pas à monter lui-même en première ligne. Mais jusqu’en 1709, il n’a commandé que sur des fronts secondaires, et il fait pâle figure par rapport à ses deux adversaires, le duc de Marlborough et le prince Eugène, considérés, à raison, comme les meilleurs généraux de leur temps. Si Villars est nommé, en 1709, à la tête de la principale armée française, c’est d’abord parce que tous les autres chefs français ont été étrillés par ce redoutable duo.
Mais Villars sait, mieux que quiconque, présenter la moindre de ses réussites sous des traits éclatant. C’est un courtisan et un communicant remarquable, jamais avare d’une exagération. La vanité de Villars peut être jugée horripilante, mais son assurance conforte le soldat. La mauvaise foi du maréchal permet de réaliser un miracle : alors qu’il est dans une position strictement défensive, il arrive à donner l’impression que c’est lui qui brûle d’en découdre. Aussi forcé soit-il, l’aplomb de Villars permet de sortir l’armée française de son défaitisme.
Comment la bataille de Malplaquet a-t-elle influencé le moral des troupes françaises et la perception de la guerre au sein du royaume ?
Au soir de la bataille, la situation est encore un peu confuse. Villars, en effet, a été blessé, et l’armée a été confiée au maréchal de Boufflers. La première réaction de celui-ci est d’écrire au roi que la bataille est perdue. Mais rapidement, dans les deux camps, on fait ses comptes, et on s’aperçoit que la victoire alliée a été chèrement payée. C’est alors que s’engage une seconde bataille, d’opinion celle-là. Boufflers écrit à Louis XIV de nouvelles lettres, où il parle de la gloire que s’est acquise l’armée française. Les journaux français les publient, pour démontrer qu’à défaut du champ de bataille, l’honneur de la journée leur revient. Parallèlement, la presse des Alliés s’efforce de vanter le courage de leurs propres soldats…
Mais au fil des jours et des semaines, c’est les Français qui sortent gagnants de ce nouvel affrontement. Signe qui ne manque pas, la bourse de Londres dévisse ! Cela entraîne un véritable retournement de l’opinion publique britannique qui mène, l’année suivante, à un renversement politique. Le camp favorable à une paix rapide gagne les élections au Parlement de Londres, et le nouveau gouvernement entame des négociations secrètes et séparées avec la France.
Votre livre s’appuie sur une analyse approfondie des archives. Quelles découvertes vous ont le plus surpris ou apporté de nouvelles perspectives sur cet événement historique ?
J’ai d’abord découvert des archives inédites, venant du camp allié, qui éclairent d’un jour nouveau les relations entre les différentes composantes de la Grande Alliance. On constate d’abord un effondrement rapide du moral, dès les lendemains de la bataille. Chacun se renvoie la responsabilité des pertes : les Hollandais accusent les Hanovriens de ne pas les avoir aidés, les Prussiens se méfient des Autrichiens… Dans ces conditions, on comprend que la victoire alliée ait un goût amer.
Je me suis aussi posé la question du rôle du sentiment national dans la résistance inattendue des Français. 1709 est une année très particulière : en juin, alors que les négociations viennent d’être rompues avec les Alliés, Louis XIV décide pour la première fois d’écrire une lettre à l’ensemble des Français pour leur expliquer le sens de la lutte et sa décision de continuer le combat. Pour un roi absolu qui n’est responsable que devant Dieu, c’est une démarche inouïe ! Les généraux français, quant à eux, n’hésitent pas à parler de « défense de la patrie ». On assiste en fait au début d’un mouvement qui dure tout le long du xviiie siècle, jusqu’à la Révolution : l’armée est déjà une armée nationale (un Français sur dix en âge de porter les armes est appelé à servir) et commence, progressivement, à devenir l’armée de la nation.
Enfin, quel message espérez-vous transmettre à vos lecteurs à travers l’étude de cette bataille et de ses conséquences pour la France du XVIIIᵉ siècle ?
De mon point de vue, un historien n’est pas là pour transmettre un message, mais pour présenter et décrire un phénomène historique, en s’efforçant d’être le plus objectif possible, et pour proposer quelques pistes de compréhension, d’analyse et d’interprétation. Après, libre à chacun d’en tirer ses propres leçons !
À mes yeux en tous cas, Malplaquet représente, au-delà de l’épouvantable tragédie qu’elle constitue, une forme de leçon sur la résistance et la résilience. Au début de l’année 1709, tous les ingrédients sont réunis pour aboutir à la catastrophe : un pays affamé, un système politique en crise, une armée aux abois, un ennemi apparemment invincible et en tous cas invaincu. Quelques mois plus tard, après la bataille, la situation militaire ne s’est guère améliorée mais un espoir est né. Ne pas s’avouer battu, refuser la défaite, peut offrir un chemin vers le succès ou en tous cas vers une solution de compromis. Et c’est aussi l’exemple de la supériorité qu’a parfois la plume sur les armes : vainqueurs sur le champ de bataille, les Alliés finissent par être vaincus dans le combat qui se joue devant l’opinion publique de toute l’Europe !
Source : Revue Conflits - 19 janvier 2025
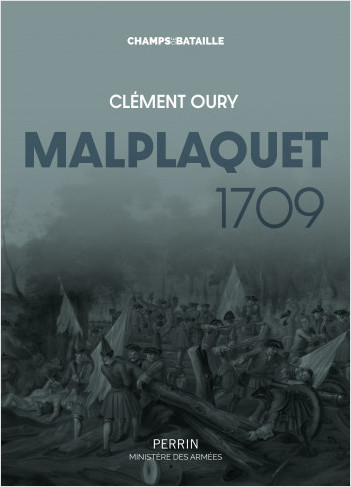
Malplaquet 1709 – La défaite qui sauve le royaume, Perrin, 2024, 25 €
