
I. — Les Indo-Européens.
Au cours du troisième et du second millénaires avant Jésus-Christ se produisit l'événement le plus important de l'histoire temporelle récente de l'humanité : d'une région qu'on semble pouvoir situer entre la plaine hongroise et la Baltique, par vagues successives, partirent en tous sens des troupes conquérantes qui parlaient sensiblement la même langue. Que s'était-il passé? Désagrégation d'empires préhistoriques? Difficultés alimentaires ou climatériques? Impérialisme inné, appel confus du destin, maturation plantureuse d'un groupe humain privilégié? Nous n'en saurons jamais rien. Mais le fait est là : des courses centrifuges, en quelques siècles, asservissent à ces hardis cavaliers toute l'Europe du Nord, de l'Ouest, du Sud et du Sud-Est; les anciens habitants disparaissent, s'assimilent ou forment des îlots qui se résorbent lentement et dont il ne subsiste aujourd'hui que le « témoin » basque, au bout des Pyrénées, et, dans le Caucase, de petits peuples très originaux. En Asie centrale, quelques-uns poussent jusqu'au Turkestan, où leurs royaumes tiendront encore près de dix siècles après le début de notre ère, malgré la pression chinoise, malgré les remous des Turcs et des Mongols. Certains, très tôt, et d'autres après eux, se ruent sur l'Asie antérieure; d'autres occupent l'Iran, cheminent jusqu'à l'Inde : mille ans avant Jésus-Christ, ils sont dans le Pendjab et déjà regardent le Gange où les Grecs du temps d'Alexandre les trouveront installés.
Par référence à l'aire ainsi couverte, le peuple inconnu d'où se sont détachés tant de rameaux a reçu des savants modernes un nom composé, purement symbolique, qui parle à l'esprit plus qu'à l'imagination : ce sont les Indo~ Européens.
Leurs chevauchées victorieuses n'échappent pas complètement à l'observation, du moins vers leurs points d'arrivée : dans tout le Proche Orient, les nouveaux venus côtoient, heurtent et parfois soumettent de vieilles sociétés très civilisées, qui tenaient depuis longtemps leurs annales et dont les inscriptions signalent l'ouragan. Les conquérants eux-mêmes adoptent en partie les usages et les commodités des vaincus ou des voisins et se mettent à graver : entre la mer Noire et la Syrie, nous connaissons maintenant et nous lisons les archives cunéiformes des rois hittites, maîtres d'un de ces empires du second millénaire avant notre ère. Mais un fait domine tout le détail : partout où on les voit s'installer, ces armées ont perdu la liaison avec les corps qui opèrent dans d'autres régions, même proches. A plus forte raison ne reconnaissent-elles pas pour parents ceux qui, par une randonnée antérieure, ont déjà foulé le sol où elles se fixent. Les langues se différencient. L'histoire, les mythes, les cultes se localisent. Les mœurs évoluent. Bref, nul sentiment ne survit de la communauté d'origine et les envahisseurs successifs bousculent indifféremment leurs plus intimes cousins et les autochtones les plus étranges. Plus tard, ça et là, quand les philosophes athéniens ou les grammairiens de Rome réfléchiront, ils admireront bien, par exemple, que le chien et l'eau portent presque le même nom en phrygien et en grec, ou que tant de mots latins sonnent si près des mots grecs de même sens : ils n'en concluront rien, sinon à l'emprunt ou à la constance de la machine humaine.
Et le jeu continue, cette fois en pleine lumière : les Germains submergent l'empire romain et donnent à l'Europe une nouvelle figure. Des flottes vont soumettre l'Afrique et l'Inde, les nouveaux mondes de l'Orient et de l'Occident, les îles des mers lointaines. Des colons sans scrupule dépeuplent en hâte et repeuplent une partie des Amériques, toute l'Australie. Après des succès éphémères, les concurrents arabes et turco-mongols sont éliminés : Alger, Le Caire, Bagdad tombent en vassalité, la Sibérie s'exprime en russe. Hormis quelques rares allogènes — Finnois, Hongrois, Turcs ottomans — qui ont su se faire admettre et comme naturaliser sans perdre leur langue, l'Europe « parle indo-européen » et, par ses émigrants, fait « parler indo-européen » à tout ce qui compte dans trois autres continents et dans la moitié du quatrième. Aujourd'hui, au delà de luttes fratricides qui sont peut-être le dur enfantement d'un ordre stable, on ne voit sur la planète qu'un coin de terre où pût grandir un appelant contre ce triomphe. Mais sans doute arriverait-il trop tard.
Pour toutes sortes de raisons qui tiennent aux conditions internes et externes du développement de la science, ce n'est qu'au début du XIXe siècle que les grammairiens occidentaux découvrirent ce fait capital que le sanscrit de l'Inde et les langues de l'Iran, le grec, le latin, les langues germaniques, les langues celtiques, les langues slaves et baltiques, ne sont que des formes prises, au cours d'évolutions divergentes, par un seul et même parler préhistorique qui se définit par rapport à elles comme le latin par rapport à l'italien, au français, à l'espagnol, au portugais, etc. La notion de « langues indo-européennes » était née. Un siècle d'admirable travail, auquel toutes les universités d'Europe ont collaboré, a permis de la préciser et de la nuancer, et l'on s,e fait aujourd'hui une idée nette de ce qu'était « l'indo-européen commun », au moment des grandes migrations qui l'ont brisé. Les recherches les plus récentes font même entrevoir par quelle évolution antérieure la langue commune avait atteint cet état final dont nos langues modernes sont des modifications diverses.
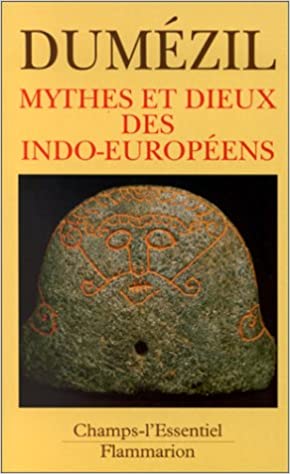
II— La religion des Indo-Européens.
L'unité de langue ne suppose pas forcément l'unité politique; elle suppose en tout cas une sensible unité de civilisation : qu'on songe à la Grèce d'avant Alexandre, qui n'a jamais formé un Etat, mais qui, malgré les différences de dialectes et de mœurs, a eu constamment conscience et volonté de « parler grec », de « vivre grec ». Il est certain que les hommes qui s'exprimaient dans la langue indoeuropéenne avaient en commun un minimum de civilisation matérielle et morale. Il est légitime, en particulier, de parler de « la religion indo-européenne », étant bien entendu que cette unité n'impliquait pas l'uniformité et que chaque canton, comme plus tard chaque vallée grecque, chaque cité du Latium, chaque fjord norvégien, colorait à sa façon le bien commun.
Vers le milieu du XIXe siècle, avec un bel enthousiasme, les savants s'efforcèrent donc de reconstituer comparativement, en même temps que la langue, la religion des Indo-Européens et surtout ce qu'on regardait alors comme la partie essentielle de toute religion, la mythologie. L'entreprise était prématurée et elle a échoué. Les philologues et les linguistes qui s'y dévouaient ne disposaient pas encore de cette nouvelle connaissance de l'homme, de cet humanisme élargi et rajeuni qu'a constitué, lentement d'abord puis à un rythme et à un débit vertigineux, l'exploration méthodique des diverses branches de notre espèce. La situation est bien meilleure aujourd'hui : l'ethnographie et l'anthropologie ont permis d'observer, toutes vives, les formes que revêt la religion dans des sociétés de civilisation comparable, pour le niveau et pour les éléments, à celle des Indo-Européens; d'autre part, la psychologie et la sociologie ont éclairé le mécanisme interne de ces paganismes, leurs conditions d'équilibre, les fonctions qu'ils assurent, les évolutions qui les attendent. On s'est donc remis au travail depuis une vingtaine d'années, en France et en Allemagne surtout, et aussi en Suède, en Hollande, en Belgique, mais en se gardant des deux illusions du début. On ne croit plus que les Indo-Européens aient été des « primitifs »; on sait que ni leur civilisation ni leur langue ne permettent d'atteindre un « début », un zéro absolu; que l'une et l'autre portent au contraire la marque, la charge et le fruit d'un riche passé dans lequel notre vue ne peut guère remonter. D'autre part, on ne croit plus que les mythes soient d'ingénieux et vains symboles imaginés de toutes pièces par des chantres pour exprimer leur admiration devant les spectacles de la nature, ni les jeux de mots plus ou moins conscients de philologues préhistoriques; aux mythes solaires, aux mythes d'orage, aux « épithètes personnifiées » et autres produits des « maladies du langage», on fait aujourd'hui leur juste part, qui n'est pas grande; on sait qu'une religion suppose, exprime, règle et coordonne des besoins et des efforts bien plus complexes.
III. — Mythes, rites, religion, société.
Réservant à la philosophie l'origine et l'essence des religions, et à s'en tenir à l'observation extérieure, on peut poser comme acquis les définitions et les principes suivants :
1° Un mythe est un récit que les usagers sentent dans un rapport habituel, d'ailleurs quelconque, avec une observance positive ou négative ou un comportement régulier ou une conception directrice de la vie religieuse d'une société. Loin donc d'être des inventions désintéressées, ou même des inventions libres de l'imagination, les mythes ne sont pas séparables de l'ensemble de la vie sociale : ils expliquent, illustrent, et protègent contre la négligence ou l'hostilité, des liturgies, des techniques, des institutions, des classifications, des hiérarchies, des spécialisations du travail commun, du maintien desquelles sont censés dépendre le bien-être, Tordre, la puissance de la collectivité et de ses membres. Il est donc impossible d'étudier les mythes sans étudier les formes de l'activité magico-religieuse, politico-religieuse, économico-religieuse, etc., des sociétés considérées. En particulier, chaque fois qu'un récit apparaîtra en liaison constante avec un rituel, on devra examiner si cette liaison n'est pas essentielle : elle l'est le plus souvent, et du même coup on saura quel était, pour les usagers, le sens principal de ce récit, de ce mythe.
Le mythe reste donc, autrement qu'on ne le croyait il y a un siècle, le phénomène religieux supérieur, qui donne aux autres signification et efficace, et la « mythologie comparée », en ce sens, garde sa primauté; on peut même, par piété pour les premiers chercheurs, maintenir ce nom pour désigner la nouvelle forme d'étude comparée des religions indo-européennes. Mais la « mythologie comparée » moderne n'est possible qu'à condition d'incorporer à tous les étages de sa structure tous les phénomènes en relation avec les mythes, c'est-à-dire pratiquement toute la sociologie. On comprend mieux dès lors l'intérêt de ces études : s'il s'agit de groupes humains historiques, c'est leur physiologie et leur anatomie tout entières qui s'exposent dans les mythes, schématisées parfois ou idéalisées, mais plus nettes, plus saisissables, plus philosophiques qu'elles ne le sont lorsqu'on les considère seulement dans les accidents de l'histoire. Et s'il s'agit de groupes humains préhistoriques, l'analyse ainsi comprise des mythes reconstitués par comparaison donne le seul moyen de connaissance objective.
2° Dans la vie d'une société, il est peu de « moments rituels » importants qui n'aient qu'une fonction, qu'un seul sens : un geste sacré tend à être aussi puissant, aussi fécond que possible, tend à être total. Il est certes légitime de parler, par exemple, de « rites purificatoires », mais on ne doit pas oublier que les usagers tâchent en même temps, et par ces mêmes rites, de faire prospérer leurs champs et leurs troupeaux, d'obtenir longue vie, de nuire à leurs ennemis, etc. II en est de même pour les mythes, avec la circonstance supplémentaire que les jeux naturels de l'imagination et de l'association des idées les enrichissent plus facilement encore. Aussi est-il rare qu'un mythe n'ait qu'un sens. Et c'est ici que, très souvent, il est légitime de restituer une part accessoire aux anciennes interprétations naturalistes : l'indien Indra n'est pas l'orage personnifié, certes; il est la projection divine de la classe des guerriers; cela n'empêche pas que ses combats célestes ont été certainement assimilés aux phénomènes atmosphériques où interviennent le nuage, l'orage, la pluie. Les mythologies de l'Amérique et de l'Afrique montrent constamment, à nu, sans qu'il soit besoin d'interpréter, ces mouvements simultanés, ces harmoniques de l'imagination sur des plans divers.
3° Suivant le génie des peuples, les mythes, solidaires des rites, sont orientés vers le merveilleux ou vers le vraisemblable, supposent un monde différent du nôtre ou se présentent comme des histoires, comme de l'histoire ancienne ou même récente. Ici le récit fait intervenir des dieux, des héros fabuleux, des monstres; là simplement des personnages qu'on croit « historiques » : héros nationaux, ennemis de type humain. Dans les deux cas, pourtant, ils répondent aux mêmes besoins et méritent le même nom. Sur le domaine indo-européen, Rome, abstraction faite des influences grecques facilement décelables, représente à l'extrême ce type de mythologie à forme historique. Qu'on feuillette ce livre infiniment précieux, ce véritable traité de sociologie religieuse, sans équivalent dans l'antiquité classique, que sont les Fastes d'Ovide : chaque fête, chaque geste rituel y est justifié par un, deux, trois récits qui se présentent presque tous comme de l'histoire; ce sont pourtant des mythes, au même titre que ceux qu'on lit, malheureusement coupés de tout support rituel, dans la Théogonie d'Hésiode ou dans les « poèmes divins » de l’Edda.
4° Les mythes ne meurent pas toujours en même temps que disparaissent, sous des influences diverses, les formes de vie politique ou économique, les rites religieux qu'ils avaient d'abord contribué à maintenir. La mythologie irlandaise a ainsi survécu à la christianisation. Mais elle s'est tournée tantôt en légendes (liées à des noms historiques ou géographiques), tantôt en contes (anonymes), et si elle n'avait pas été, dès les premiers siècles de sa déchéance, consignée en lettres par des clercs heureusement attachés aux traditions, elle ne nous serait parvenue qu'éro-dée, banalisée, envahie aux trois quarts par les lieux communs du folklore international. C'est une grosse question de savoir si les thèmes des contes sont nés dans des temps très anciens de mythes dégénérés ou si, pour l'essentiel, ils représentent un genre de production imaginative qui a toujours été autonome. Mais à coup sûr cette vivace forme de littérature populaire, sous tous les climats, envahit sans délai, défigure et dévore les mythes dont une fonction sociale précise ne défend plus l'originalité. Le mythologue ne doit pas perdre de vue cette évolution; souvent, en effet, un texte lui livre un mythe déjà désaffecté mais dont la dégénérescence folklorique n'est qu'à un stade précoce.
5° Ce n'est que tardivement, littérairement, chez des peuples déjà pourvus de philologues ou bien dans les religions à dogmes impératifs, que l'on voit apparaître des corpus mythologiques, « une mythologie », où l'ensemble des mythes s'organise sans contradictions au prix de retouches et de compromis. Encore ces efforts restent-ils peu efficaces sur la religion vécue. Pourtant, et dans les milieux les plus arriérés, même en Australie, on est en droit de superposer la notion de « mythologie » à la pluralité des mythes : quelque contradictoires qu'ils soient en effet, ces derniers n'en restent pas moins solidaires; des êtres surnaturels de même groupe, de même type y apparaissent, les mêmes noms propres (de lieux, d'êtres, etc.) font la liaison d'un récit à l'autre, les mêmes institutions sociales et cosmiques, explicitement ou en filigrane orientent tous les récits; si les usagers ont confiance dans l'efficacité d'un mythe particulier, c'est, pour beaucoup, parce qu'ils sentent, parce qu'ils savent qu'il n'est pas isolé : une cohérence mouvante mais suffisante est maintenue d'autant plus facilement que, en chaque occasion, c'est un seul mythe qui a de l'importance, qui se récite avec détail, la masse de tous les autres composant en sourdine une orchestration utile mais nécessairement confuse. Ce sentiment de « choses du même genre, apparentées », suffit à constituer, au-dessus des mythes, une mythologie, un organisme dont on ne doit isoler les fragments qu'avec précaution.
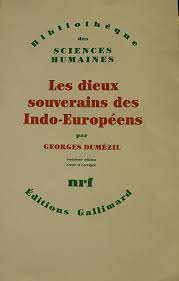
IV. — Point de départ : religions des Indo-Iraniens, des Celtes et des Italiotes.
L'unité de langue, disions-nous, suppose un minimum commun de civilisation, en particulier de religion. La matière de notre étude n'est donc pas illusoire : par la confrontation des équilibres religieux attestés dans les diverses sociétés parlant des langues indo-européennes, on peut espérer reconstituer au moins des fragments de l'ancienne religion commune, de la même manière que les linguistes, par la confrontation des grammaires et des vocabulaires du sanscrit, du grec, du latin, etc., reconstituent une bonne partie de l'indo-européen commun.
Il se pourrait cependant que cette matière fût inaccessible, et l'étude impossible; il se pourrait qu'en évoluant au sein des sociétés issues par fractionnement de la société préhistorique, l'ancien équilibre eût tellement changé que les traces du passé fussent imperceptibles ou méconnaissables; une langue étant moins sujette aux révolutions, aux réformes et refontes radicales qu'une religion, il se pourrait que, tout en continuant à parler deux formes encore fraternelles de l'indo-européen, les Indiens védiques et les Latins de Rome par exemple eussent entièrement renouvelé leurs systèmes de rites et de mythes, au point de ne pas laisser de prise à la comparaison.
De fait le « minimum initial de civilisation commune » s'est partout considérablement altéré lorsque les tribus indo-européennes, se dispersant aux quatre points cardinaux, de l'Atlantique au Turkestan, de la Scandinavie à la Crète et à l'Indus, se sont superposées ou mêlées à des allogènes dont la civilisation — nous pensons au monde égéen, à l'Asie antérieure, à Mohendjo Daro — les a conquises dans le temps même où, conquérantes, elles imposaient l'essentiel de leur langue.
Nulle part donc, nous pouvons en être certains, les religions historiquement attestées ne sont issues par simple et linéaire évolution de la religion indo-européenne. Partout nous nous trouvons vraiment en présence d'équilibres nouveaux, quelques-uns constitués pour la plus grande part de matériaux non indo-européens; les faits hérités de la préhistoire commune n'y sont plus que des survivances réduites ou déformées selon les nécessités de la perspective nouvelle. Découvrir ces faits dans leurs cachettes et sous leurs déguisements, n'est-ce pas un problème insoluble et même inabordable?
Ce n'est qu'un problème difficile. Et voici la circonstance particulière qui donne un moyen de l'aborder.
Entre l'unité indo-européenne préhistorique et les histoires, séparées, des Indiens, des Perses, des Scythes, des Grecs, des Latins, des Gaulois, des Irlandais, etc., l'examen des faits linguistiques a permis d'établir qu'il y a eu, en cours de migration et parfois jusque près du point d'arrivée, des unités partielles intermédiaires : il y a eu, par exemple, jusqu'à l'extrême Est, une unité indo-iranienne; jusqu'à l'extrême Ouest, une unité plus lâche rapprochant les futurs Celtes et les futurs Italiotes. Cela est capital : ce qu'on sait par l'archéologie de l'ancienne Europe non méditerranéenne et du sud de l'actuelle Russie donne à penser que, entre l'unité indo-européenne et ces unités partielles, les peuples en migration n'ont pas rencontré de « grande civilisation », ni donc de grands systèmes religieux comme il est arrivé ensuite plus au sud; il est donc probable que « la religion indo-européenne » n'a pas été, durant cette période, complètement bouleversée. Comme d'autre part ces unités partielles sont plus récentes, relativement proches même des premiers documents « séparés », il est probable que, en dépit des bouleversements qui ont suivi, les survivances observables du dernier état commun, les souvenirs, au moins quant au vocabulaire religieux, seront encore abondants et groupés, de sorte que l'ancien équilibre se laissera peut-être entrevoir sous le nouveau. C'est en particulier ce qui s'est vérifié pour l'unité partielle indo-iranienne : la religion de l’Avesta n'est pas celle des Veda; les correspondances de vocabulaire religieux (noms d'êtres divins, d'hommes, d'objets et d'actes sacrés, formules même) y sont pourtant très nombreuses et éclatantes. Or il est évident, quelle que soit la méthode de nos études, qu'un rôle très important y sera joué par le recensement et le classement des correspondances de vocabulaire. Le fait qu'on puisse atteindre, et presque sans effort, un vocabulaire religieux indo-iranien considérable est rassurant.
Il y a mieux. Une des chances, la meilleure chance peut-être de nos études est le fait, remarqué d'abord par M. Kretschmer puis mis en pleine valeur par M. Vendryes (Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, XX, 1918, pp. 265-285), que d'assez nombreux mots relatifs à la religion apparaissent à la fois chez les Italiotes, chez les Celtes, et dans le groupe indo-iranien, et n'apparaissent que là. Des termes mystiques comme ceux qui désignent la « foi » dans l'efficacité de l'acte sacré, la pureté rituelle et morale, l'exactitude rituelle, l'offrande au dieu et l'agrément du dieu, la protection divine, la prospérité, le mot signifiant la récitation des formules, des noms d'hommes chargés de fonctions sacrées ne se rencontrent ainsi que sur les bords opposés du vaste domaine recouvert par les langues indo-européennes. Cette singulière distribution s'explique, ainsi que l'a indiqué M. Vendryes, par une concordance non plus linguistique mais sociologique ; alors que chez les autres peuples de la famille les prêtres n'ont dans la société qu'un rôle mineur, un rôle « d'ouvriers » parmi les autres, les brahmanes indiens, les mages iraniens, les druides celtiques, le collège pontifical (flamines et pontifes) à Rome constituent autant de puissants corps sacerdotaux, dépositaires intéressés des traditions; qu'on pense au vaste effort de mémoire requis des jeunes brahmanes et des élèves druides.
Cette circonstance assure que des survivances de la plus vieille unité existent, qu'elles sont directement connaissables. Elle met le linguiste en état de signaler au sociologue des notions qui, désignées ici et là par les mêmes mots anciens, ont chance de contenir encore en partie la même ancienne matière.
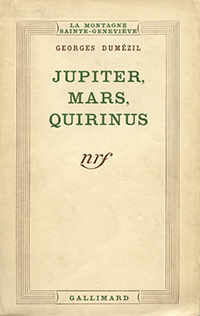
V. — Le problème des cadres sociaux et religieux.
Appuyée à ce point fixe, la nouvelle mythologie comparée a fait depuis vingt ans ses premières prospections. D'abord incertaines et maladroites, elle les a rectifiées, assurées et réunies dans une synthèse déjà vaste où les vues particulières se contrôlent réciproquement et qui ne paraît pas artificielle à de bons esprits.
Les faits les plus apparents, ceux qui ont vite concentré sur eux la recherche, sont relatifs à la « Souveraineté ». Nous entendons par là l'ensemble des rites et des mythes relatifs à l'administration magique et juridique du monde et de la société, aux grands dieux célestes et aux rois leurs représentants, ainsi qu'aux ministres mythiques et aux prêtres ou magistrats terrestres qui assistent les Souverains dans leur office. Il semble en effet que les divers peuples indo-européens, du moins ceux chez qui ont survécu de grands corps sacerdotaux, aient gardé avec une fidélité particulière ce qui, dans la religion, concernait ces fonctions présidentielles et directrices (1).
Mais il ne faut pas oublier qu'une religion — et ces deux mots se sont déjà rencontrés plusieurs fois dans l'exposé qui précède — est un système, un équilibre. Elle n'est pas faite de pièces et de morceaux assemblés au hasard, avec des lacunes, des redondances et des disproportions scandaleuses. Si nous osions risquer après tant d'autres une définition, toujours extérieure, nous dirions qu'une religion est une explication générale et cohérente de l'univers soutenant et animant la vie de la société et des individus. Si donc on ne veut pas se méprendre grossièrement sur la forme, l'ampleur et la fonction propre de tel ou tel d'entre les rouages d'une religion, il est urgent de le situer avec précision par rapport à l'ensemble. Quitte à retoucher ensuite cette première image, il faut dessiner d'abord les lignes maîtresses de toute l'architecture religieuse qu'on étudie ou qu'on reconstitue. Sinon, n'importe quel dieu étant plus ou moins amené à s'occuper de toutes les provinces de la vie humaine, on risque d'attribuer essentiellement à celui, quel qu'il soit, qu'on étudiera ce qui ne lui appartient qu'accidentellement; on le centrera sur la marge de son domaine ou même au delà et l'on méconnaîtra au contraire sa destination fondamentale. Bref, contrairement à une illusion fréquente, contrairement à un précepte de fausse prudence fort révéré, les monographies ne peuvent être constituées avec quelque assurance que lorsque l’ordre d'ensemble a été reconnu. Ou, si l’on préfère une formule plus modérée, il faut pousser parallèlement, l’une corrigeant sans cesse et améliorant l'autre, l'étude du cadre et celle des détails, l'étude de l'organisme et celle des tissus.
Nous avons senti vivement cette nécessité en plus d'un point de nos études sur les dieux souverains, et aussi à la lecture d'excellents livres récemment publiés en Allemagne et en Suède sur la même question (2). Faute de situer exactement le « Souverain » parmi les rouages politiques et parmi les représentations religieuses des Indo-Européens, nous nous sommes sentis portés, et nous avons vu les autres portés à élargir indéfiniment son domaine propre, ce qui n'est certes pas entièrement illégitime puisque le dieu souverain, en dernière analyse, a regard et entrée partout, mais ce qui fausse la juste perspective puisque, à partir de certaines limites, dans certaines zones, il n'agit qu'en interférence ou en collaboration avec d'autres spécialistes divins plus immédiatement intéressés, alors que, dans sa zone centrale, il opère directement. Dans le temps même où nous traitions de Varuna comme dieu souverain, on a pu écrire ailleurs un gros traité sur les activités agraires et économiques du même personnage; et l'on n'avait pas tort; mais où est le centre propre de Varuna? Est-ce dans la souveraineté ou dans la fécondité qui, elle, ne manque pas de représentants divins qualifiés? Chez les Germains, Odhinn semble patronner à la fois les magiciens, la royauté, une partie des activités guerrières, et plusieurs auteurs ont insisté davantage sur son affinité avec l'agriculture : derechef, où est son centre. Inversement, n'importe quel dieu spécialiste, dans certaines circonstances, sort de son domaine, prend même des airs de dieu souverain : c'est ainsi que Mars bellator, s'occupe aussi des champs et du bétail au point que quelques historiens de la religion romaine font de l'élevage et de l'agriculture sa fonction primaire, tandis que d'autres, se fondant sur des faits considérables, voient en lui, en Mars Pater, le plus ancien « grand dieu » italique dont Jupiter n'aurait que tardivement usurpé quelques activités : ici encore, où est le centre.
Ces incertitudes et beaucoup d'autres analogues nous ont conduit à essayer de fixer, avant toute nouvelle enquête de détail, les cadres généraux et les grandes articulations de la religion indo-européenne. Et comme, chez les demi-civilisés, la conception du monde et celle de la société, la hiérarchie des dieux et celle des hommes sont le plus souvent parallèles, cette recherche revient à définir, à la fois et indifféremment, comment les Indo-Européens concevaient la division et l'harmonie de leur corps social et comment ils ajustaient les provinces de leurs principaux dieux.
GEORGES DUMÉZIL 
Notes :
(1) Voir nos essais Ouranos-Varuna, 1934 (A. Maisonneuve); Flamen-Brahman, 1935 (Geuthner); Mitra-Varuna, essai sur deux représentations indo-européennes de la Souveraineté, 1940 (Leroux); Jupiter, Mars, Quirinus, essai sur la conception indo-européenne de la Société et sur les origines de Rome, 1941 (Editions de la N. R. F.)-
(2) H. Güntert, Der arische Weltkönig und Heiland, Halle, 1923; H. Lommel, Die alten Arier, von Art und Adel ihrer Gôtter, Frankfurt a. M., 1935; G. Widengren, Hochgottglaube im alten Iran, Upsal et Leipzig, 1938.
Sources : La Nouvelle Revue Française – 1er octobre 1941