Georges Dumézil
- Détails
- Catégorie : Georges Dumézil
- Clics : 1903
Georges Dumézil retrace son parcours, son cheminement et les principaux résultats de ses travaux.
- Détails
- Catégorie : Georges Dumézil
- Clics : 2830

Aristide Leucate est l'auteur de plusieurs livres, dont l'excellent « Carl Schmitt », paru dans la collection « Qui suis-je », chez Pardès. Il nous propose aujourd'hui un livre passionnant qui est une remarquable biographie et une synthèse de l'œuvre de Georges Dumézil, qui permit aux Indo-Européens (IE) de sortir du relatif oubli où ils semblaient végéter depuis la fin du XIXème siècle. Son coup de maître fut sa fameuse découverte, en 1938, de la trifonctionnalité. Dans ses travaux de mythologie comparée, il a montré que beaucoup de récits, dans l'aire indo-européenne, étaient organisés selon des structures narratives semblables et que les mythes exprimés par ces récits traduisaient une conception de la société organisée selon trois fonctions : la fonction du sacré et de la souveraineté ; la fonction guerrière ; la fonction de production et de reproduction. Cette organisation en trois fonctions se retrouve aussi bien dans : la mythologie ; les récits fondateurs comme ceux de la Rome antique ; les institutions sociales comme celles du système de castes en Inde ; la société d'ordres d'Ancien Régime segmentée en clergé, noblesse et tiers état. La société médiévale est ainsi divisée en oratores (ceux qui prient, le clergé), bellatores (ceux qui combattent, la noblesse) et laboratores (ceux qui travaillent, le tiers état). La société indienne est quant à elle divisée en brahmanes (prêtres, enseignants et professeurs), kshatriyas (roi, princes, administrateurs et soldats), plus la caste productive, qui se subdivise en artisans, commerçants, hommes d'affaires, agriculteurs, bergers et serviteurs. Cette tripartition se retrouve dans le vocabulaire, l'organisation sociale et le corpus légendaire de tous les peuples indo-européens.
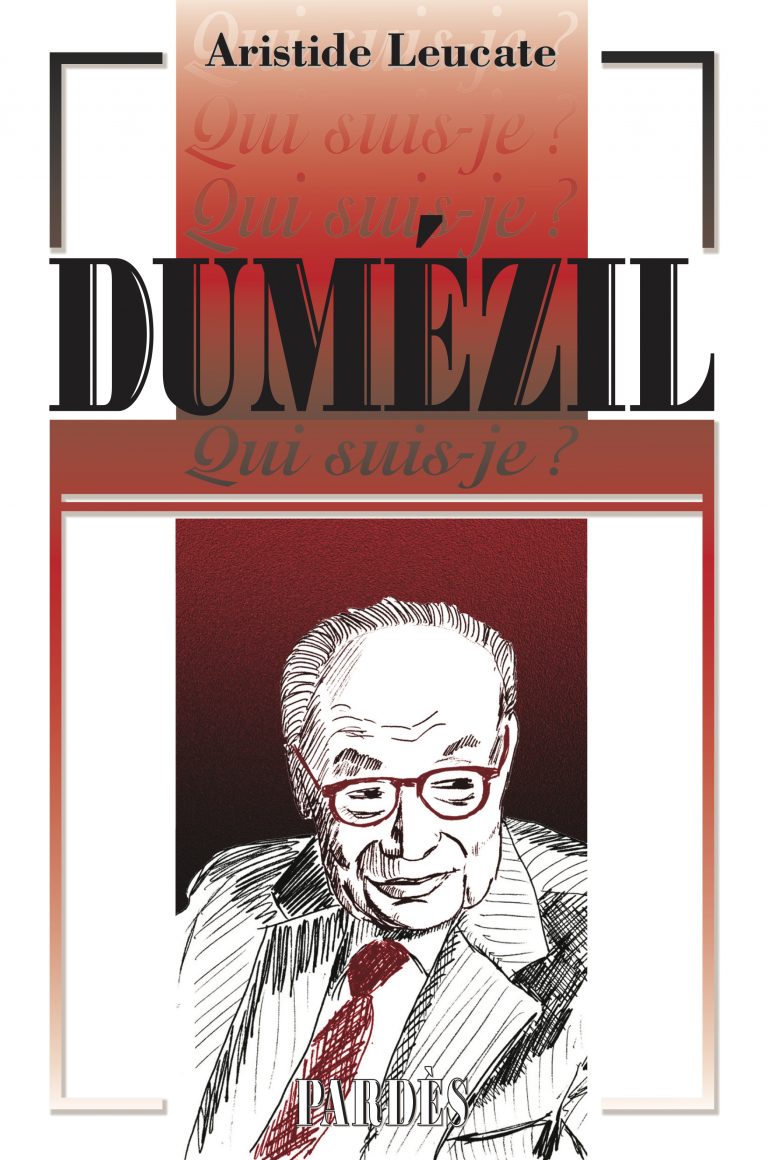
Enfance et jeunesse d'un surdoué
Georges Dumézil voit le jour le vendredi 4 mars 1898 dans le XIIème arrondissement de Paris. Son grand-père paternel était artisan-tonnelier. Le futur père de Georges, Jean Anatole, se passionne pour la poésie latine. Polytechnicien en 1877, il devient général de Division en 1916 et sera plusieurs fois décoré. Sa mère est la petite-fille d'un militaire qui sera plus tard maire de Mascara en Oranie. Le père très lettré de Georges Dumézil lui transmet dès l'âge de huit ans, un goût prononcé pour l'Antiquité grecque et romaine. A l'âge de neuf ans, il lit l'Enéide dans le texte et fait l'apprentissage de l'allemand par la lecture assidue d'un livre offert par son père sur la mythologie grecque. Il découvre avec passion l'histoire de Jason et des Argonautes, comme celle d'Héraclès. Et puis, il va découvrir avec gourmandise le sanskrit. Aucun doute, Dumézil est intellectuellement précoce et développe, de surcroît, une remarquable aisance dans l'apprentissage des langues. Son père étant affecté pour une courte période de six mois à Tarbes, il en profite pour apprendre le basque, une langue non-indo-européenne dont on ignore toujours l'origine. Bachelier, il passera le concours d'entrée à l’Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm, auquel il sera reçu « cacique », c'est-à-dire premier, en 1916. En mars 1917, il reçoit son ordre de mobilisation. Il vient à peine de fêter ses dix-neuf-ans. Il participera, en première ligne, à la seconde bataille de la Marne. Ses supérieurs de l'état-major estimeront qu'il a « toujours donné des preuves de courage et d'insouciance au danger ». Le voici titulaire de la Croix de guerre. C'est la guerre, mais sa curiosité intellectuelle ne faiblit pas. Déambulant dans un village bombardé, il débusque un livre contenant une légende populaire russe, premier jalon d'une quête mythologique qui ne le quittera plus. Au sortir de la guerre, Dumézil admettra que cette terrible expérience fut « la grande transformation, presque l'épanouissement de (sa) vie », ajoutant: « La guerre m'a fait entrer dans l'humanité, et j'espère n'en être jamais sorti; ça donne le sentiment de l'extrême fragilité et de l'insignifiance de ce qu'on fait jour après jour ».
De brillantes études
Dumézil va passer la redoutable épreuve de l'agrégation de Lettres en novembre 1919 et, dans la foulée, en dépit de ses protestations, il apprend sa nomination comme professeur de seconde au lycée de Beauvais. Il s'y ennuie à mourir et décide de se mettre en « congé d'inactivité ». Le voici de retour à Paris où, entre deux cours particuliers, il écrit, pour le compte d'un député « bleu horizon », des discours d'inauguration de monuments, tout en assurant un service de presse pour le Quai d'Orsay. En janvier 1921, à sa demande, il part en Pologne comme premier lecteur de français à l'université de Varsovie. Son projet de thèse s'affermit et, renouvelant son « congé d'inactivité », il rentre en France, abandonnant définitivement l'enseignement secondaire. Il entreprend sa thèse de doctorat. C'est dans ces années 1921/1924 qu'il fait la connaissance de Pierre Gaxotte auquel il sera lié par une forte amitié, et qui lui permettra de côtoyer Charles Maurras. C'est Antoine Meillet, grand philologue et fondateur de la sociolinguistique, qui acceptera de parrainer son travail. Celui-ci conçoit toute langue comme un fait social. Meillet défend l'existence d'une civilisation indo-européenne attestée par une unité linguistique originelle, affirmant: « une langue une, suppose une civilisation une ». Le jury décerne son doctorat à Dumézil, assorti de la mention «très honorable ».
Séjour en Turquie, puis en Suède
En 1925, Dumézil a vingt-sept ans. Ses immenses connaissances en linguistique, en philologie, en mythologie et en histoire des religions ont été remarquées et saluées par ses maîtres et presque pairs. Mais ses travaux n'arrivent pas à convaincre. Même Antoine Meillet a des doutes quant à la pertinence de certaines de ses thèses. En attendant, notre jeune chercheur va épouser -nous sommes en 1925- Madeleine Legrand, qui lui donnera deux enfants promis, eux-aussi, à de belles carrières. Leur fils Claude (1929-2013) sera un psychanalyste reconnu tandis que leur fille, Anne-Perrine, née en 1930 sera, comme son père, reçue première à l'Ecole normale supérieure de Sèvres en 1949, embrassera la profession d'astrophysicienne et épousera le physicien Hubert Curien qui deviendra, par deux fois, ministre de la Recherche et de la Technologie de François Mitterrand (en 1984 et en 1988). Georges Dumézil va avoir l'opportunité de partir en Turquie. Le normalien Jean Mistler, futur secrétaire permanent de l'Académie française, qui dirigeait alors le Service des relations culturelles au ministère des Affaires étrangères, décide de l'envoyer à Istanbul où venait de se créer une chaire d'histoire des religions à la faculté de théologie islamique de l'université. L'enjeu pour le gouvernement turc de Mustafa Kemal était de laïciser le jeune Etat. Dumézil et sa femme vont y demeurer six ans, période durant laquelle le philologue découvrira et se consacrera à la linguistique caucasienne, tout en explorant la région. De retour en France en 1931, il ne tarde pas de partir à Upsala, en Suède, revenant à ses chères études indo-européennes. Ce passage par la Scandinavie le marquera durablement,au point qu'il y reviendra régulièrement pendant plusieurs étés.
Dumézil journaliste, directeur d'études et... franc-maçon
Revenu en France en 1933, « conférencier temporaire » à l'Ecole pratique des hautes études, il devient, sous le pseudonyme de Georges Mercenay, collaborateur du Jour fondé par Léon Bailby. Il y sera chargé de la rubrique « politique étrangère » jusqu'en novembre 1935. Il y dévoile, nous apprend Aristide Leucate, ses « dilections mussoliniennes » comme ses plus solides préventions antihitlériennes. Nous y reviendrons dans un prochain chapitre. Le 23 octobre 1936, Dumézil est admis à la loge Le Portique de la Grande Loge de France, fondée en 1910 par l'historien de la franc-maçonnerie Albert Lantoine. Il participera aux tenues et autres réunions jusqu'en juillet 1939. Il est avéré que cette adhésion maçonnique pèsera lourdement dans son renvoi, certes temporaire, de l'enseignement universitaire par les autorités de Vichy. Pour ce qui est de la carrière professionnelle de Dumézil, il sera particulièrement soutenu par Sylvain Lévi, maître de l'indianisme français, juif alsacien, président de l'Alliance israélite universelle, ardent patriote, grand spécialiste du sanskrit et professeur au Collège de France. En grande partie grâce à lui (Dumézil dira qu'il a été son « sauveur »), il sera désigné comme Directeur d'études pour l'enseignement de mythologie comparée. Pierre Gaxotte, qui était intervenu auprès du ministre Georges Mandel, lui avait donné un dernier coup de pouce. Dumézil, qui commence à être reconnu depuis sa « découverte » de la structure tripartie commune à tous les idiomes indo-européens, enseignera à l'Ecole jusqu'en 1968, année où il fera valoir ses droits à la retraite.
Destitué de la fonction publique
Mais voici à nouveau la guerre. Dumézil sera officier de liaison de juillet 1939 à janvier 1940, avant d'être rattaché à l'armée d'Orient comme agent de renseignement. Durant un séjour à Ankara, il se convertira au christianisme, une conversion sans lendemain, puisqu'il retournera assez rapidement à son scepticisme athée originel. Après la débâcle, Dumézil va reprendre le cours normal de ses activités d'enseignement et de recherches jusqu'à sa destitution (qualifiée de « démission d'office ») de la fonction publique, le 21 novembre 1941, pour son appartenance maçonnique. Il vivra chichement de quelques heures d'enseignement de grec et latin dans un collège, grâce à l'intervention d'un condisciple de l'Ecole normale supérieure, le Père Festugière. Dumézil nourrira d'amers regrets quant à son engagement passé au sein de la Loge du Portique. Un de ses proches, Didier Eribon, qui le connaissait bien, a relevé: « Dumézil, aussi surprenant que cela puisse paraître, était malléable et influençable: c'est un ami qui l'a entraîné dans une loge maçonnique, un ami qui l'a converti au christianisme ». Pendant cette période, il travaille d'arrache-pied à la publication d'articles dans des revues scientifiques, ou d'ouvrages. Grâce à son introduction auprès de Gaston Gallimard, il fait paraître, à un rythme effréné: Jupiter, Mars, Quirinus (1941), Horace et les Curiaces (1942), Servius et la fortune (1943), Naissance de Rome (1944), Naissance d'archanges (1945). Il publie également deux articles dans La Nouvelle Revue française dirigée par Pierre Drieu la Rochelle. Dumézil parviendra, grâce à ses appuis et nombreuses relations, et aussi de « quelques petits mensonges et d'opportuns faux témoignages », à se faire réintégrer au sein de l'Université. Il bénéficiera des soutiens de l'archevêché de Paris, de Pierre Laval et d'Abel Bonnard, ministre de l'Education nationale, et réintègre, par arrêté du 15 décembre 1942, l'Ecole pratique des hautes études, où il reprend son cours de religion romaine. L'arrêté, qui faisait état des « preuves de dévouement de Dumézil à l'endroit du maréchal Pétain », lui vaudra d'être traduit, sur dénonciation du linguiste stalinien Marcel Cohen, devant la commission d'épuration de l'enseignement supérieur le 12 décembre 1944, heureusement sans conséquences notables.
Georges Dumézil académicien
Georges Dumézil sera élu professeur au Collège de France, à la chaire de « civilisation indo-européenne », en avril 1949. Il y enseignera régulièrement, le jeudi et le samedi, jusqu'en 1968, année officielle de sa mise en retraite. En 1955, il est fait Docteur honoris causa de l'université d'Uppsala. Il poursuit ses voyages en Turquie et dans le Caucase, tout en abattant une masse colossale de travail. Quand sonne l'heure de la retraite, il s'envole pour les Etats-Unis où il va rejoindre son ami Mircea Eliade à l'université de Chicago. En 1970, il entre à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, premier pas vers la Coupole qui l'élit au fauteuil de Jacques Chastenet, le 26 octobre 1978. Le voici « immortel ». Il prononce son discours de réception le 14 juin 1979, auquel répond Claude Lévi-Strauss, qui semble admiratif, sinon émerveillé, par un hommage mémorable. Jugez-en: « On penserait souvent en vous lisant à Voltaire, dont vous avez la grâce d'écriture, le style rapide et incisif, le goût de la formule brillante et du mot juste, si ce n'était que, chez vous, l'humour ne s'exerce jamais aux dépens des grands textes, mais, pour reprendre vos propres termes, dans un esprit d'"affectueuse complicité". En 1984, il recevra le prix mondial Cino Del Duca, richement doté (l'équivalent de 200 000 euros), et le public commence à découvrir cet étonnant personnage, qui parle plus de trente langues, dans la grande presse, à la radio et à la télévision où il sera l'invité de Bernard Pivot dans sa célèbre émission Apostrophes.

La découverte de la trifonctionnalité
Parler des indo-européens revient, écrit Aristide Leucate, à isoler, dans la longue nuit des temps, ces quelques milliers d'années qui séparent cette période qui n'appartient pas tout à fait à la préhistoire de celle que l'on appelle conventionnellement l'Antiquité. Ainsi les Indo-Européens seraient cette communauté ethnolinguistique qui remonterait au stade terminal du Néolithique et les débuts de l'âge de bronze. Les Indo-Européens seraient ainsi apparus vers 4500 avant J.-C. pour se disperser vers 2000 avant J.-C. Leur datation semble faire à peu près consensus, tandis que leur localisation géographique ne laisse pas de perdre archéologues, philologues, historiens et linguistes dans un abîme de conjectures. On est à peu près sûr, cependant, de leur provenance eurasiatique sans que leur berceau d'origine (l' Urheimat) à partir duquel les IE rayonnèrent sur toute l'Europe, soit parfaitement circonscrit. Faisons un sort aux divagations romantiques d'une origine circumpolaire, avec l'Ultima Thulé ou la fantasmagorique Atlantide, évacuées par tous les indo-européanistes sérieux. L'hypothèse la plus probable, mais toujours en débat, est que ce foyer originel se situe dans les steppes européennes (Ukraine et Russie méridionale). Ainsi, la théorie de Kourganes, formulée en 1956 par l'archéologue Marija Gimbutas, avance le scénario, jusque là non contredit, d'une continuité ethnoculturelle indo-européenne fondée sur des caractéristiques communes: rites funéraires (kourgan, mot russe d'origine turque, signifie 'tumulus'), économie d'élevage, société hiérarchisée, patriarcale et guerrière, architecture massive, habitat fixe, sacrifices rituels, etc... Notons au passage que Dumézil conteste la synonymie des mots « indo-européen » et « aryen », réservant ce dernier, qui est aujourd'hui obsolète, aux seuls Indiens et Iraniens qui se définissent eux-mêmes comme « Arya ». Dumézil « tâtonna » longtemps, raconte-t-il, avant de formuler ce qui apparaît aujourd'hui comme une évidence, à savoir la structuration trifonctionnelle des sociétés indo-européennes, de leur mentalité, de leur psyché, de leurs représentations symboliques, bref, de leur « vue du monde » ou « Weltanschauung ». C'est en effet Dumézil qui sut le premier dégager une « idéologie » propre à la communauté ethnolinguistique indo-européenne, soit une façon à nulle autre semblable de penser le monde, les hommes et les divinités. Il raconte que c'est en préparant un de ses cours à l'Ecole pratique, en 1938, qu'il eut soudainement la révélation de ce qui allait constituer sa découverte fondamentale. Dans La Religion romaine archaïque, il explique ainsi son « invention »: « j'ai proposé d'appeler cette structure ' l'idéologie des trois fonctions'. Les principaux éléments et rouages du monde et de la société sont répartis en trois domaines harmonieusement ajustés qui sont, en ordre décroissant de dignité, la souveraineté avec ses aspects magique et juridique, la force physique et la vaillance dont la manifestation la plus voyante est la guerre victorieuse, et enfin la fécondité et la prospérité. » C'est ainsi, poursuit-il, que le groupement « Jupiter Mars Quirinus » romain répond à « Odin Thor Freyr » en Scandinavie et à « Mitra-Varuna Indra Nasatya » en Inde. Certains chercheurs évoquent une « quatrième fonction », complémentaire avec la tripartition initiale, qui recouvrirait le « non-ordre », pas forcément synonyme de « chaos », qu'évoqueraient par exemple les Saturnales de l'ancienne Rome. Dumézil avait assenti à cette hypothèse, en 1982, dans son « Apollon sonore et autres essais ».
Georges Dumézil, admirateur de Maurras
Certains ont tenté de faire passer Dumézil pour un « homme d'extrême droite ». Certes, il a été maurassien dans ses jeunes années de chercheur et cultiva, toute sa vie, un certain attachement pour le principe dynastique. Après sa démobilisation, en 1919, préparant l'agrégation de lettres et déambulant dans les thurnes de la rue d'Ulm, il rencontre Pierre Gaxotte, khâgneux comme lui au lycée Henri IV, avec lequel il va se lier d'amitié, ce qui le conduira, en 1924, à lui dédier sa thèse Le Festin d'immortalité. Reconnaissant, Gaxotte lui dédiera, en retour, sa Révolution française parue en 1928. Il sera même le parrain de sa fille. Gaxotte assurait alors le secrétariat de nuit de Charles Maurras. C'est ainsi que Georges Dumézil fut présenté au chef de l'Action française. Le futur académicien se décrit alors comme « socialiste indépendant ». Lui-même dira plus tard: « Je ne sais plus très bien ce que j'entendais par-là ». On découvre cependant dans ses carnets le concept d' « anarchisme aristocratique », un concept qui pourrait s'apparenter à la figure de l'Anarque qu'Ernst Jünger développera bien plus tard. Dumézil décrit ainsi son « anarchisme »: « L'attitude de celui qui est affranchi intellectuellement. L'anarchiste doit autant que possible se détacher des passions populaires, des courants d'opinion, des convictions tyranniques des partis ». Dumézil va se laisser peu à peu convaincre par le royalisme maurrassien au point de rédiger de petites notices non politiques qui paraîtront dans la toute jeune Revue universelle lancée par Jacques Bainville et Henri Massis. Il collaborera aussi sous pseudonyme, à la rédaction de L'Action française, prêtant sa plume à Bainville ou Maurras. Il dira plus tard: « J'allais avec Gaxotte à l'imprimerie de l' Action française, rue du Sentier. J'aimais bien le décors, la fièvre de ces heures nocturnes pendant lesquelles un quotidien prend forme ». Il est un fait, nous raconte Aristide Leucate: Dumézil est subjugué par Maurras, dont il dira, quelques mois avant sa mort qu'il était « un homme fascinant, et vraiment, d'instinct et de volonté, un maître à penser », allant jusqu'à le comparer à Antiphon, le précepteur de Thucydide qui, après les malheurs de la guerre du Péloponnèse, exerça ce genre de magistère sur la jeunesse d'Athènes. Dumézil poursuit ainsi son exercice d'admiration: « Il faisait une impression qu'il est impossible de mettre en mots. Et surtout pour les jeunes, quelles que fussent leurs opinions, il était toujours disponible. Il était presque fraternel, malgré son tempérament de patron ». Leucate nous raconte cette anecdote amusante. Dumézil se piquait d'écrire des poèmes et rêvait de les voir édités. Il raconte: « un après-midi, je lui avais fait remettre quelques poèmes de moi qui me paraissaient dignes d'être publiés. Le soir même, il me déclara franchement son sentiment: 'Faire des vers, me dit-il, est une très bonne manière d'écrire ses Mémoires'. Et il ajouta: 'Pour soi' ». C'en était fini de la carrière de poète de Dumézil. Il dira plus tard: « Il m'a rendu en tout cas un très grand service »... Dumézil affirme n'avoir jamais adhéré à l'AF, et encore moins avoir été membre de Camelots du roi, mais les idées de Maurras l'ont marqué. Il dira : « Le principe non pas simplement monarchique, mais dynastique, qui met le plus haut poste de l'Etat à l'abri des caprices et des ambitions, me paraissait, et me paraît toujours, préférable à l'élection généralisée dans laquelle nous vivons. » Il ajoutera cependant que, « bien sûr, la formule n'est pas applicable en France », où « la fierté même de l'histoire séculaire a disparu depuis trop longtemps », concluant par: « Ce n'est sans doute pas pour notre bien ». Aristide Leucate résume ainsi la pensée de Dumézil: « Il était bien plus maurrassien que royaliste ».
Soutien au fascisme. Vive hostilité au nazisme
Dumézil, qui s'éloigne progressivement de l'Action française va, par l'intermédiaire de son ami Pierre Gaxotte, faire son entrée au Jour, nouveau quotidien fondé par Léon Bailby, le 3 octobre 1933. Antidreyfusard, membre de la Ligue de la patrie française, il fut rédacteur en chef puis directeur du quotidien nationaliste L'Intransigeant d'Henri Rochefort. Pendant deux ans, de 1933 à septembre 1935, il va, sous le pseudonyme de Georges Marcenay, donner entre quatre et cinq fois par semaine, une chronique de politique étrangère. Dumézil y développe un certain nombre d'opinions personnelles, dont l'hostilité au régime parlementaire et à son corollaire, le système des partis. Sa préférence va à un régime fort. Il soutient le fascisme italien et se montre aussi fermement antibolchevique que viscéralement germanophobe. Admirateur du Duce, il n'hésite pas à l'inscrire dans la lignée de ses augustes prédécesseurs antiques. L'antigermanisme de Dumézil lui vient assurément de sa lecture de Bainville auquel il consacrera une recension laudatrice à ses Dictateurs, dans lequel l'historien n'a pas de mots assez durs pour vilipender Mein Kampf, « ouvrage singulièrement pauvre et primaire ». Marcenay-Dumézil ne cesse d'afficher son inquiétude croissante face aux menées bellicistes et impérialistes du chancelier allemand. Il déchiffre les événements outre-Rhin à travers la Germania de Tacite et La Guerre des Gaules de Jules César. Il connaît, mieux que personne ces « vieux Germains, des Germains de toujours, pour qui le sang est une denrée sacrée, mais de consommation courante ». Commentant dans Le Jour la Nuit des longs couteaux et l'assassinat de Röhm, il estime y retrouver « la beauté, l'épouvante, l'ironie des sagas du Nord, l'esprit sombre, vindicatif et sommaire des Nibelungen».
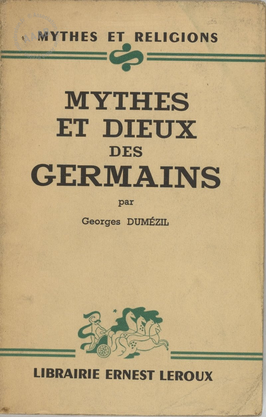
Dumézil sulfureux ?
La collaboration de Dumézil avec Le Jour n'aura duré que deux ans, mais certains voudront, après la guerre, lui coller une réputation d'homme d'extrême droite, voire de nazi. L'offensive est lancée en Italie par Arnaldo Momigliano, qui répand son venin, voyant dans Mythes et dieux des Germains, publié en 1939, « des traces très claires de sympathie pour la culture nazie ». Précisons que Momigliano, bien que juif, fut un fasciste actif durant les années trente, adhéra au Partito Fascista de 1928 à 1938, et prêta serment au Duce, ce qui lui permit, en 1933, d'occuper la chaire d'histoire romaine de l'université de Turin. Un autre excité, Carlo Ginzburg, évoqua « l'évidente sympathie nazie » de Dumézil, qu'il détectait dans Mythes et dieux des Germains, faisant au passage le procès en nazisme de l'Action française et de ses chefs de file. Dumézil n'eut aucune peine pour tordre le cou à cette assertion, rappelant que le grand historien juif Marc Bloch, fusillé par les Allemands en 1942, avait encensé l'ouvrage. Dans les années 1970, Dumézil fut violemment attaqué pour sa proximité supposée avec la Nouvelle Droite. Il avait accepté, avant de s'en retirer, de figurer dans le comité de patronage de la revue Nouvelle Ecole fondée par Alain de Benoist qui avait fait découvrir les thèses de Dumézil aux lecteurs français. La Nouvelle Droite sera accusée plus tard d'exhaler, raconte Aristide Leucate, « de nauséabondes fragrances de racisme sur fond de nostalgie nazie ». On se souvient du colloque du GRECE, en 1979, porte Maillot, attaqué par des commandos juifs au cri de « Nouvelle Droite, nouveaux nazis ». L'autre grande attaque viendra d'outre-Atlantique, en 1990, où Dumézil fut accusé d'avoir justifié le génocide perpétré par les Turcs contre les Arméniens. Il était accusé d'avoir écrit une étude intitulée « De faux massacres » alors qu'il était professeur à l'université d'Istanbul en 1927. En fait, Dumézil ne se référait nullement à cet épisode historique dans ses travaux.

Georges Dumézil meurt à son domicile, le 11 octobre 1986, à quatre-vingt huit ans, terrassé par une crise cardiaque. Voici, en conclusion, le portrait qu'Aristide Leucate fait de Dumézil: « Un savant aussi attachant que prodigieusement érudit. Un honnête homme comme il n'en est plus. »
Robert Spieler
« Dumézil » d' Aristide Leucate, éditions Pardès, 128 pages, 12 euros,
- Détails
- Catégorie : Georges Dumézil
- Clics : 2664

I. — Les Indo-Européens.
Au cours du troisième et du second millénaires avant Jésus-Christ se produisit l'événement le plus important de l'histoire temporelle récente de l'humanité : d'une région qu'on semble pouvoir situer entre la plaine hongroise et la Baltique, par vagues successives, partirent en tous sens des troupes conquérantes qui parlaient sensiblement la même langue. Que s'était-il passé? Désagrégation d'empires préhistoriques? Difficultés alimentaires ou climatériques? Impérialisme inné, appel confus du destin, maturation plantureuse d'un groupe humain privilégié? Nous n'en saurons jamais rien. Mais le fait est là : des courses centrifuges, en quelques siècles, asservissent à ces hardis cavaliers toute l'Europe du Nord, de l'Ouest, du Sud et du Sud-Est; les anciens habitants disparaissent, s'assimilent ou forment des îlots qui se résorbent lentement et dont il ne subsiste aujourd'hui que le « témoin » basque, au bout des Pyrénées, et, dans le Caucase, de petits peuples très originaux. En Asie centrale, quelques-uns poussent jusqu'au Turkestan, où leurs royaumes tiendront encore près de dix siècles après le début de notre ère, malgré la pression chinoise, malgré les remous des Turcs et des Mongols. Certains, très tôt, et d'autres après eux, se ruent sur l'Asie antérieure; d'autres occupent l'Iran, cheminent jusqu'à l'Inde : mille ans avant Jésus-Christ, ils sont dans le Pendjab et déjà regardent le Gange où les Grecs du temps d'Alexandre les trouveront installés.
Par référence à l'aire ainsi couverte, le peuple inconnu d'où se sont détachés tant de rameaux a reçu des savants modernes un nom composé, purement symbolique, qui parle à l'esprit plus qu'à l'imagination : ce sont les Indo~ Européens.
Leurs chevauchées victorieuses n'échappent pas complètement à l'observation, du moins vers leurs points d'arrivée : dans tout le Proche Orient, les nouveaux venus côtoient, heurtent et parfois soumettent de vieilles sociétés très civilisées, qui tenaient depuis longtemps leurs annales et dont les inscriptions signalent l'ouragan. Les conquérants eux-mêmes adoptent en partie les usages et les commodités des vaincus ou des voisins et se mettent à graver : entre la mer Noire et la Syrie, nous connaissons maintenant et nous lisons les archives cunéiformes des rois hittites, maîtres d'un de ces empires du second millénaire avant notre ère. Mais un fait domine tout le détail : partout où on les voit s'installer, ces armées ont perdu la liaison avec les corps qui opèrent dans d'autres régions, même proches. A plus forte raison ne reconnaissent-elles pas pour parents ceux qui, par une randonnée antérieure, ont déjà foulé le sol où elles se fixent. Les langues se différencient. L'histoire, les mythes, les cultes se localisent. Les mœurs évoluent. Bref, nul sentiment ne survit de la communauté d'origine et les envahisseurs successifs bousculent indifféremment leurs plus intimes cousins et les autochtones les plus étranges. Plus tard, ça et là, quand les philosophes athéniens ou les grammairiens de Rome réfléchiront, ils admireront bien, par exemple, que le chien et l'eau portent presque le même nom en phrygien et en grec, ou que tant de mots latins sonnent si près des mots grecs de même sens : ils n'en concluront rien, sinon à l'emprunt ou à la constance de la machine humaine.
Et le jeu continue, cette fois en pleine lumière : les Germains submergent l'empire romain et donnent à l'Europe une nouvelle figure. Des flottes vont soumettre l'Afrique et l'Inde, les nouveaux mondes de l'Orient et de l'Occident, les îles des mers lointaines. Des colons sans scrupule dépeuplent en hâte et repeuplent une partie des Amériques, toute l'Australie. Après des succès éphémères, les concurrents arabes et turco-mongols sont éliminés : Alger, Le Caire, Bagdad tombent en vassalité, la Sibérie s'exprime en russe. Hormis quelques rares allogènes — Finnois, Hongrois, Turcs ottomans — qui ont su se faire admettre et comme naturaliser sans perdre leur langue, l'Europe « parle indo-européen » et, par ses émigrants, fait « parler indo-européen » à tout ce qui compte dans trois autres continents et dans la moitié du quatrième. Aujourd'hui, au delà de luttes fratricides qui sont peut-être le dur enfantement d'un ordre stable, on ne voit sur la planète qu'un coin de terre où pût grandir un appelant contre ce triomphe. Mais sans doute arriverait-il trop tard.
Pour toutes sortes de raisons qui tiennent aux conditions internes et externes du développement de la science, ce n'est qu'au début du XIXe siècle que les grammairiens occidentaux découvrirent ce fait capital que le sanscrit de l'Inde et les langues de l'Iran, le grec, le latin, les langues germaniques, les langues celtiques, les langues slaves et baltiques, ne sont que des formes prises, au cours d'évolutions divergentes, par un seul et même parler préhistorique qui se définit par rapport à elles comme le latin par rapport à l'italien, au français, à l'espagnol, au portugais, etc. La notion de « langues indo-européennes » était née. Un siècle d'admirable travail, auquel toutes les universités d'Europe ont collaboré, a permis de la préciser et de la nuancer, et l'on s,e fait aujourd'hui une idée nette de ce qu'était « l'indo-européen commun », au moment des grandes migrations qui l'ont brisé. Les recherches les plus récentes font même entrevoir par quelle évolution antérieure la langue commune avait atteint cet état final dont nos langues modernes sont des modifications diverses.
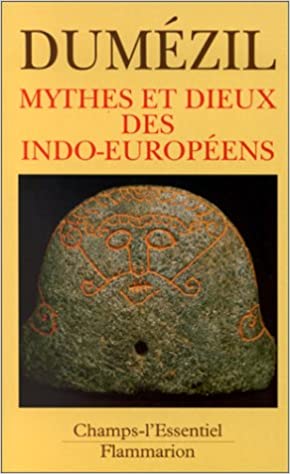
II— La religion des Indo-Européens.
L'unité de langue ne suppose pas forcément l'unité politique; elle suppose en tout cas une sensible unité de civilisation : qu'on songe à la Grèce d'avant Alexandre, qui n'a jamais formé un Etat, mais qui, malgré les différences de dialectes et de mœurs, a eu constamment conscience et volonté de « parler grec », de « vivre grec ». Il est certain que les hommes qui s'exprimaient dans la langue indoeuropéenne avaient en commun un minimum de civilisation matérielle et morale. Il est légitime, en particulier, de parler de « la religion indo-européenne », étant bien entendu que cette unité n'impliquait pas l'uniformité et que chaque canton, comme plus tard chaque vallée grecque, chaque cité du Latium, chaque fjord norvégien, colorait à sa façon le bien commun.
Vers le milieu du XIXe siècle, avec un bel enthousiasme, les savants s'efforcèrent donc de reconstituer comparativement, en même temps que la langue, la religion des Indo-Européens et surtout ce qu'on regardait alors comme la partie essentielle de toute religion, la mythologie. L'entreprise était prématurée et elle a échoué. Les philologues et les linguistes qui s'y dévouaient ne disposaient pas encore de cette nouvelle connaissance de l'homme, de cet humanisme élargi et rajeuni qu'a constitué, lentement d'abord puis à un rythme et à un débit vertigineux, l'exploration méthodique des diverses branches de notre espèce. La situation est bien meilleure aujourd'hui : l'ethnographie et l'anthropologie ont permis d'observer, toutes vives, les formes que revêt la religion dans des sociétés de civilisation comparable, pour le niveau et pour les éléments, à celle des Indo-Européens; d'autre part, la psychologie et la sociologie ont éclairé le mécanisme interne de ces paganismes, leurs conditions d'équilibre, les fonctions qu'ils assurent, les évolutions qui les attendent. On s'est donc remis au travail depuis une vingtaine d'années, en France et en Allemagne surtout, et aussi en Suède, en Hollande, en Belgique, mais en se gardant des deux illusions du début. On ne croit plus que les Indo-Européens aient été des « primitifs »; on sait que ni leur civilisation ni leur langue ne permettent d'atteindre un « début », un zéro absolu; que l'une et l'autre portent au contraire la marque, la charge et le fruit d'un riche passé dans lequel notre vue ne peut guère remonter. D'autre part, on ne croit plus que les mythes soient d'ingénieux et vains symboles imaginés de toutes pièces par des chantres pour exprimer leur admiration devant les spectacles de la nature, ni les jeux de mots plus ou moins conscients de philologues préhistoriques; aux mythes solaires, aux mythes d'orage, aux « épithètes personnifiées » et autres produits des « maladies du langage», on fait aujourd'hui leur juste part, qui n'est pas grande; on sait qu'une religion suppose, exprime, règle et coordonne des besoins et des efforts bien plus complexes.
III. — Mythes, rites, religion, société.
Réservant à la philosophie l'origine et l'essence des religions, et à s'en tenir à l'observation extérieure, on peut poser comme acquis les définitions et les principes suivants :
1° Un mythe est un récit que les usagers sentent dans un rapport habituel, d'ailleurs quelconque, avec une observance positive ou négative ou un comportement régulier ou une conception directrice de la vie religieuse d'une société. Loin donc d'être des inventions désintéressées, ou même des inventions libres de l'imagination, les mythes ne sont pas séparables de l'ensemble de la vie sociale : ils expliquent, illustrent, et protègent contre la négligence ou l'hostilité, des liturgies, des techniques, des institutions, des classifications, des hiérarchies, des spécialisations du travail commun, du maintien desquelles sont censés dépendre le bien-être, Tordre, la puissance de la collectivité et de ses membres. Il est donc impossible d'étudier les mythes sans étudier les formes de l'activité magico-religieuse, politico-religieuse, économico-religieuse, etc., des sociétés considérées. En particulier, chaque fois qu'un récit apparaîtra en liaison constante avec un rituel, on devra examiner si cette liaison n'est pas essentielle : elle l'est le plus souvent, et du même coup on saura quel était, pour les usagers, le sens principal de ce récit, de ce mythe.
Le mythe reste donc, autrement qu'on ne le croyait il y a un siècle, le phénomène religieux supérieur, qui donne aux autres signification et efficace, et la « mythologie comparée », en ce sens, garde sa primauté; on peut même, par piété pour les premiers chercheurs, maintenir ce nom pour désigner la nouvelle forme d'étude comparée des religions indo-européennes. Mais la « mythologie comparée » moderne n'est possible qu'à condition d'incorporer à tous les étages de sa structure tous les phénomènes en relation avec les mythes, c'est-à-dire pratiquement toute la sociologie. On comprend mieux dès lors l'intérêt de ces études : s'il s'agit de groupes humains historiques, c'est leur physiologie et leur anatomie tout entières qui s'exposent dans les mythes, schématisées parfois ou idéalisées, mais plus nettes, plus saisissables, plus philosophiques qu'elles ne le sont lorsqu'on les considère seulement dans les accidents de l'histoire. Et s'il s'agit de groupes humains préhistoriques, l'analyse ainsi comprise des mythes reconstitués par comparaison donne le seul moyen de connaissance objective.
2° Dans la vie d'une société, il est peu de « moments rituels » importants qui n'aient qu'une fonction, qu'un seul sens : un geste sacré tend à être aussi puissant, aussi fécond que possible, tend à être total. Il est certes légitime de parler, par exemple, de « rites purificatoires », mais on ne doit pas oublier que les usagers tâchent en même temps, et par ces mêmes rites, de faire prospérer leurs champs et leurs troupeaux, d'obtenir longue vie, de nuire à leurs ennemis, etc. II en est de même pour les mythes, avec la circonstance supplémentaire que les jeux naturels de l'imagination et de l'association des idées les enrichissent plus facilement encore. Aussi est-il rare qu'un mythe n'ait qu'un sens. Et c'est ici que, très souvent, il est légitime de restituer une part accessoire aux anciennes interprétations naturalistes : l'indien Indra n'est pas l'orage personnifié, certes; il est la projection divine de la classe des guerriers; cela n'empêche pas que ses combats célestes ont été certainement assimilés aux phénomènes atmosphériques où interviennent le nuage, l'orage, la pluie. Les mythologies de l'Amérique et de l'Afrique montrent constamment, à nu, sans qu'il soit besoin d'interpréter, ces mouvements simultanés, ces harmoniques de l'imagination sur des plans divers.
3° Suivant le génie des peuples, les mythes, solidaires des rites, sont orientés vers le merveilleux ou vers le vraisemblable, supposent un monde différent du nôtre ou se présentent comme des histoires, comme de l'histoire ancienne ou même récente. Ici le récit fait intervenir des dieux, des héros fabuleux, des monstres; là simplement des personnages qu'on croit « historiques » : héros nationaux, ennemis de type humain. Dans les deux cas, pourtant, ils répondent aux mêmes besoins et méritent le même nom. Sur le domaine indo-européen, Rome, abstraction faite des influences grecques facilement décelables, représente à l'extrême ce type de mythologie à forme historique. Qu'on feuillette ce livre infiniment précieux, ce véritable traité de sociologie religieuse, sans équivalent dans l'antiquité classique, que sont les Fastes d'Ovide : chaque fête, chaque geste rituel y est justifié par un, deux, trois récits qui se présentent presque tous comme de l'histoire; ce sont pourtant des mythes, au même titre que ceux qu'on lit, malheureusement coupés de tout support rituel, dans la Théogonie d'Hésiode ou dans les « poèmes divins » de l’Edda.
4° Les mythes ne meurent pas toujours en même temps que disparaissent, sous des influences diverses, les formes de vie politique ou économique, les rites religieux qu'ils avaient d'abord contribué à maintenir. La mythologie irlandaise a ainsi survécu à la christianisation. Mais elle s'est tournée tantôt en légendes (liées à des noms historiques ou géographiques), tantôt en contes (anonymes), et si elle n'avait pas été, dès les premiers siècles de sa déchéance, consignée en lettres par des clercs heureusement attachés aux traditions, elle ne nous serait parvenue qu'éro-dée, banalisée, envahie aux trois quarts par les lieux communs du folklore international. C'est une grosse question de savoir si les thèmes des contes sont nés dans des temps très anciens de mythes dégénérés ou si, pour l'essentiel, ils représentent un genre de production imaginative qui a toujours été autonome. Mais à coup sûr cette vivace forme de littérature populaire, sous tous les climats, envahit sans délai, défigure et dévore les mythes dont une fonction sociale précise ne défend plus l'originalité. Le mythologue ne doit pas perdre de vue cette évolution; souvent, en effet, un texte lui livre un mythe déjà désaffecté mais dont la dégénérescence folklorique n'est qu'à un stade précoce.
5° Ce n'est que tardivement, littérairement, chez des peuples déjà pourvus de philologues ou bien dans les religions à dogmes impératifs, que l'on voit apparaître des corpus mythologiques, « une mythologie », où l'ensemble des mythes s'organise sans contradictions au prix de retouches et de compromis. Encore ces efforts restent-ils peu efficaces sur la religion vécue. Pourtant, et dans les milieux les plus arriérés, même en Australie, on est en droit de superposer la notion de « mythologie » à la pluralité des mythes : quelque contradictoires qu'ils soient en effet, ces derniers n'en restent pas moins solidaires; des êtres surnaturels de même groupe, de même type y apparaissent, les mêmes noms propres (de lieux, d'êtres, etc.) font la liaison d'un récit à l'autre, les mêmes institutions sociales et cosmiques, explicitement ou en filigrane orientent tous les récits; si les usagers ont confiance dans l'efficacité d'un mythe particulier, c'est, pour beaucoup, parce qu'ils sentent, parce qu'ils savent qu'il n'est pas isolé : une cohérence mouvante mais suffisante est maintenue d'autant plus facilement que, en chaque occasion, c'est un seul mythe qui a de l'importance, qui se récite avec détail, la masse de tous les autres composant en sourdine une orchestration utile mais nécessairement confuse. Ce sentiment de « choses du même genre, apparentées », suffit à constituer, au-dessus des mythes, une mythologie, un organisme dont on ne doit isoler les fragments qu'avec précaution.
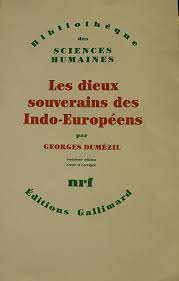
IV. — Point de départ : religions des Indo-Iraniens, des Celtes et des Italiotes.
L'unité de langue, disions-nous, suppose un minimum commun de civilisation, en particulier de religion. La matière de notre étude n'est donc pas illusoire : par la confrontation des équilibres religieux attestés dans les diverses sociétés parlant des langues indo-européennes, on peut espérer reconstituer au moins des fragments de l'ancienne religion commune, de la même manière que les linguistes, par la confrontation des grammaires et des vocabulaires du sanscrit, du grec, du latin, etc., reconstituent une bonne partie de l'indo-européen commun.
Il se pourrait cependant que cette matière fût inaccessible, et l'étude impossible; il se pourrait qu'en évoluant au sein des sociétés issues par fractionnement de la société préhistorique, l'ancien équilibre eût tellement changé que les traces du passé fussent imperceptibles ou méconnaissables; une langue étant moins sujette aux révolutions, aux réformes et refontes radicales qu'une religion, il se pourrait que, tout en continuant à parler deux formes encore fraternelles de l'indo-européen, les Indiens védiques et les Latins de Rome par exemple eussent entièrement renouvelé leurs systèmes de rites et de mythes, au point de ne pas laisser de prise à la comparaison.
De fait le « minimum initial de civilisation commune » s'est partout considérablement altéré lorsque les tribus indo-européennes, se dispersant aux quatre points cardinaux, de l'Atlantique au Turkestan, de la Scandinavie à la Crète et à l'Indus, se sont superposées ou mêlées à des allogènes dont la civilisation — nous pensons au monde égéen, à l'Asie antérieure, à Mohendjo Daro — les a conquises dans le temps même où, conquérantes, elles imposaient l'essentiel de leur langue.
Nulle part donc, nous pouvons en être certains, les religions historiquement attestées ne sont issues par simple et linéaire évolution de la religion indo-européenne. Partout nous nous trouvons vraiment en présence d'équilibres nouveaux, quelques-uns constitués pour la plus grande part de matériaux non indo-européens; les faits hérités de la préhistoire commune n'y sont plus que des survivances réduites ou déformées selon les nécessités de la perspective nouvelle. Découvrir ces faits dans leurs cachettes et sous leurs déguisements, n'est-ce pas un problème insoluble et même inabordable?
Ce n'est qu'un problème difficile. Et voici la circonstance particulière qui donne un moyen de l'aborder.
Entre l'unité indo-européenne préhistorique et les histoires, séparées, des Indiens, des Perses, des Scythes, des Grecs, des Latins, des Gaulois, des Irlandais, etc., l'examen des faits linguistiques a permis d'établir qu'il y a eu, en cours de migration et parfois jusque près du point d'arrivée, des unités partielles intermédiaires : il y a eu, par exemple, jusqu'à l'extrême Est, une unité indo-iranienne; jusqu'à l'extrême Ouest, une unité plus lâche rapprochant les futurs Celtes et les futurs Italiotes. Cela est capital : ce qu'on sait par l'archéologie de l'ancienne Europe non méditerranéenne et du sud de l'actuelle Russie donne à penser que, entre l'unité indo-européenne et ces unités partielles, les peuples en migration n'ont pas rencontré de « grande civilisation », ni donc de grands systèmes religieux comme il est arrivé ensuite plus au sud; il est donc probable que « la religion indo-européenne » n'a pas été, durant cette période, complètement bouleversée. Comme d'autre part ces unités partielles sont plus récentes, relativement proches même des premiers documents « séparés », il est probable que, en dépit des bouleversements qui ont suivi, les survivances observables du dernier état commun, les souvenirs, au moins quant au vocabulaire religieux, seront encore abondants et groupés, de sorte que l'ancien équilibre se laissera peut-être entrevoir sous le nouveau. C'est en particulier ce qui s'est vérifié pour l'unité partielle indo-iranienne : la religion de l’Avesta n'est pas celle des Veda; les correspondances de vocabulaire religieux (noms d'êtres divins, d'hommes, d'objets et d'actes sacrés, formules même) y sont pourtant très nombreuses et éclatantes. Or il est évident, quelle que soit la méthode de nos études, qu'un rôle très important y sera joué par le recensement et le classement des correspondances de vocabulaire. Le fait qu'on puisse atteindre, et presque sans effort, un vocabulaire religieux indo-iranien considérable est rassurant.
Il y a mieux. Une des chances, la meilleure chance peut-être de nos études est le fait, remarqué d'abord par M. Kretschmer puis mis en pleine valeur par M. Vendryes (Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, XX, 1918, pp. 265-285), que d'assez nombreux mots relatifs à la religion apparaissent à la fois chez les Italiotes, chez les Celtes, et dans le groupe indo-iranien, et n'apparaissent que là. Des termes mystiques comme ceux qui désignent la « foi » dans l'efficacité de l'acte sacré, la pureté rituelle et morale, l'exactitude rituelle, l'offrande au dieu et l'agrément du dieu, la protection divine, la prospérité, le mot signifiant la récitation des formules, des noms d'hommes chargés de fonctions sacrées ne se rencontrent ainsi que sur les bords opposés du vaste domaine recouvert par les langues indo-européennes. Cette singulière distribution s'explique, ainsi que l'a indiqué M. Vendryes, par une concordance non plus linguistique mais sociologique ; alors que chez les autres peuples de la famille les prêtres n'ont dans la société qu'un rôle mineur, un rôle « d'ouvriers » parmi les autres, les brahmanes indiens, les mages iraniens, les druides celtiques, le collège pontifical (flamines et pontifes) à Rome constituent autant de puissants corps sacerdotaux, dépositaires intéressés des traditions; qu'on pense au vaste effort de mémoire requis des jeunes brahmanes et des élèves druides.
Cette circonstance assure que des survivances de la plus vieille unité existent, qu'elles sont directement connaissables. Elle met le linguiste en état de signaler au sociologue des notions qui, désignées ici et là par les mêmes mots anciens, ont chance de contenir encore en partie la même ancienne matière.
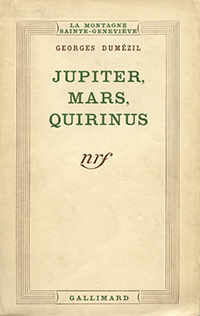
V. — Le problème des cadres sociaux et religieux.
Appuyée à ce point fixe, la nouvelle mythologie comparée a fait depuis vingt ans ses premières prospections. D'abord incertaines et maladroites, elle les a rectifiées, assurées et réunies dans une synthèse déjà vaste où les vues particulières se contrôlent réciproquement et qui ne paraît pas artificielle à de bons esprits.
Les faits les plus apparents, ceux qui ont vite concentré sur eux la recherche, sont relatifs à la « Souveraineté ». Nous entendons par là l'ensemble des rites et des mythes relatifs à l'administration magique et juridique du monde et de la société, aux grands dieux célestes et aux rois leurs représentants, ainsi qu'aux ministres mythiques et aux prêtres ou magistrats terrestres qui assistent les Souverains dans leur office. Il semble en effet que les divers peuples indo-européens, du moins ceux chez qui ont survécu de grands corps sacerdotaux, aient gardé avec une fidélité particulière ce qui, dans la religion, concernait ces fonctions présidentielles et directrices (1).
Mais il ne faut pas oublier qu'une religion — et ces deux mots se sont déjà rencontrés plusieurs fois dans l'exposé qui précède — est un système, un équilibre. Elle n'est pas faite de pièces et de morceaux assemblés au hasard, avec des lacunes, des redondances et des disproportions scandaleuses. Si nous osions risquer après tant d'autres une définition, toujours extérieure, nous dirions qu'une religion est une explication générale et cohérente de l'univers soutenant et animant la vie de la société et des individus. Si donc on ne veut pas se méprendre grossièrement sur la forme, l'ampleur et la fonction propre de tel ou tel d'entre les rouages d'une religion, il est urgent de le situer avec précision par rapport à l'ensemble. Quitte à retoucher ensuite cette première image, il faut dessiner d'abord les lignes maîtresses de toute l'architecture religieuse qu'on étudie ou qu'on reconstitue. Sinon, n'importe quel dieu étant plus ou moins amené à s'occuper de toutes les provinces de la vie humaine, on risque d'attribuer essentiellement à celui, quel qu'il soit, qu'on étudiera ce qui ne lui appartient qu'accidentellement; on le centrera sur la marge de son domaine ou même au delà et l'on méconnaîtra au contraire sa destination fondamentale. Bref, contrairement à une illusion fréquente, contrairement à un précepte de fausse prudence fort révéré, les monographies ne peuvent être constituées avec quelque assurance que lorsque l’ordre d'ensemble a été reconnu. Ou, si l’on préfère une formule plus modérée, il faut pousser parallèlement, l’une corrigeant sans cesse et améliorant l'autre, l'étude du cadre et celle des détails, l'étude de l'organisme et celle des tissus.
Nous avons senti vivement cette nécessité en plus d'un point de nos études sur les dieux souverains, et aussi à la lecture d'excellents livres récemment publiés en Allemagne et en Suède sur la même question (2). Faute de situer exactement le « Souverain » parmi les rouages politiques et parmi les représentations religieuses des Indo-Européens, nous nous sommes sentis portés, et nous avons vu les autres portés à élargir indéfiniment son domaine propre, ce qui n'est certes pas entièrement illégitime puisque le dieu souverain, en dernière analyse, a regard et entrée partout, mais ce qui fausse la juste perspective puisque, à partir de certaines limites, dans certaines zones, il n'agit qu'en interférence ou en collaboration avec d'autres spécialistes divins plus immédiatement intéressés, alors que, dans sa zone centrale, il opère directement. Dans le temps même où nous traitions de Varuna comme dieu souverain, on a pu écrire ailleurs un gros traité sur les activités agraires et économiques du même personnage; et l'on n'avait pas tort; mais où est le centre propre de Varuna? Est-ce dans la souveraineté ou dans la fécondité qui, elle, ne manque pas de représentants divins qualifiés? Chez les Germains, Odhinn semble patronner à la fois les magiciens, la royauté, une partie des activités guerrières, et plusieurs auteurs ont insisté davantage sur son affinité avec l'agriculture : derechef, où est son centre. Inversement, n'importe quel dieu spécialiste, dans certaines circonstances, sort de son domaine, prend même des airs de dieu souverain : c'est ainsi que Mars bellator, s'occupe aussi des champs et du bétail au point que quelques historiens de la religion romaine font de l'élevage et de l'agriculture sa fonction primaire, tandis que d'autres, se fondant sur des faits considérables, voient en lui, en Mars Pater, le plus ancien « grand dieu » italique dont Jupiter n'aurait que tardivement usurpé quelques activités : ici encore, où est le centre.
Ces incertitudes et beaucoup d'autres analogues nous ont conduit à essayer de fixer, avant toute nouvelle enquête de détail, les cadres généraux et les grandes articulations de la religion indo-européenne. Et comme, chez les demi-civilisés, la conception du monde et celle de la société, la hiérarchie des dieux et celle des hommes sont le plus souvent parallèles, cette recherche revient à définir, à la fois et indifféremment, comment les Indo-Européens concevaient la division et l'harmonie de leur corps social et comment ils ajustaient les provinces de leurs principaux dieux.
GEORGES DUMÉZIL 
Notes :
(1) Voir nos essais Ouranos-Varuna, 1934 (A. Maisonneuve); Flamen-Brahman, 1935 (Geuthner); Mitra-Varuna, essai sur deux représentations indo-européennes de la Souveraineté, 1940 (Leroux); Jupiter, Mars, Quirinus, essai sur la conception indo-européenne de la Société et sur les origines de Rome, 1941 (Editions de la N. R. F.)-
(2) H. Güntert, Der arische Weltkönig und Heiland, Halle, 1923; H. Lommel, Die alten Arier, von Art und Adel ihrer Gôtter, Frankfurt a. M., 1935; G. Widengren, Hochgottglaube im alten Iran, Upsal et Leipzig, 1938.
Sources : La Nouvelle Revue Française – 1er octobre 1941
- Détails
- Catégorie : Georges Dumézil
- Clics : 3017

Article inédit qui reprend en partie le texte d'une lecture faite le 13 mai 2002 à Bruxelles lors d'une séance publique de la Classe des Lettres de l'Académie royale de Belgique. L'intégralité de l'exposé est parue dans le Bulletin de la Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques de l'Académie Royale de Belgique, 2002, p. 163-187.
Louvain-la-Neuve, le 7 juin 2002.
Plan
- I. Les Indo-Européens, Georges Dumézil et l'idéologie trifonctionnelle
- II. Georges Dumézil et l'héritage indo-européen dans la religion romaine
- Notes
L'exposé de cet après-midi va nous entraîner dans un passé très lointain, celui des Indo-Européens et celui des Romains, deux mondes qui, à des titres divers, ont contribué indirectement à la formation de notre Occident moderne.
Dans cette promenade, nous aurons comme guide un éminent savant français, Georges Dumézil, mort en 1986. Il avait été reçu à l'Académie française en 1979, mais en 1958 déjà, la Classe des Lettres de l'Académie royale de Belgique l'avait élu membre associé, anticipant de plus de vingt ans la décision française.
I. Les Indo-Européens, Georges Dumézil et l'idéologie trifonctionnelle
Les Indo-Européens. Peut-être n'est-il pas inutile d'évoquer rapidement ces ancêtres très éloignés. Faisons ensemble un bond en arrière, de plusieurs millénaires, sans entrer toutefois dans le détail d'une question complexe dont plusieurs aspects sont toujours âprement discutés. Nous nous en tiendrons à l'essentiel, en restant fidèle au modèle centrifuge et diffusionniste qui est encore le modèle dominant.
Ainsi donc, selon le schéma « classique », on désigne par Indo-Européens une population qui aurait vécu dans un passé très lointain que quelques savants feraient même remonter jusqu'au Ve millénaire avant Jésus-Christ, et qui trouverait son origine dans la vaste plaine russe. À une certaine époque (IIIe/IIe millénaire avant Jésus-Christ), pour des raisons et selon des modalités précises inconnues, les Indo-Européens se seraient répandus dans toute une série de directions, le processus exact d'expansion restant peu clair. Quoi qu'il en soit, au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, ils se signalent en Anatolie (ce sont les Hittites), en Grèce (ce sont les Mycéniens), en Italie (ce sont les Latins et de nombreux autres peuples de la péninsule). Les futurs Indiens sont sur l'Indus dans le même temps, mais les Scandinaves par exemple - qui sont eux aussi des Indo-Européens - n'occuperont l'Islande qu'au dixième siècle de notre ère [1].
Latins, Grecs, Celtes, Germains, Slaves, Scandinaves, Scythes, Indiens, Iraniens, tous ces peuples anciens (et bien sûr les peuples actuels qui les prolongent) sont de lointains descendants de ces Indo-Européens. Mais - la précision est d'importance - c'est de langues qu'il est ici question. C'est sur le plan linguistique que nous sommes parents des Grecs, des Anglais, des Russes, des Iraniens ou des Indiens ; sur le plan linguistique toujours que nous ne sommes pas apparentés aux Basques, aux Hongrois, aux Turcs, ou aux Tunisiens, qui ne parlent pas des langues indo-européennes.
Bref, le monde indo-européen forme une communauté linguistique. C'est un des acquis et une des gloires de la grammaire comparée du XIXe siècle de l'avoir démontré, avec une rigueur et une précision qui ne laissent pas la moindre place au doute.
Mais cette parenté linguistique étant reconnue depuis le XIXe siècle, qu'est donc venu faire G. Dumézil dans le champ des études indo-européennes ?
Pour répondre à cette question d'une manière schématique, on dira que le savant français a tenté de prolonger le travail de la grammaire comparée, en passant du domaine de la linguistique à celui de la pensée, de la mentalité, de l'idéologie. En effet, c'est moins les langues, que l'univers mental, conceptuel, qui intéresse G. Dumézil.
Cet univers, il va tenter de l'atteindre en étudiant la culture des différents peuples issus des Indo-Européens, et tout particulièrement les manifestations essentielles de ces cultures, que sont les religions, les mythologies et les littératures. Le corpus qu'il prit en considération est extraordinairement vaste, puisqu'il couvre aussi bien les sociétés nordiques que la Rome et la Grèce antique, aussi bien l'Inde que le Caucase, sa recherche se faisant sur des textes aussi différents (pour donner quelques exemples) que les hymnes védiques, le Mahabharata, les eddas scandinaves, le cycle mythologique irlandais, l'épopée narte des Ossètes, ou le récit de Tite-Live sur la Rome royale.
Il ne m'est pas possible de m'étendre sur les résultats de recherches, qui ont duré près de soixante années et qui ont donné naissance à environ 17.000 pages (plusieurs centaines d'articles et quelque soixante livres). Pour aller à l'essentiel, je dirai simplement que G. Dumézil a cru pouvoir retrouver dans l'univers conceptuel des Indo-Européens deux choses, d'une part un cadre particulier d'analyse, c'est-à-dire une certaine vision générale du monde ; d'autre part des conceptions spécifiques.

Un cadre particulier d'analyse
Le cadre particulier d'analyse, d'abord. C'est ce qu'on appelle aussi la trifonctionnalité indo-européenne, ou encore l'idéologie tripartie des Indo-Européens.
De quoi s'agit-il ? Schématiquement, on dira que chez les Indo-Européens, les principaux rouages du monde et de la société (divine ou humaine) étaient compris, analysés, classés par référence à trois domaines, trois grands secteurs, que le savant français a appelés du terme, ambigu et peut-être peu heureux, de « fonctions ». Ces fonctions que G. Dumézil voyait distinctes, mais complémentaires et harmonieusement ajustées, sont, en ordre décroissant de dignité :
- une fonction de souveraineté (la première), qui assure le gouvernement et qui entretient les rapports de la société avec les dieux. Elle est liée au pouvoir politique et à l'administration du sacré. Elle est par ailleurs susceptible de présenter deux faces : l'une, violente, terrible, inquiétante, magique ; l'autre, paisible, rassurante, juridique, conservatrice ;
- une fonction (la deuxième) liée à la force physique, à la vaillance, à l'attaque, à la défense, à la science militaire, à la puissance guerrière : c'est la fonction guerrière ;
- enfin (la troisième), une fonction de fécondité et de prospérité, beaucoup plus large que les deux autres, valable pour les humains, les animaux, les champs. Elle veille au maintien de la vie et à la production des biens qui lui sont nécessaires. Elle comporte toutes sortes de conditions et de conséquences, ainsi notamment la richesse, l'agriculture, l'élevage, l'alimentation, la reproduction, la paix, le plaisir, le bien-être de tous. Elle intègre aussi les notions qui s'y rattachent, par exemple la santé, la beauté, la jeunesse, la volupté.
Ces trois fonctions correspondent bien sûr à trois besoins fondamentaux, qu'on pourrait appeler universels, qui sont partout, pour tous les peuples, l'essentiel. Mais la plupart des groupes humains se bornent à les satisfaire, sans plus. Les Indo-Européens, eux, sont allés plus loin : cette tripartition fonctionnelle leur servait en effet de cadre conceptuel, de moyen d'analyser et de comprendre ; c'est en quelque sorte pour eux un système de référence, un schéma classificateur. On est, il importe de bien le préciser, dans le domaine de l'imaginaire [2].
Des conceptions spécifiques
Outre cette grille d'analyse à trois entrées, le comparatiste français a également identifié nombre de conceptions spécifiques d'origine indo-européenne. Ces conceptions n'ont pas de référence nécessaire et obligée à la tripartition fonctionnelle, elles peuvent concerner toutes sortes de choses (je cite en vrac) : la fin du monde, les risques de la fonction guerrière, les fêtes et les rituels, la lumière nocturne et diurne, le mariage. Toutes nous introduisent dans la mentalité de nos lointains ancêtres.
Bref, une idéologie tripartie, centrale, à longue portée pourrait-on dire, et nombre de conceptions portant sur des aspects plus pratiques de la vie et de l'existence ; G. Dumézil nous a ainsi permis de mieux connaître l'univers conceptuel des Indo-Européens, leur manière de concevoir et d'imaginer le monde, leur idéologie en quelque sorte. Mais passons à la Rome ancienne.
La Rome ancienne n'est qu'un des multiples chantiers ouverts par G. Dumézil, mais c'est lui qui nous retiendra cet après-midi. La question se pose en effet de savoir ce que le savant français, explorateur éminent du vaste univers indo-européen, a apporté de précis et de précieux aux spécialistes de la Rome ancienne. En d'autres termes la Rome ancienne a-t-elle hérité des Indo-Européens autre chose que sa langue ? Y a-t-il à Rome un héritage indo-européen non linguistique ?
À ces questions, G. Dumézil a répondu « oui » : il a réussi à identifier un héritage indo-européen dans la religion et dans l'histoire, plus exactement dans la religion romaine archaïque d'une part et, d'autre part, dans les récits des historiens racontant les origines et les premiers siècles de la Ville.
Dans la suite de cet exposé, je traiterai surtout de religion, renvoyant à un autre article le développement qui concerne l'histoire.
II. Georges Dumézil et l'héritage indo-européen dans la religion romaine
L'apport de G. Dumézil à notre connaissance de la religion romaine [3] est considérable, mais ses travaux ne nous aident guère à comprendre en profondeur la religion romaine dans son évolution historique, c'est-à-dire sous la République et sous l'Empire : ils ne concernent que la période archaïque, c'est-à-dire celle des origines.
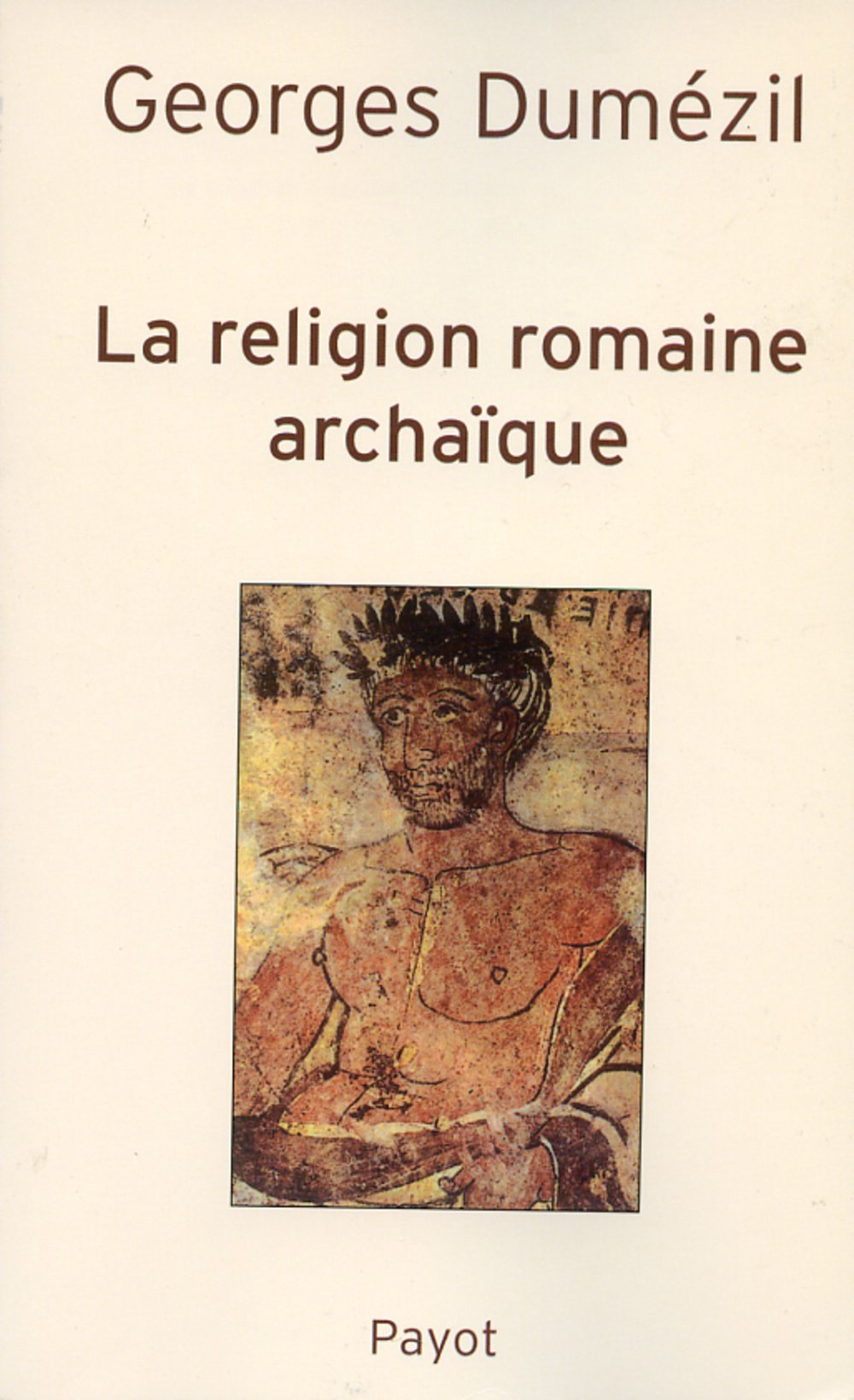
Dans ce secteur précis, le comparatiste français a pris nettement position, avec raison, contre la théorie du numen-mana : il a montré en effet que les divinités romaines étaient depuis le début des personnalités déjà bien constituées et non des entités vagues en formation. Faisant intervenir de nombreux parallèles indo-européens, il s'est également intéressé d'une manière heureuse aux déesses latines, aux parèdres des dieux majeurs, à la foule des petites divinités archaïques du type Flora, Furrina, Vacuna, Palès, Carna, et à bien d'autres réalités religieuses encore, qu'il s'agisse de fêtes, de rituels ou de conceptions de base.
Mais sans négliger l'intérêt de toutes ses découvertes, il faut bien reconnaître qu'en matière religieuse, l'héritage indo-européen, comme tel, ne se manifeste plus à Rome que sous l'aspect de fossiles [4]. Je me limiterai à trois exemples, tournant autour des rites et des dieux.
La triade précapitoline des flamines majeurs (Jupiter, Mars et Quirinus)
Tous les amateurs d'antiquités romaines connaissent le temple de Jupiter sur le Capitole où les Romains vénéraient non pas une, mais trois divinités : Jupiter, Junon et Minerve. En réalité, cette triade capitoline, qui s'était formée à Rome même, avait été précédée d'une autre triade, dite précapitoline, qui rassemblait Jupiter, Mars et Quirinus, et qui était, elle, d'origine indo-européenne. Cette très vieille structure n'est plus vivante à Rome, sinon dans l'existence même d'un groupe de prêtres, les trois flamines majeurs, et comme « pivot » autour duquel s'articulent en filigrane un certain nombre d'entités divines. Cet héritage indo-européen, fossilisé à l'époque historique, reflète la tripartition fonctionnelle de l'ensemble du panthéon indo-européen.
Dans cette structure, Jupiter, le dieu-roi (rex deorum) relève de la première fonction, celle de la souveraineté ; Mars, de la seconde (Mars est le dieu de la guerre) ; Quirinus, dont les liens avec le grain sont nets si l'on se réfère aux offices religieux dans lesquels intervient son flamine, relève de la troisième fonction (fécondité et prospérité).
Cette vieille triade romaine a son correspondant dans la triade ombrienne : Jupiter, Mars et Vofionus, connue par les Tables de Gubbio [5]. Elle répond aussi aux listes-types qu'on observe en Scandinavie : Odhinn-Tyr (les deux aspects de la première fonction), Thorr (deuxième fonction) et Freyr (troisième fonction), tout comme dans l'Inde védique et prévédique : Mitra-Varuna (les deux aspects de la première fonction), Indra (deuxième fonction), et les jumeaux Nasatya ou Ashvin (troisième fonction). Toutes ces listes divines, de type formulaire, synthétisent les trois fonctions, ordonnant en quelque sorte le panthéon divin. Mais redisons-le, à Rome, le groupe Jupiter, Mars, Quirinus n'est plus qu'un fossile. C'est la triade capitoline, Jupiter, Junon et Minerve, qui est importante.
Le rituel des Matralia
On retrouve aussi l'héritage indo-européen dans des rites [6]. Voici l'exemple d'une fête religieuse romaine, les Matralia. Elle était célébrée en l'honneur de Mater Matuta, nom divinisé de l'Aurore, le 11 juin, au moment où l'on approche du solstice d'été et où les jours atteignent leur durée la plus longue.
Pendant très longtemps, cette fête et le rituel qui l'accompagnait n'ont semblé offrir aucune prise à une élucidation satisfaisante et faisaient l'objet de discussions contradictoires parmi les savants modernes. Quels étaient donc ces rites singuliers, difficilement compréhensibles ? Ils étaient au nombre de deux.
Dans le premier, les matrones romaines portaient dans leurs bras, pour les choyer, non pas leurs propres enfants, mais les enfants de leurs soeurs ; dans le second, elles faisaient entrer dans le temple de Mater Matuta une servante qu'elles battaient ensuite de verges avant de la jeter dehors.
Ces rites étranges, qui ne comportent aucune explication dans le contexte romain ou même gréco-romain, G. Dumézil les a éclairés par une confrontation avec la mythologie védique de l'Inde.
Le Rig-Veda en effet présente la déesse Aurore (Usas) allaitant et léchant l'enfant « de sa soeur la Nuit », enfant qui n'est rien d'autre, toujours dans la mythologie védique, que le Soleil.
Tout se passe comme si Rome avait conservé de son héritage indo-européen un théologème élémentaire, à savoir : « l'Aurore choyant l'enfant de sa soeur la Nuit ». Mais en l'occurrence à Rome le mythe - l'explication en quelque sorte - a disparu ; seul a survécu le rite, qui prescrit aux matrones le comportement de la divinité. Les mères romaines font donc avec les enfants de leurs soeurs ce que, pour la mythologie védique, l'Aurore, soeur de la Nuit, fait avec le Soleil, enfant de la Nuit.
Le second rite, celui de l'expulsion de la servante, s'explique également par le parallélisme védique. Dans les hymnes védiques, la déesse Aurore, en marchant, refoule par la lumière les ténèbres et l'ensemble des dangers, car les ténèbres sont assimilées à l'ennemi, au barbare, au démoniaque, au mal. C'est ce que miment dans les Matralia les matrones romaines sévissant « contre une esclave qui doit représenter, par opposition à elles-mêmes, l'élément mauvais et mal né ».
Les Matralia fournissent ainsi un exemple révélateur de la conservation du rite indépendamment du mythe. Les gestes romains ne prennent leur sens que par la comparaison avec la mythologie védique. Mais cette pratique étrange que G. Dumézil a rendue compréhensible par le recours aux sources védiques n'est plus dans la religion romaine qu'un fossile que les Romains eux-mêmes d'ailleurs ne comprenaient plus. Les explications qu'ils proposaient et qui faisaient intervenir la mythologie grecque, loin d'éclaircir les choses, les rendaient plus obscures encore.

Les « hôtes entêtés » de Jupiter
L'existence même de la triade précapitoline et le curieux rituel des Matralia sont deux exemples de cet héritage indo-européen. En voici un troisième, celui des « hôtes entêtés » de Jupiter [7]. Tout comme dans le cas des Matralia, la comparaison indo-européenne est seule susceptible d'apporter la solution adéquate.
Nous sommes sous le règne des Tarquins (l'Ancien ou le Superbe, selon les versions). Et le récit traditionnel [8] contient une bien curieuse notice, qui concerne les divinités Terminus (littéralement en latin « la borne, la limite ») et Juventas (littéralement « la jeunesse »). Lorsqu'il est question de construire le grand temple du Capitole, ces deux divinités « refusent » de céder à Jupiter l'emplacement qu'elles occupaient sur la colline et dont on aurait besoin pour la construction. Qu'à cela ne tienne, on ne les obligera pas à bouger, on leur réservera un autel à chacune, dans le temple même.
Le sens profond de cette étroite alliance n'apparaît qu'à la comparaison, une fois Terminus et Juventas reconnus comme les homologues romains des « souverains mineurs », Bhaga et Aryaman, lieutenants de Mitra. Bhaga, c'est la « part » personnifiée et divinisée, qui patronne la juste répartition des biens dans la société. Aryaman, c'est le patron des « arya » (« les hommes au sens noble du terme »), le patron donc des personnes qui constituent la société.
G. Dumézil a montré que Terminus et Juventas correspondaient avec précision à ces deux figures védiques, étroitement associées à Mitra. Juventas contrôle l'entrée des jeunes Romains dans la société des hommes, et les protège tant qu'ils sont dans l'âge le plus intéressant pour l'État. Terminus, pour sa part, marque et patronne la répartition des propriétés, non plus mobilières (principalement les troupeaux), comme dans le cas de Bhaga, mais foncières, comme il est normal dans une société sédentaire.
Ainsi une conception théologique indo-européenne, dont on retrouve d'ailleurs aussi la trace dans des transpositions zoroastriennes et dans l'Irlande paléochrétienne, a-t-elle été traduite en une anecdote pseudo-historique, intégrée dans la geste de Tarquin, et interprétée par les Romains comme un présage de stabilité (Terminus) et de jeunesse (Juventas) éternelles pour leur Ville.
Notes
[1] D'après G. Dumézil, Entretien avec Didier Éribon, Paris, 1987, p. 110-111 (Folio. Essais, 51). Ajoutons qu'il faudra attendre des siècles encore pour que l'espagnol et le portugais, eux aussi des langues indo-européennes, soient parlés en Amérique centrale et en Amérique latine. - Pour une bibliographie un peu plus détaillée sur les Indo-Européens, on se reportera à J. Poucet, Les Rois de Rome. Tradition et histoire, Bruxelles, 2000, p. 373-375 (Académie Royale de Belgique. Mémoires de la Classe des Lettres. Collection in-8°, 3e série, tome 22).
[2] Il faut insister sur ce point, une des erreurs initiales de G. Dumézil (il l'a reconnu lui-même) étant précisément d'avoir confondu « imaginaire » et « réalité sociale », d'avoir cru que ce qu'il repérait dans l'imaginaire s'incarnait concrètement dans la société. Ce problème crucial du rapport entre l'imaginaire et la réalité a été après bien d'autres posé par A. Schiavone, I saperi della città, dans A. Momigliano, A. Schiavone [Éd.], Storia di Roma. I. Roma in Italia, Turin, 1988, p. 561, n. 41 : « La grande question ouverte (et non résolue par G. Dumézil) est la compréhension et la description des rapports qui devaient s'instaurer entre ces représentations imaginaires (dont, jusqu'à preuve contraire, il faut postuler une cohérence seulement interne) et les niveaux de réalité (sociaux, productifs, de pouvoir) : selon une échelle de possibilité qui va du simple reflet idéal d'une forme matérielle déjà solidement constituée en elle-même (le Dumézil première manière), à l'intégration complexe entre structures de pensée et données sociales dans un système à plusieurs centres (c'est le modèle de Marx dans les Grundrisse), jusqu'à l'hypothèse d'une déconnexion et d'une absence de correspondance entre les différents plans : signes de blessures, de ruptures et de contradictions encore plus profondes et cachées ». - L'évolution de la recherche de G. Dumézil en général et sur ce point particulier de l'imaginaire est remarquablement étudiée par D. Dubuisson, Mythologies du XXe siècle (Dumézil, Lévi-Strauss, Éliade), Lille, 1993, p. 21-128 (Racines et Modèles).
[3] On trouvera les vues de Georges Dumézil essentiellement dans La religion romaine archaïque, 2e éd., Paris, 1974, 700 p. (Bibliothèque historique Payot) [1ère éd. 1966] et dans Fêtes romaines d'été et d'automne. Suivi de Dix Questions Romaines, Paris, 1975, 298 p. (Bibliothèque des Sciences humaines). - Pour un point de vue critique ouvert et récent, on pourra se reporter à l'analyse de E. Montanari, Georges Dumézil e la religione romana arcaica, dans J. Ries et N. Spineto [Éd.], Esploratori del pensiero umano. Georges Dumézil e Mircea Eliade, Milan, 2000, p. 51-102 (Di fronte e attraverso, 539). Dans le même ouvrage collectif, on verra également D. Briquel, Sul buon uso del comparativismo indoeuropeo in materia di religione romana, p. 25-50. - La deuxième édition de J. Scheid, Religion et piété à Rome, Paris, 2001, 192 p., contient aussi quelques pages intéressantes (p. 95-117 intitulées « Comment lire Dumézil »), reprises à l'édition de 1985 et qui ont conservé tout leur intérêt.
[4] A. Grandazzi, La fondation de Rome. Réflexions sur l'histoire, Paris, 1991, p. 66 (Histoire), évoque « des rituels comme celui du Cheval d'Octobre, de la déesse de l'Aurore, Mater Matuta, et surtout les indéniables analogies entre le flamen romain et le brahman indien ». Il y voit des « éléments dispersés et résiduels », qui cependant « attestent assez la réalité de cet héritage ».
[5] On désigne ainsi sept plaques de bronze, découvertes en 1444 à Gubbio (Italie), portant un texte en ombrien qui renseigne sur les rites et les cultes de cette petite ville ombrienne, avant que sa religion ne s'efface sous la pression romaine. Ombriens, Osques et Latins sont étroitement apparentés, leurs langues faisant partie de ce qu'on appelle les dialectes italiques.
[6] Cf. par exemple G. Dumézil, Mythe et épopée. III. Histoires romaines, Paris, 1973 (Bibliothèque des Sciences humaines), p. 305-330 (« Mater Matuta ») et, en résumé, La religion romaine archaïque, Paris, 1974, p. 63-75 (« La mythologie perdue : l'exemple des Matralia »).
[7] G. Dumézil, La religion romaine archaïque, Paris, 1974, p. 210-213 ; Les dieux souverains des Indo-Européens, Paris, 1977, p. 168-182 (Bibliothèque des Sciences humaines).
[8] Tite-Live, I, 55, 2-3 ; Denys d'Halicarnasse, III, 69, 5-6 ; Florus, I, 7, 9.
Jacques Poucet
Professeur émérite de l'Université de Louvain et des Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles) ; Membre de l'Académie royale de Belgique
Sources : FEC - Folia Electronica Classica (Louvain-la-Neuve) - Numéro 3 - janvier-juin 2002 folia
- Détails
- Catégorie : Georges Dumézil
- Clics : 10462
- Détails
- Catégorie : Georges Dumézil
- Clics : 9324
- Détails
- Catégorie : Georges Dumézil
- Clics : 9431
- Détails
- Catégorie : Georges Dumézil
- Clics : 8958
