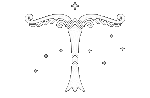Alors que pestes, famines et guerres ravagent l'Occident à la fin du Moyen Age, la peur du diable et de ses œuvres s'installe dans la littérature et l'art des premiers temps de la Renaissance. C'est alors que, sous l'impulsion de l'Église, la femme, depuis toujours «sanctuaire de l'étrange», devient peu à peu symbole du péché et «porte du diable». Jean Delumeau, auteur de La Peur en Occident (Fayard), a recherché les origines de cette obsession, qui entraînera entre le XIVe et le XVIIIe siècle, de meurtrières chasses aux sorcières.
Le Moyen Age a exalté Marie et lui a consacré d'immortelles œuvres d'art ; il a, d'autre part, inventé l'amour courtois qui a réhabilité l'attrait physique, placé la femme sur un piédestal au point d'en faire la suzeraine de l'homme amoureux et le modèle de toutes perfections. Le culte marial et la littérature des troubadours ont eu des prolongements importants et ont peut-être contribué dans la longue durée à la promotion de la femme. Mais dans la longue durée seulement.
Pétrarque et le mariage 
Car au Moyen Age ne furent-ils pas interprétés et utilisés comme une sorte de mise à l'écart, hors d'atteinte, de personnages féminins exceptionnels, nullement représentatifs de leur sexe ? L'exaltation de la Vierge Marie eut pour contrepartie la dévaluation de la sexualité. Quant à la littérature courtoise, elle ne parvint pas, même en Occitanie, sa terre d'élection, à changer les structures sociales. En outre, elle contenait en elle-même une évidente contradiction. Certes, le fin’amors (l'amour pur) accordait l'initiative aux dames et constituait une manière de triomphe sur une misogynie quasi universelle, sans nier pour autant la sexualité. L'asag - c'est- à-dire «la mise à l'épreuve», avec nudité des partenaires, embrassements, caresses et attouchements, mais refus de l'orgasme masculin — constituait finalement une technique érotique et un éloge du plaisir qui rompaient avec le naturalisme vulgaire et hostile à la femme du second Roman de la Rose. Mais si l'amour courtois sublimait et même divinisait telle ou telle femme exceptionnelle et une féminité idéale, en contrepartie il abandonnait à leur sort l'immense majorité des personnes du «deuxième sexe». De là les palinodies du clerc André Le Chapelain qui, dans le De amore (vers 1185), après deux livres où il chante les mérites de la dame et la soumission de l'amant, se lance dans une furieuse diatribe contre les vices féminins. De là encore - tandis que l'on glisse de l'amour courtois à l'amour platonicien - l'étrange paradoxe d'un Pétrarque amoureux de Laure, angélique et irréelle, mais allergique aux soucis quotidiens du mariage et hostile à la femme réelle, réputée diabolique :
«La femme… est un vrai diable, une ennemie de la paix, une source d'impatience, une occasion de disputes dont l'homme doit se tenir éloigné s'il veut goûter la tranquillité... Qu'ils se marient, ceux qui trouvent de l'attrait à la compagnie d'une épouse, aux étreintes nocturnes, aux glapissements des enfants et aux tourments de l'insomnie... Pour nous, si c'est en notre pouvoir, nous perpétuerons notre nom par le talent et non par le mariage, par des livres et non par des enfants, avec le concours de la vertu et non avec celui d'une femme.»
Bel aveu d'égoïsme misogyne qui prouve, dans le cas du «premier hom¬me moderne» de notre civilisation, le faible impact de l'amour courtois sur la culture dirigeante, encore dominée par les clercs.
A quoi ne pensera-t-elle pas ?
C'est précisément à l'époque de Pétrarque que la peur de la femme s'accroit dans une partie au moins de l'élite occidentale. Tandis que s'additionnent pestes, schismes, guerres et crainte de la fin du monde - une situation qui s'installe pour trois siècles - les plus zélés des chrétiens prennent conscience des multiples dangers qui menacent l'Église. Les périls identifiables étaient divers, extérieurs et intérieurs. Mais Satan était derrière chacun d'eux. Dans cette atmosphère chargée d'orages, prédicateurs, théologiens et Inquisiteurs désirent mobiliser toutes les énergies contre l'offensive démoniaque. En outre, plus que jamais ils veulent donner l'exemple. Leur dénonciation du complot satanique s'accompagne d'un douloureux effort vers plus de rigueur personnelle. Des êtres sexuellement frustrés qui ne pouvaient pas ne pas connaître des tentations projetèrent sur autrui ce qu'ils ne voulaient pas identifier en eux-mêmes. Ils posèrent devant eux des boucs émissaires qu'ils pouvaient mépriser et accuser à leur place.
Avec l'entrée en scène au XIIIe siècle des ordres mendiants, la prédication prit en Europe une importance extraordinaire, dont nous avons maintenant quelque mal à mesurer l'ampleur. Et son impact s'accrut encore à partir des deux Réformes, protestante et catholique. Même si la plupart des sermons d'autrefois sont perdus, ceux qui nous restent laissent assez deviner qu'ils furent souvent les véhicules et les multiplicateurs d'une misogynie à base théologique : la femme est un être prédestiné au mal. Aussi n’apprend-on jamais assez de précautions avec elle. Si l'on ne l'occupe pas à de saines besognes, à quoi ne pensera-t-elle pas ?
Amazones du diable

Dans les ouvrages du prédicateur alsacien Thomas Murner, principalement la Conjuration des fous et la Confrérie des fripons - tous deux de 1512 - l'homme n'est certes pas ménagé, mais la femme est plus encore vilipendée. D'abord, elle est un «diable domestique» : à l'épouse dominatrice, il ne faut donc pas hésiter à appliquer des raclées - ne dit-on pas qu'elle a neuf peaux ? Ensuite, elle est communément infidèle, vaniteuse, vicieuse et coquette. Elle est l'appât dont Satan se sert pour attirer l'autre sexe en enfer : tel fut pendant plusieurs siècles un des thèmes inépuisables des sermons.
Pour Maillard, la traîne des longues robes «achève de faire ressembler la femme à une bête, puisqu'elle lui ressemble déjà par sa conduite». Et «les riches colliers, les chaînes d'or bien attachées à son col» marquent «que le diable la tient et l'entraîne avec lui, liée et enchaînée». Les dames de son temps, ajoute-t-il, aiment lire des «livres obscènes qui parlent des amours déshonnêtes et de la volupté, au lieu de lire dans le grand livre de la conscience et de la dévotion». Enfin, leurs «langues... babillardes causent de grands maux». Quant à Glapion, confesseur de Charles Quint, il refuse de prendre en considération le témoignage de Marie-Madeleine sur la résurrection de Jésus : «Car la femme, entre toutes créatures, est variable et muable, parquoy elle ne poulroit assez prouver contre les ennemis de notre foy» - transposition sur le plan théologique de la sentence des juristes : «Les femmes - devant les tribunaux - sont toujours moins croyables que les hommes».
Au long des siècles, les litanies antiféministes récitées par les prédicateurs ne varieront guère que dans la forme. Au XVIIe siècle, Jean Eudes, célèbre missionnaire de l'intérieur, s'en prend un jour après saint Jérôme aux : «amazones du diable qui s'arment de pied en cape pour faire la guerre à la chasteté, et qui, par leurs cheveux frisez avec tant d'artifice, par leurs mouches, par la nudité de leurs bras, de leurs épaules et de leurs gorges, tuent cette princesse du ciel dans les âmes qu'elles massacrent aussi avec la leur toute la première».
Henri IV est une victime
Rappelons qu'il s'agit ici de cantiques composés à l'usage des fidèles et qui, dans la pensée de leur auteur, constituaient autant de sermons. Ceux-ci, au cours des siècles, exprimèrent de mille façons la peur durable que des clercs voués à la chasteté éprouvaient devant l'autre sexe. Pour ne pas succomber à ses charmes ils le déclarèrent inlassablement dangereux et diabolique. Ce diagnostic conduisait à d'extraordinaires contre-vérités et à une indulgence singulière à l'égard des hommes. Témoin cet extrait d'un panégyrique de Henri IV prononcé en 1776 à La Flèche par le supérieur du collège :
«Déplorons ici, messieurs, le triste sort des rois à la vue des artifices funestes dont Henri IV fut la victime. Un sexe dangereux oublie les plus saintes lois de la retenue et de la modestie, joint à ses charmes naturels les ressources de son art diabolique, attaque sans pudeur, trafique de sa vertu, et se dispute l'humiliant avantage d'amollir notre héros et de corrompre son cœur.»
Ainsi, le sermon, moyen efficace de christianisation à partir du XIIIe siècle, a sans répit diffusé et tenté de faire pénétrer dans les mentalités la peur de la femme. Ce qui était dans le haut Moyen Age discours monastique est devenu ensuite, par l'élargissement progressif des auditoires, avertissement affolé à l'usage de toute l'Église enseignée qui fut invitée à confondre vie des clercs et vie des laïcs, sexualité et péché, Eve et Satan.
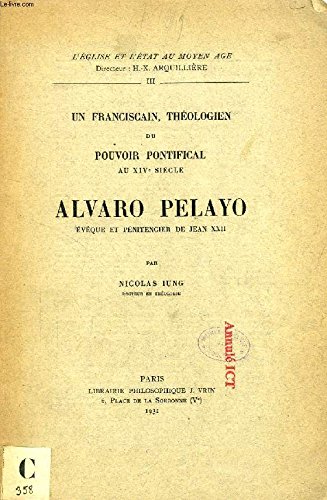
Bien entendu, les prédicateurs ne faisaient que monnayer et distribuer largement à l'aide du jeu oratoire une doctrine depuis longtemps établie par de savants ouvrages. Mais ceux-ci, à leur tour, connurent un rayonnement nouveau grâce à l'imprimerie qui contribua à accabler la femme en même temps qu'elle renforçait la haine du Juif et la crainte de la fin du monde. Soit le De planctu ecclesiae rédigé vers 1330 à la demande de Jean XXII par le franciscain Alvaro Pelayo, alors grand pénitencier à la cour d'Avignon. Cet ouvrage, oublié de nos jours, mérite d'être exhumé des bibliothèques. Il fut imprimé à Ulm dès 1474, réédité à Lyon en 1517 et à Venise en 1560 - indications chronologiques et géographiques qui laissent deviner une audience relativement importante, au moins dans le monde des clercs chargés de diriger les consciences. Or, on peut lire dans sa seconde partie un long catalogue des cent deux «vices et méfaits» de la femme. A cet égard, il ressemble beaucoup par sa structure et par le parallélisme des intentions au Fortalicium fidei dirigé contre les Juifs. On se trouve ici devant ce qui est peut-être le document majeur de l'hostilité cléricale à la femme. Mais cet appel à la guerre sainte contre l'alliée du diable ne se comprend que replacé dans le milieu qui l'a lancé : celui des ordres mendiants soucieux de christianisation et inquiets de la décadence du corps ecclésial.
Tantôt le franciscain met en cause «les femmes» ou «des femmes», tantôt «certaines femmes», tantôt plus catégoriquement «la femme», et c'est bien de celle-ci comme telle qu'il instruit le procès sans que l'accusée ne soit jamais assistée d'un avocat. Dès l'abord, il est entendu qu'elle partage «tous les vices» de l'homme. Mais, en plus, elle a les siens propres, nettement diagnostiqués par l'Ecriture :
«N° 1 : Ses paroles sont mielleuses... ; n° 2 : Elle est trompeuse... ; n° 13 : Elle est pleine de malice. Toute malice et toute perversité viennent d'elle [Eccl. XXV]... ; n° 44 : Elle est bavarde, surtout à l'église... ; n° 81 : Souvent prises de délire, elles tuent leurs enfants... ; n° 102 : Certaines sont incorrigibles...»
Vers la chasse aux sorcières
Par leur ton et leur contenu, les accusations et imprécations d'Alvaro Pelayo renvoient dans une assez large mesure à toute une littérature misogyne antérieure où l'on trouve rassemblés des poèmes monastiques et le second Roman de la Rose. Mais, en même temps, elles marquent le passage à une nouvelle étape de l'antiféminisme clérical. Pour mieux saisir celui-ci, relisons des extraits d'un De contemptu feminae (en vers) rédigé au XIIe siècle par un moine de Cluny, Bernard de Morlas, dont l'œuvre poétique se partage par ailleurs entre la louange de Marie, le mépris du monde et la description terrifiante du Jugement dernier :
La femme ignoble, la femme perfide, la femme lâche
Souille ce qui est pur, rumine des choses impies, gâte les actions.
La femme est un fauve, ses péchés sont comme le sable.
Je ne vais pas cependant déchirer les bonnes que je dois bénir.
Que la mauvaise femme soit maintenant mon écrit, qu'elle soit mon discours.
Toute femme se réjouit de penser au péché et de le vivre.
Aucune, certes, n'est bonne, s'il arrive pourtant que quelqu'une soit bonne.
La femme bonne est chose mauvaise, et il n'en est presque aucune de bonne.
A la lecture de ces invectives accablantes, on voit combien Alvaro Pelayo à certains égards est peu original. Dans le noir poème de Bernard de Morlas, on trouve déjà les éléments stéréotypés repris par le franciscain espagnol : le passage de l'accusation contre la femme mauvaise au discrédit lancé contre toutes les femmes ; les griefs contre la perfidie, la tromperie, la violence de l'autre sexe ; contre la luxure effrénée de la femme, son art de se farder et de se peindre, ses instincts criminels qui la conduisent aux avortements provoqués et aux infanticides. Fille aînée de Satan, elle est un «abîme» de perdition. Mais ce discours misogyne qui était banal dans le monde monastique, Alvaro Pelayo le retouche et l'aggrave de plusieurs façons. D'abord - et c'est l'essentiel - il apporte force textes bibliques à l'appui de chaque affirmation qui se trouve ainsi fondée en droit. Ensuite il démontre avec une ampleur nouvelle que la femme est ministre d'idolâtrie - on a vu l'importance qu'il accorde à ce thème -, que le mari doit tenir son épouse bien en main et enfin que l'élément féminin cherche à perturber la vie quotidienne de l'Église. Dès lors apparaissent les objectifs de ces mises en garde. Alvaro Pelayo ne donne pas seulement des conseils à des moines. En tant que prédicateur et confesseur, il s'adresse à l'ensemble des fidèles - clergé séculier et laïcs réunis. Son propos revêt donc une universalité que n'avaient pas ceux des bénédictins et cisterciens de la période antérieure. Mais, aux accusations misogynes du second Roman de la Rose, il ajoute le support d'un solide fondement théologique et les préoccupations de la pastorale.
L'antiféminisme virulent d'Alvaro Pelayo et de ses semblables, cheminant à travers les multiples canaux du discours oral et écrit de l'époque, ne pouvait manquer d'aboutir à la justification de la chasse aux sorcières.
Une diabolisation de la femme - celle-ci se trouvant déshonorée en même temps que la sexualité - : voilà le résultat auquel aboutissent dans un «climat dramatisé» tant de réflexions cléricales sur le danger que représente alors pour les hommes d'Église - et pour l'Église entière qu'ils annexent - l'éternel féminin.
Jean Delumeau
Sources : Histoire magazine – N° 11, 1980.