
Pendant près d'un siècle, le sexe était tabou pour la gauche marxiste. Plus que tabou, il était mal vu et vécu au plus mal. Puis, lorsque la révolution d'octobre a eu lieu et que les partis communistes sont apparus, le sexe a été vécu comme une « déviation petite-bourgeoise ». Marx n'avait rien dit sur la sexualité : la seule « oppression » qu'il connaissait était celle de la bourgeoisie sur le prolétariat, donc personne n'avait à s'émanciper sexuellement de quoi que ce soit. Dans les quelques références que l'on trouve dans les œuvres complètes de Marx, les femmes sont assimilées à des enfants : il soutient que les femmes doivent être considérées comme des « êtres faibles » dont le capital va abuser, en les payant moins qu'elles ne le méritent et en les faisant travailler à la limite de leurs forces.
Ni Marx ni le marxisme n'étaient « progressistes » sur les questions de genre
Certains auteurs ont affirmé que Marx était « un progressiste en matière d'égalité des sexes ». Cependant, son comportement dans la vie de tous les jours correspond parfaitement à ce qu'on appellerait aujourd'hui « chauvin » : Marx préférait avoir des fils plutôt que des filles, il dépréciait les premiers pas du mouvement de libération des femmes et les femmes en général. Il est allé jusqu'à concevoir la femme dans le mariage comme « une forme de propriété privée exclusive ». Contrairement à Engels, qui était une « suffragette » et qui, dans plusieurs écrits, s'est prononcé en faveur du droit de vote des femmes, Marx était totalement indifférent à cette question.
Marx a pris position contre le travail rémunéré des femmes. Il a fait valoir que la plus grande « docilité » des femmes signifiait que leur présence dans les usines réduisait la capacité de résistance de la « force de travail et favorisait la discipline industrielle ». Et il décharge l'ouvrier masculin de la responsabilité de son comportement « macho » envers sa femme - qu'il considère comme une « possession de l'ouvrier », sans faire aucune référence au « pouvoir patriarcal » - en rendant le capital responsable de tous les malheurs qui frappent l'ouvrier et sa famille.
En un mot, ni les femmes ni les enfants ne l'intéressaient beaucoup dans la mesure où ils échappaient à la simplicité de son schéma bourgeois contre prolétaire, capital contre travail, dépossédés contre puissants.

D'autres exemples de « morale sexuelle de gauche »
Dans l'anarchisme, les choses étaient similaires. Les différentes sectes anarcho-syndicalistes, par exemple, qui ont traversé la guerre civile espagnole en bonne santé, étaient plutôt rigoureuses en matière de sexualité. « Amour libre »..., oui, mais, bien mieux, « lutte pour les droits des travailleurs ». Au sein de la CNT, cette question a été soulevée en permanence jusqu'au 18 juillet 1936. Ce n'est pas un hasard si Durruti, peu avant sa mort, a renvoyé à Barcelone toutes les femmes qui composaient sa colonne.
Tout ce qui ne tendait pas à améliorer la culture et la situation sociale du prolétariat était considéré comme « dangereux » car il détournait de la tâche principale : provoquer un changement socio-économique. L'homosexualité et le travestissement étaient combattus, critiqués et méprisés comme des « vices bourgeois ».
Dans la propagande du Komintern et dans la propagande développée en Espagne pendant la guerre civile par la République, il est frappant de voir comment l'homosexualité est traitée : elle est toujours identifiée au « fascisme ». L'image de Franco apparaissait dans la propagande républicaine avec des traits ambigus, comme un militaire efféminé, de la même manière que dans la propagande de la gauche allemande, les « Junkers » et les « militaristes » étaient présentés comme de simples homosexuels : en tant que « fascistes », ils devaient être le réceptacle de toutes les dépravations. Il en a été de même pour Hitler et, en Espagne, pour José Antonio Primo de Rivera.
Faut-il fusiller les caricaturistes de gauche qui, dans les années 1930, ont dépeint Hitler, Franco et d'autres dirigeants fascistes comme des gays, des travestis ou des transsexuels ?

Maxime Gorki (photo) est allé jusqu'à dire : « Exterminez les homosexuels et vous en aurez fini avec le fascisme ». Pour la propagande de gauche avant la Seconde Guerre mondiale, l'homosexualité était la racine du fascisme. Il n'y a donc aucun doute sur la vision de la gauche du monde gay : c'était, tout simplement, l'ennemi, et ce pour un large éventail de raisons.
Arthur Koestler, dans ses mémoires, alors qu'il était encore un militant communiste, ressentait une certaine répulsion face à la pratique du sexe. C'était comme s'il trahissait la « cause sacrée du prolétariat ». Le parti et la cause, la révolution mondiale, étaient au-dessus de tout. Telle était la doctrine officielle du Komintern et elle l'est restée. Lorsque Wilhelm Reich commence à s'intéresser à la « sexualité prolétarienne », ses camarades du KPD le considèrent avec une certaine suspicion et, en 1932, ils cessent de soutenir son organisation de jeunesse « SEXPOL » pour une « politique sexuelle ». Deux ans plus tard, il reconnaîtra qu'en URSS, le parti communiste a étouffé la « liberté sexuelle », criminalisé et interdit l'homosexualité. Il a été exclu des rangs du parti.
1923 : l'année des « coïncidences cosmiques » (1) Lukàcs
En 1923, cependant, trois phénomènes se sont produits qui sont passés inaperçus pour la plupart de la population.
D'une part, Georg Lukács, communiste hongrois et partisan de Béla Kun, qui avait été « commissaire responsable de l'instruction publique » dans la courte « République soviétique hongroise », devait publier Histoire et conscience de classe. Lukács avait tiré quelques conclusions de l'échec de la révolution en Hongrie et dans toute l'Europe entre 1919 et 1923. L'ouvrage a été condamné par le quatrième congrès de l'Internationale et a obligé l'auteur à faire son autocritique. L'ouvrage, presque plus hégélien que marxiste, tente d'être une justification philosophique du bolchevisme. Il propose un nouveau modèle organisationnel pour le parti, qu'il considère comme « une forme historique et comme le porteur de la conscience de classe ». Il n'était donc pas nécessaire que le parti soit composé de prolétaires, ni au service du prolétariat. De plus, dans un autre temps, à une autre époque, dans un autre lieu, une révolution communiste pourrait avoir lieu sans prolétaires, même sans un parti léniniste organisé. Il a été exclu du parti communiste hongrois en 1928.

Lukács (photo) avait compris que le prolétariat non seulement n'était pas « révolutionnaire », mais qu'il ne le serait très probablement jamais. Pour un intellectuel non fanatisé par le marxisme, cela lui aurait donné plus d'arguments qu'il n'en faut pour abandonner cette idéologie, mais Lukács se considérera toujours comme un « révisionniste » du marxisme, en aucun cas comme un non-marxiste, et encore moins comme un anti-marxiste. Son raisonnement est simple : le marxisme étant la seule « doctrine scientifique », lorsqu'il existe un écart entre la réalité et l'interprétation idéologique, le problème ne vient pas de l'idéologie, mais de la réalité qui a pris une mauvaise direction. Le problème est que Lukács considère que l'Occident vit dans l'erreur depuis deux mille ans. Et cette erreur a un nom : la civilisation chrétienne et occidentale.
Ainsi, le grand adversaire de Lukács est le christianisme et l'ordre des valeurs qui en découle. L'idéologie est donc sûre de son infaillibilité.
1923 : l'année des « coïncidences cosmiques » (2) - Gramsci
La même année, en 1923, Antonio Gramsci avait remplacé Amadeo Bordiga au poste de secrétaire général du parti communiste italien. Aux élections du 6 avril 1924, il sera élu député et, de son siège, il assistera à la mort de Matteotti et, plus tard, à la consolidation du régime fasciste. Dans les mois qui suivent, et surtout pendant son séjour en prison à partir de 1927, il réfléchit à quelque chose qui le préoccupe depuis un certain temps : il y a quelque chose dans le schéma marxiste qui ne correspond pas tout à fait à la réalité.

Il a développé l'idée de « l'hégémonie » et du « bloc hégémonique », qui n'était rien d'autre qu'une extension du problème de « l'infrastructure » et de la « superstructure » de Marx. Pour Marx, « l'infrastructure » n'était que le système économique. Cette « infrastructure » exerce une pression sur la « superstructure » en déterminant les lois, les us et coutumes sociaux, le modèle politique, l'appareil répressif, etc. Marx avait recommandé que pour changer la « superstructure », il était nécessaire d'agir sur « l'infrastructure », car tout dans une société capitaliste était conditionné par l'économie.
Mais, dans l'analyse de Marx, ce qu'il entendait par « bourgeoisie » (en réalité, il s'agissait d'une classe capitaliste) était directement opposé au « prolétariat ». Lorsque Marx a formulé sa thèse, le capitalisme était encore à un stade industriel précoce. Dans les décennies suivantes, d'autres groupes sociaux vont apparaître, générés par l'industrialisation, l'amélioration des conditions économiques et qui ne sont rien d'autre que le produit du nouvel ordre social : la classe moyenne. Et la classe moyenne a commencé à démontrer son pouvoir, en mobilisant et en mobilisant une grande partie de la population dans ce qui était les fascismes. Ce n'est donc pas la « bourgeoisie » qui a généré les fascismes, mais une classe que Marx n'a même pas eu l'occasion de connaître.
En prison, Gramsci a repensé un problème que Marx avait laissé trop facilement irrésolu. Si, malgré les syndicats, il était très difficile de modifier « l'infrastructure » économique qui revenait à pénétrer dans le bastion de la forteresse du capital, ne pourrait-on pas modifier la « superstructure » en opérant directement sur elle ? Gramsci a répondu par l'affirmative et en a tiré son concept « d'hégémonie culturelle » et de « bloc hégémonique ». Pour Gramsci, « l'hégémonie culturelle » était, en somme, ce qui garantissait le contrôle du capital sur la société. Par exemple, lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, le capital (ce qu'il appelle la « bourgeoisie capitaliste ») a appelé à la « défense de la patrie », constituant ainsi un « bloc hégémonique » dans lequel se trouvaient différents groupes sociaux, tous subordonnés au pouvoir du capital et unis par l'idée de patriotisme. Mais si le leadership intellectuel et la légitimité morale du « bloc hégémonique » pouvaient être sapés, il pourrait se déplacer vers les « forces populaires du travail et de la culture » et ainsi modifier l'équilibre des forces dans la « superstructure ».
Si nous combinons cette lutte pour « l'hégémonie culturelle » avec le travail du Parti communiste et des syndicats ouvriers, alors et seulement alors sera atteint le « moment révolutionnaire » dans lequel il sera possible de renverser le pouvoir du capital.
Une parenthèse sur le « gramscisme de droite »
Il est impossible de ne pas s'arrêter ici et de ne pas rappeler l'idée d'Alain de Benoist sur le « gramscisme de droite ». Outre le fait que Guillaume Faye, reconnaissait déjà dans son ouvrage L'Archéofuturisme, que lorsque la « nouvelle droite » débattait sur ce sujet, elle ne connaissait guère l'œuvre de Gramsci, nous ajouterons que mener un « combat culturel » à droite et dans les années 70, c'était se leurrer sur les possibilités: d'une part, parce que Gramsci n'est pas parti de zéro, il disposait d'une idéologie bien structurée à laquelle il n'a ajouté que quelques éléments de critique pour la perfectionner et éviter le décalage entre les prévisions idéologiques et la réalité sociale. D'autre part, Marx et Engels n'étaient pas seulement des « doctrinaires », mais des militants politiques, engagés dans une cause, d'abord celle de la Ligue des communistes et plus tard celle de l'Internationale.
Pour qu'une lutte culturelle porte ses fruits, une condition sine qua non était l'existence d'une idéologie globale pouvant être « hégémonisée » et non une simple critique de la situation culturelle actuelle, sur la base de laquelle de simples « points de référence » étaient érigés. Et, deuxièmement, l'image de « l'intellectuel » en dehors de la lutte politique contaminante et avec un avenir douteux était quelque chose qui n'existait pas à gauche : là-bas, « l'intellectuel » était, en même temps, un « soldat politique ». Dans le cas de la « nouvelle droite », l'ensemble était composé d'anciens « soldats politiques » diplômés qui avaient décidé de rompre avec leurs anciennes organisations, sans même penser à en construire de nouvelles.

L'histoire de la « nouvelle droite » française nous a toujours paru être l'histoire d'un entraîneur (« culturel » en l'occurrence) qui a jugé qu'il fallait se préparer à affronter le combat culturel au moment où le « match » se présenterait, c'est-à-dire le match où s'affronteraient deux visions du monde, deux perspectives culturelles, deux façons de concevoir l'être humain. Mais ce « match » n'est jamais arrivé. Et l'entraîneur ne cessait de nous dire que nous devions nous entraîner de plus en plus, pour nous préparer à ce moment.
Dire cela en 1978 était une chose parce que l'extrême droite française était à peine moins que zéro, mais ensuite, lorsque le phénomène Le Pen a éclaté dans les années 1980, les choses ont changé: il y avait déjà un mouvement politique sur lequel opérer. Mais, pour le coach, ce mouvement était peu de chose et il l'a toujours regardé de haut depuis sa position de supériorité intellectuelle. Et le problème a été que l'écologisation d'un parti populiste de droite (la limite maximale à laquelle un projet alternatif peut s'accommoder dans la situation sociopolitique actuelle) en France a eu lieu presque entièrement en dehors de la « nouvelle droite ». Revenons à Gramsci.
Nous sommes ce que nous pensons. Comment Gramsci est devenu ce qu'il était
Les parents de Gramsci étaient pauvres, mais il était avocat et avait une certaine culture. Bien qu'il travaille et obtienne une bourse pour étudier la philosophie et la littérature, il rejoint le parti socialiste. En 1921, il rejoint le parti communiste. La rapidité avec laquelle le fascisme a pris le pouvoir a fait que Gramsci a commencé à se méfier de la « conscience de classe » et du pouvoir du prolétariat en tant que force opposée au capital. À partir de là, il a remis en question certains aspects du marxisme et du léninisme, tout en acceptant l'essentiel, à savoir que l'idéologie dominante dans une société est celle de la classe dominante qui s'exprime par une « hégémonie culturelle » transmise à la population par le biais des croyances religieuses, des médias et de l'éducation.
Ainsi, en attaquant les idées religieuses, en les dévalorisant, en pénétrant parmi les fidèles et en semant le doute, certaines ont été neutralisées ; en infiltrant les organismes du pouvoir culturel, l'influence des classes dominantes dans le monde de la culture a été limitée ; et enfin, en observant et en gagnant les mouvements culturels alternatifs et dissidents qui tendent à apparaître dans toute société, l'influence du « bloc hégémonique » a été progressivement érodée.
Gramsci n'était pas particulièrement empathique envers les travailleurs (il sentait qu'ils n'aspiraient qu'à améliorer leurs conditions de vie et ne se souciaient pas de savoir si c'était par la révolution ou par des concessions du capital) ou les intellectuels (qu'il considérait comme des dilettantes petits-bourgeois). Il soutenait que l'intellectuel devait « se justifier » en suivant une « ligne de masse », en prenant fait et cause pour le prolétariat et la transformation de la société. Cette élite intellectuelle doit garantir le « contrôle du langage » et attribuer un nouveau contenu aux concepts couramment utilisés par la société.
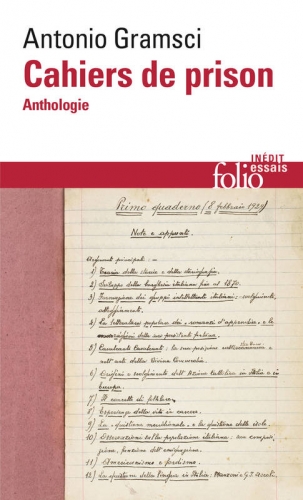
En pratique, Gramsci déplace le « sujet révolutionnaire » du prolétariat à l'intellectuel. Les intellectuels, pour lui, sont ceux qui « pensent », « raisonnent », « analysent ». Mais de telles dispositions peuvent être trop nobles et inaccessibles aux masses. C'est pourquoi un lien de transmission est nécessaire entre « l'intelligentsia » et les « masses » : le vulgarisateur, le journaliste, l'agitateur culturel, celui qui rend présentables et compréhensibles les idées élaborées par les intellectuels. C'est ainsi que ce que Gramsci appelle les « classes subalternes » vont progressivement ravir le pouvoir au « bloc hégémonique ».
Mais il y a une autre thèse de Gramsci qui est particulièrement importante. Tout comme Marx et Engels, mais aussi Lénine et les bolcheviks, avaient considéré que les lois économiques et, surtout, la dialectique et la lutte des classes, se dirigeaient vers un destin fatal : Gramsci s'est rendu compte que ce schéma était trop rigide et que, de plus, certaines des critiques formulées par le fascisme l'avaient atteint : dans le schéma marxiste, en effet, il n'y a pas de place pour le libre arbitre, tout y est mécanisme appliqué à la société. C'est le prix à payer pour avoir considéré l'économie comme la seule infrastructure et pour avoir établi que les relations de pouvoir ne pouvaient être modifiées qu'en agissant sur ce terrain.
En 1923, lorsque Lukács a publié son livre sur la conscience de classe, Gramsci était déjà arrivé à la conclusion que la transformation d'une société devait se faire sur la base d'un changement culturel et que l'adhésion d'une élite culturelle était importante s'il s'agissait de précipiter un « moment révolutionnaire ».
1923 : l'année des « coïncidences cosmiques » (3) - L'Ecole de Francfort
Enfin, en Allemagne et à la suite de l'enchaînement des défaites du parti communiste et de l'extrême gauche de 1919 à 1922, apparaît un mouvement intellectuel qui exercera sa puissante influence, d'abord dans ce pays, puis rayonnant depuis les États-Unis vers le monde entier : l'école de Francfort. En fait, ce n'est que dans les années 1960 que ce nom s'est popularisé comme caractéristique d'un groupe d'intellectuels allemands qui ont pris leurs distances par rapport au marxisme orthodoxe et ont effectué un travail de « révision », en ajoutant d'autres apports (notamment du freudisme) au marxisme dans son ensemble.
Tous les membres de l'École de Francfort étaient des Juifs, plus ou moins sécularisés, qui sont partis aux États-Unis lorsque Hitler est arrivé au pouvoir. Il s'agissait de Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Herbert Marcuse, Friedrich Pollock, Erich Fromm, Walter Benjamin, Leo Löwenthal, Leopold Neumann ; tous sont connus comme « la première génération de l'école de Francfort ». Par la suite, d'autres se sont joints à eux, une deuxième et même une troisième génération, dans laquelle l'élément juif n'est plus aussi caractéristique.


Les réflexions de ce groupe s'inscrivent dans la même veine que celles de Lukács et Gramsci. En 1923, financé par Felix Weil (photo + tableau, ci-dessus), un millionnaire juif d'origine germano-argentine, un groupe d'intellectuels a créé l'Institut de recherche sociale à l'université de Francfort.
L'essence de l'École de Francfort est son incorporation des thèses freudiennes dans l'héritage marxiste. Comme Gramsci, ils reconnaissent l'idée de « libre arbitre » et, contrairement aux marxistes orthodoxes qui n'attachaient pas une grande importance au « bonheur humain » avant la « révolution », les membres de cette École considèrent que les êtres humains, avant, après et pendant la révolution, doivent se sentir libres, heureux et complets. Le monde classique aurait appelé cette position « hédonisme », d'autant plus que l'appel à Freud les convainc que le bonheur passe par la sexualité.
Les membres de sa première génération écriront, tant dans leurs premiers travaux en Allemagne dans les années 1930 que dans leurs travaux ultérieurs dans les années 1960, des théories sur la sexualité, tant individuelle que sociale. Ce sont eux qui ont suggéré à Simone de Beauvoir que le sexe est « une construction sociale » et qu'il n'existe pas de sexualité définie dans la nature (l'ADN n'avait pas encore été découvert et une telle erreur pouvait être justifiée...).
Marcuse et Adorno sont allés le plus loin dans ce domaine. Mais ce qui préoccupait vraiment l'École de Francfort, étant donné que tous ses membres étaient d'origine juive, c'était l'arrivée au pouvoir de la NSDAP en Allemagne en 1933. Ils ont tous émigré aux États-Unis et y ont poursuivi leurs études. Au moins, ils étaient plus proches des fondations capitalistes qui allaient désormais financer leurs travaux. Puis vint la Seconde Guerre mondiale, mais dès leur arrivée aux États-Unis - à l'exception de Fromm, qui choisit de vivre au Mexique pendant un certain temps - leur travail « philosophique » consista à trouver des arguments antifascistes : et c'est ce qu'ils firent. Ce n'était pas très difficile, après tout, ils étaient tous issus de milieux marxistes et avaient été des militants communistes. Il ne s'agissait plus que d'adapter l'antifascisme au monde capitaliste et de préparer le terrain pour la guerre à venir, qui a trouvé aux Etats-Unis et dans le président Roosevelt et son « New Deal » raté son promoteur le plus intéressé.
La personnalité autoritaire selon Théodore W. Adorno
Le groupe se réunit d'abord à New York, siège provisoire de l'Institut de recherche sociale en exil, puis, peu avant l'entrée en guerre des États-Unis, il s'installe en Californie. C'est à cette époque que Horkheimer a écrit sa Dialectique des Lumières. Mais l'œuvre qui nous intéresse ici a été écrite dans la période d'après-guerre. Il s'agit de La personnalité autoritaire, signé par Adorno. L'idée était que, chez certains sujets, il existe un surmoi strict qui contrôle un ego faible incapable de surmonter ses pulsions primaires. Cela conduit à des conflits intérieurs qui amènent l'individu à accepter les conventions sociales et la soumission à l'autorité. Mais aussi, cet individu soumis devient dominant envers les groupes et les personnes qu'il considère comme « inférieurs ». Il agit de manière brutale et despotique envers eux et les empêche « d'être heureux ». Ainsi apparaît la « personnalité autoritaire » qui est favorisée par deux institutions : la religion et surtout la famille. Dans les deux cas, il apparaît une « volonté de pouvoir sur les autres » (le concept est d'Adler). Cette « personnalité autoritaire » est à l'origine du fascisme. De tous les fascismes. Pour Adorno, toute forme d'autoritarisme finit par être un « fascisme ». Et le fascisme se résume à Auschwitz. Il faut donc défendre la société afin d'éviter un « nouvel Auschwitz », et comment ? C'est simple : en prenant position contre l'autorité de la religion et contre le modèle familial. Il a soutenu que le fascisme n'était rien d'autre que la répétition de schémas violents appris dans l'enfance par la contemplation du modèle patriarcal. Un enfant qui regardait son père lui ordonner d'aller se coucher serait un enfant qui, à l'avenir, reproduirait ces schémas et finirait heureux et content dans la Hitler Jugend. La structure hétéropatriarcale était le modèle que le fascisme allait reproduire au niveau de l'État. En se débarrassant de ces deux éléments, la religion et la famille, tout le reste qui accompagne les structures traditionnelles se dissoudrait de lui-même. La science positive serait le grand adversaire de la religion, mais il en fallait bien plus pour détruire la famille.


Pour lancer cette attaque contre la famille et la religion, Adorno a élargi ses horizons : puisque le matérialisme dialectique n'était d'aucune utilité pour interpréter l'histoire, sauf à une époque relativement récente, il a introduit des éléments tirés du freudisme pour convenir que l'histoire de l'Occident était, encore et toujours, l'émergence, le maintien et la réaffirmation du « fascisme ». Il voyait le « fascisme » dans toute l'histoire de l'Occident. Partout où il y avait une structure « hétéropatriarcale », il y avait une « déformation » du caractère avec l'acceptation de l'autorité, d'où le « fascisme ». Toute l'histoire de l'Occident, toute sa tradition, a été « fasciste », surtout depuis l'avènement du christianisme. Ainsi - et c'est la conclusion - pour « détruire le fascisme », il fallait opérer : 1) contre les traditions (qu'Adorno appelle avec mépris « conventionnalismes ») et 2) contre les véhicules les plus caractéristiques de ces traditions (famille et religion).
Ici, Adorno a été contraint de rompre avec toute la tradition de gauche qui, jusqu'à récemment, avait imputé le fascisme à des pulsions homosexuelles. En lisant son livre, il est clair qu'il fait des compromis simples avec le langage, en utilisant des concepts freudiens et sociologiques, mais en évitant la conception de l'homosexualité qui prévalait au sein de l'establishment médical et des psychologues de l'époque.
La psychologie ne partageait pas le critère antifasciste d'un lien direct entre l'homosexualité et le fascisme, mais avait établi une origine plutôt réfléchie. L'homosexualité serait une névrose qui favoriserait la réapparition d'un complexe d'infantilisation non résolu. L'explication était basée sur le fait que dans l'enfance, les caractéristiques de l'identité sexuelle ne sont pas encore consciemment développées, et qu'il n'y a pas non plus d'impulsion sexuelle consciente, de sorte que les garçons ont tendance à se regrouper, à jouer et à collaborer entre eux, tandis que les filles font de même. Lorsque les pulsions sexuelles apparaissent, ce premier stade est laissé de côté et la tendance « normale » est à l'hétérosexualité et à l'attirance des individus d'un sexe pour le sexe opposé... sauf dans certains cas de malformations physiques (androgynie) ou psychologiques dans lesquels le sujet n'a pas dépassé la phase « infantile » et continue à être attiré et à rechercher la compagnie d'êtres du même sexe, comme dans l'enfance.
Cette explication est bien meilleure que celle fournie par Adorno, qui se perd dans des catégories freudiennes dont la validité est encore contestée aujourd'hui. L'intérêt d'Adorno pour sa justification de l'homosexualité comme moyen d'échapper au fascisme hétéropatriarcal est opportuniste : cela lui permet d'attaquer la famille, et cela vaut plus que la rigueur et la vérité scientifiques ou philosophiques. Car, une fois l'ennemi déterminé, la légitimité des arguments utilisés contre lui importe peu : il s'agit d'ouvrir un maximum de fronts à partir desquels on peut le harceler.
Adorno « transmute » toutes les valeurs de la gauche sur la sexualité, et pour obtenir ceux qui ont le plus attaqué, critiqué, harcelé et persécuté l'homosexualité (Hitler, par exemple, ne considérait l'homosexualité que comme une affaire privée et qu'il n'y avait plus rien à en dire, Et s'il a exécuté Röhm, qui avait été son plus proche collaborateur au cours des dix années précédentes, ce n'était pas à cause de son homosexualité notoire, mais parce qu'il était soupçonné d'être un ennemi de l'État), c'est-à-dire la gauche marxiste, se sont désormais positionnés comme défenseurs des « minorités sexuelles ». Tout cela pour éroder la famille et l'empêcher de continuer à reproduire le « modèle hétéropatriarcal, germe du fascisme ».
Deux dernières notes sur Adorno. Le nom de son père était Oscar Alexander Wiesengrund, mais il a renoncé à ce nom de famille, qui a été réduit au « W » qui apparaît toujours dans son nom. « Adorno » était le nom de sa mère, dont il s'est toujours senti le plus proche, une soprano lyrique, qui avait suscité son intérêt pour la musique. Pendant longtemps, il a hésité entre la philosophie et la musique. Le fait est que dans sa maturité et dans L'Essai sur la personnalité autoritaire, il a élaboré une théorie sur la sexualité. En 1968, après les événements révolutionnaires de Paris, trois étudiantes se déshabillent en classe (en fait, elles ne lui ont montré que leurs seins). Adorno est décédé quelques jours plus tard, la soi-disant « crise des seins nus » étant la cause directe de l'arrêt cardiaque qu'il a subi. Commentant cette anecdote avec l'écrivain marxiste Vázquez Montalbán, celui-ci m'a dit qu'Adorno était capable d'élaborer une théorie sexuelle, mais pas de la soutenir à une distance de cinq mètres...
Ernesto Milà
Source: https://info-krisis.blogspot.com/2022/06/cronicas-desde-m...


