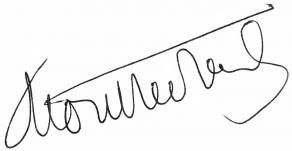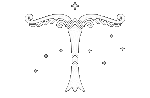S'accomplissant dans la mort, le « secret de Montherlant » ne sera donc jamais percé. L'homme a voulu jusqu'au bout s'enfermer dans sa légende, que défendait sa solitude. On ne pourra plus, maintenant, que se demander quels mouvements de l'âme se dissimulaient derrière cette attitude singulière, qui l'a tenu si jalousement à l'écart de son siècle et de la société littéraire pendant plus de cinquante ans. Reste l'œuvre, c'est-à-dire le principal. Quelles que soient les révélations auxquelles historiens et critiques pourront parvenir, en s'infiltrant à travers la muraille dont l'auteur des Célibataires avait entouré sa vie privée, son caractère, ses sentiments profonds (et dont il lui est arrivé de dire qu'on pourrait en voir surgir l'objet d'un « scandale surprenant»), ces découvertes ne changeraient rien à la valeur propre du Songe, des Jeunes filles, de Port-Royal, des Garçons, du Maître de Santiago, des Carnets, du Chaos et la nuit.
La première impression qu'on tire de ces livres si divers, mais unis par ces signes non équivoques qui annoncent la présence du génie, touche au langage qu'on y entend.
Langage tout à fait différent de celui que parlait l'auteur en son particulier. La plume à la main, son esprit s'élevait de plusieurs degrés, pour la raison très simple que son style écrit refusait de se confondre avec le «français courant», dont les négligences et les indigences font un si triste accompagnement aux progrès intellectuels et matériels de notre époque.
Montherlant a su nous faire entendre à peu près la façon dont les grands écrivains du dix-septième et du dix-huitième siècles auraient pu décrire nos mœurs, nos faits et gestes, le décor qui nous entoure, s'ils ressuscitaient. Les héros du théâtre de Montherlant, même du «théâtre en veston», s'expriment avec la syntaxe de Bossuet. Et cependant, grâce à quelques détails opportunément disposés, leurs discours nous paraissent naturels en 1972. Ainsi, l’une des bases les plus essentielles de notre littérature et de notre culture demeure utilisable, en dépit des constructions hétéroclites dont on l'a surchargée.
De Pascal à Voltaire, à Chateaubriand, à Nerval, à Proust, à Montherlant, on conçoit une tradition continue, qui n'attend plus, pour se prolonger, qu'un nouveau « classique», tel qu'ils l'ont été tour à tour.
Classique ne signifie rien d'archaïque ni de resserré, mais une façon harmonieuse et solide de dire les choses, fût-ce les plus insolites ou hardies.
Autre leçon qui se dégage de ces soixante livres, comme de tout ce qui s'y ajoute, articles, préfaces, notes et commentaires : partout éclate une dignité qui a manqué souvent dans nos Lettres, il faut l'avouer, au cours des cent dernières années.
Point de romantisme. L'essayiste du Solstice de juin, le romancier de La rosé de sable, le dramaturge de La reine morte, n'a jamais feint d'exercer un sacerdoce social, ni prétendu distribuer à la ronde des préceptes ou des consignes. Simplement, et quelles que fussent ses erreurs, ses faiblesses, il a su imprimer à tout ce qu'il écrivait la marque du respect, qu'on ne pouvait s'empêcher de lui restituer.
On l'a dit orgueilleux, méprisant, parce que, dès qu'il écrivait, il s'interdisait toute vulgarité, comme aussi toute concession au goût public. L'exemple a été suivi. C'est de Montherlant autant que de Morand que procèdent les Nimier, les Laurent, les Nourissier, les Blondin, les Spens, les Marceau, qu'avait précédé le premier des « désinvoltes» contemporains (avec un fond de sérieux et même de tragique) : Pierre Drieu la Rochelle.
Tout commença quand parut La relève du matin. Les points de repère, en art, doivent être pris à la fin, non au début, des périodes que l'on considère. Si bien que les deux grandes dates de l'histoire littéraire, pour la France moderne, seront peut-être 1885 : mort de Victor Hugo, et 1972 : mort d'Henry de Montherlant. Je ne compare pas les talents, mais les importances respectives, chacune par rapport à son temps. Deux grands acteurs, puisque tout artiste de premier plan est contraint, à quelque moment, de jouer un rôle. Deux tempéraments strictement opposés.
Il suffit d'évoquer la mort de l'un, la mort de l'autre, et les dispositions que chacun avait prises en vue de cet évènement, avec les suites :
— pour Hugo, la veillée sous l'Arc de Triomphe, au milieu d'un bataillon de poètes, l'ostentatoire corbillard des pauvres, deux cent mille badauds se répétant des vers immortels;
— pour Montherlant, le refus de tous les hommages, l'escamotage de la dépouille ensanglantée, et les cendres sur le Forum, ironique défi d'un Romain à son pays et à son siècle.
L'auteur des Misérables avait trop d'amis. L'auteur des Célibataires n'en avait pas assez. A tous deux, dans des proportions inégales, on doit le même bienfait spirituel, qui regarde la hauteur de la civilisation. Ce mot de hauteur plaisait à Montherlant, qui repoussait le mot grandeur : c'est une des dernières observations qu'il m'ait faites.
Je me devais, interrogeant sa mémoire, de me tourner d'abord vers le plus précieux, qui est, pour un écrivain, sa part d'éternel : les idées qu'il a conçues, les phrases où il a enfermé ses idées. A présent, je voudrais revenir à sa personne et, pour cela, porter mon témoignage, en égrenant des souvenirs qui s'échelonnent de 1929 à 1972. J’avais écrit déjà, dans des « revues de jeunes», quatre ou cinq études consacrées à Montherlant, quand je l'aperçus pour la première fois : aux Nouvelles littéraires, alors dans tout leur éclat. J'y attendais Maurice Martin du Gard. D'une porte latérale jaillit un autre phénix de ces lieux, Frédéric Lefèvre, sorte de cétacé soufflant de la fumée à la place d'eau de mer, les yeux perpétuellement furieux derrière les loupes de ses lunettes.
A sa rencontre s'élança l'un des visiteurs qui patientaient avec moi. Un adolescent, aurait-on dit. Mince et vif, le profil impérieux. Et ce profil, soudain, s'amollissait, s'humiliait curieusement. Car l'auteur du Songe — c'était lui, déjà célèbre — présentait une requête à son massif interlocuteur. Le journal ne pourrait-il, de toute urgence, publier un texte qu'un tiers avait rédigé, au sujet (je crois) des Olympiques.
— Impossible ! tranchait Lefèvre, à haut et intelligible voix. Le prochain numéro des Nouvelles est complet.
— Mais enfin, n'y aurait-il pas moyen, à titre exceptionnel ?...
— Je vous répète que c'est impossible.
Bousculant le solliciteur, le cétacé regagnait son antre sous-marin. Henry de Montherlant se retournait pour gagner la sortie, après sa vaine démarche. Et je voyais les marques de la supplication, puis de la déconvenue, s'effacer sur ses traits, pour leur rendre leur physionomie ordinaire, celle de la fierté, de l'énergie, et, tout compte fait, du bonheur.
A cet âge — trente-quatre ou trente-cinq ans — le grand espoir des lettres françaises avait son allure et sa figure de jeune premier sportif, beau comme un torero qui serait aussi danseur mondain, mais avec ce regard de force et de ruse qu'il devait garder jusqu'à ses derniers jours. Dans la décennie qui suivit, j'échangeai beaucoup de lettres avec Montherlant, parce qu'il lui arrivait rarement de ne pas répondre aux critiques, après un article.
A propos des Jeunes filles, où il se moquait du monstre mariage, qu'il appelait « l'hippogriffe», j'avais écrit qu'il aurait beau faire, il finirait par enfourcher l'animal. « Vous avez failli avoir raison, me répondit-il plaisamment. Mais vous avez tort.» Par deux fois il rompit des fiançailles très sérieuses : les historiens de demain, n'en doutez pas, citeront des noms. Généralement, les lettres du « voyageur solitaire» soufflaient ensemble le froid et le chaud, me remerciant pour la moitié de mes propos et me reprochant l'autre moitié. On ne peut pas modeler un buste sans l'égratigner, ni parler d'un auteur sans lui faire de la peine. C'est le prix de la vérité.
A partir de 1943, les événements rompirent ce mince lien, qui ne devait se renouer que dix ans plus tard, quand je repris ma férule d'aristarque. Ce qui me conduisit, presque aussitôt, quai Voltaire.
Montherlant m'y reçut avec sa bonne grâce ordinaire. Mais était-ce bien Montherlant ?... Je n'en croyais pas mes yeux! Où était le «jeune premier» que sa sveltesse, sa mine altière, sa démarche allègre faisaient paraître presque grand ? Il était devenu ce petit homme épais, la tête enfoncée dans des épaules rondes, l'air d'un vieux notaire de province (à cinquante-cinq ans), qui me serrait les deux mains, dans ce salon aujourd'hui illustre, avec ses quatre meubles collés contre les murs, ses deux fenêtres basses, son entassement d'« antiques» disparates tournés vers un fauteuil.
Lors de cette visite, il me dit, par allusion à des persécutions dont, assurait-il, on le menaçait encore : « S'il en est ainsi, je ferai comme Drieu». Aveu qu'il nia, quand je le lui rappelai.
Je ne le vis pas une fois sans qu'à tel ou tel propos il prononçât le mot suicide. La dernière fois, ce fut à la table du restaurant où il m'avait invité. L'étude sur Hemingway que j'avais publiée ici (Le Spectacle du Monde, mars 1972) l'avait frappé, à cause de la fin du romancier américain. Il me questionna longuement là-dessus. « Comment, au juste, s'y est-il pris ? Et pourquoi l'a-t-il fait ?» Je répondis : « Parce qu'il devenait impuissant». Cela fit sourire Montherlant. Mais au fond de son regard meurtri, il restait quelque chose de sombre.
La fois précédente, chez lui, il s'était plaint d'un projet de « parking» souterrain, qu'on voulait construire sous sa cour : — Si l'on m'inflige cette brimade, deux mois au moins de remuements et de tintamarre, je n'ai plus qu'à me suicider.
— Pourquoi n'allez-vous pas passer une saison à la campagne ?
— Je ne peux pas. J'ai deux pièces en répétition.»
Se détendant de nouveau : « Le théâtre, c'est si amusant!»
L'obsession de la mort volontaire voisinait, dans sa pensée, avec des plaisanteries, des boutades. Il redevenait grave dans deux circonstances bien définies. Quand il parlait des femmes — à l'entendre, il avait collectionné les conquêtes féminines, mais je le soupçonnais de forcer la note. Et quand il mangeait. Car je l'ai vu gourmand. Jusqu'à s'inonder de crème au chocolat.
Dans un autre article, j'avais parlé de Gabriele d'Annunzio (Le Spectacle du Monde, juin 1971), qui fut tour à tour pour Montherlant un modèle et une tête de turc. Il me téléphona aussitôt pour me faire un grief de l'ironie avec laquelle j'avais conté l'accident dont l'écrivain italien fut victime, et le parti publicitaire qu'il en tira. Montherlant s'était repris de sympathie pour l'idole de sa jeunesse, inspirateur du Songe. Motif de ce revirement : comme d'Annunzio, il souffrait des yeux.
— Avez-vous relu Notturno? me demanda-t-il sévèrement.
C'est le recueil de poèmes composés par le «Commandante» quand il dut vivre dans le noir, pendant des semaines, pour lutter contre une menace de cécité. J'avais relu « Notturno», dont j'admirais la sérénité courageuse. C'est le livre le plus sobre de d'Annunzio. Le plus émouvant aussi.
Montherlant trouvait que je n'avais pas assez tenu compte de ce que subit moralement un homme qui craint de perdre la vue. Il me priait de noter que la méditation dannunzienne est « exempte de tout mysticisme», c'est-à-dire de tout sentiment religieux. Néanmoins, interrogé par moi, un autre jour, sur son agnosticisme, Montherlant concéda qu'« au-delà de la mort, il y a quelque chose».
En quoi consiste ce quelque chose ? il déclarait l'ignorer.
Cette conversation-là, l'avant-dernière, s'acheva par un échange de remarques sur La ville dont le prince est un enfant.
En 1953, il m'avait demandé si, à mon avis, cette pièce pouvait être représentée, j'avais répondu : « Non. Elle causerait un scandale. Mais plus tard, dans quelques années, ce serait possible, si vous coupiez deux répliques scabreuses, qui me semblent de trop».
En 1972, je le lui rappelai. Sa « tragédie moderne» était jouée avec grand succès et sans le moindre scandale. Les temps avaient changé. Avait-il coupé les deux répliques ? Il ne me répondit ni oui ni non. Soutenant toutefois que la nuance qui me choquait était nécessaire : « Sinon, mes héros n'auraient plus rien à sacrifier. Il n'y aurait plus de pièce».
La dernière fois, il discuta certains passages de mon « Secret de Montherlant» (SM d'octobre 1971). Spécialement, ce que j'avais écrit de ses fiançailles. Les deuxièmes avaient-elles été plus tendres et plus libres que les premières ?... A ce sujet, je m'étais fondé sur un passage daté des Carnets. Il secouait la tête. « II y avait beaucoup d'autres filles à ma disposition», s'écria-t-il, en brandissant la coupure de l'Argus. C'est alors, sans transition, qu'il en vint à la mort d'Hemingway. Je l'interrompis pour m'informer du sort fait à ses notes et à son journal intime. Cela le fît rire. Il en avait jeté une partie à la Seine «sans le moindre regret».
— Ces papiers n'ont plus d'intérêt. Et cela ne regarde personne... Ma vie
privée..
— Un jour ou l'autre, elle sera fouillée de fond en comble. Comme celle de tous vos prédécesseurs.
Il rougit de colère.
— Tout se saura, continuai-je. Il faut en prendre votre parti. C'est le prix dont vous payerez la qualité de grand écrivain.
Et de lui expliquer que cette qualité apparaît souvent avant même qu'elle ne soit justifiée par des ouvrages tout à fait accomplis. Il m'écoutait, avec, dans ses pauvres yeux malades, une lueur de surprise.
— Vous avez sans doute raison», conclut-il.
Sur son front tombait une ombre. Il se renversa et elle lui couvrit le visage, II se leva, me tendit la main, partit.
C'était, de nouveau, un petit homme usé, blessé, acculé, un vieillard aux pas hésitants qui s'en allait, avec un reste d'énergie. Ce reste, toujours indomptable, qu'il lui fallait, le moment venu, pour« prendre ses dispositions», comme il disait, et pour mordre sur un canon de pistolet, en appuyant sur la détente.
Robert Poulet
Sources : Le Spectacle du Monde – Novembre 1972