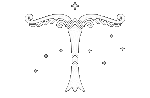L’an 1919, cinq jeunes gens français sentirent le besoin de former entre eux une société un peu codifiée et un peu âpre. Les deux aînés, de vingt-cinq et vingt-trois ans (j'étais celui-ci), venaient de combattre. Les autres avaient vingt et un, seize et quatorze ans.
Je n'ai jamais évoqué sur le papier ce petit mouvement, parce qu'assez tôt je le détournai, et en fis autre chose : en le mêlant, dans mes écrits, à cette « autre chose » — qui fut l'esprit du stade, — j'aurais embrouillé tout. Et parce qu'en vérité nous ne l'approfondîmes pas plus, que nous ne le menâmes à sa fin. Mais comme nous voici de nouveau au terme d'une guerre, je reprends intérêt à ce mince remous que fit l'autre en s'enfonçant.
Choix du clan. Ce que nous y apportions. Juvénilité.
A tort ou à raison, le monde où nous, combattants, nous ressuscitâmes en 1919, nous le vîmes abject. C'est le temps où je publiais dans la revue les Lettres un article intitulé : France, pitié du monde ; l'année de la victoire, il me semblait que la France ne pouvait que faire pitié à tous; et la suite a prouvé qu'en effet la France de 1919, qui était grosse de la France de 1940, méritait bien déjà de faire pitié. Il apparut à ceux d'entre nous qui furent les promoteurs de cette société, que deux voies seulement s'ouvraient à nous pour échapper à une telle abjection : celle de la conduite solitaire, et celle du petit clan. Il ne pouvait être question un instant que l'individu fût sacrifié ; je pensais et je pense que l'individualisme est le produit des civilisations supérieures. Mais aucun de nous ne voulait être un solitaire. Nous choisîmes donc le petit clan. Au vrai, lorsqu'une société de cette sorte est aussi réduite, chacun de ses membres ne la sent pas très différente de lui-même : l'individu y prend des rameaux, mais les remplit.
Je venais d'être démobilisé, et étais loin d'en avoir mon saoul : l'ennui naquit un jour de l'uniforme ôté. P., l'autre promoteur, qui avait vingt et un ans, n'avait pas été soldat. J'apportais une insatisfaction guerrière, du mépris pour les civils, de la sollicitude tendre pour les sentiments héroïques : dans le latin du moyen âge, mon patronyme signifie « chevalier », P. apportait la même insatisfaction, quoique plus virulente, et la passion de verser et de pétrir, dans un moule civil, une morale militaire analogue à celle dont il n'avait pu goûter. J'apportais, avec le sens de la Castille, quelque christianisme d'imagination, sans foi et sans pratique (mon bagage gréco-latin, qui était mon seul bagage culturel, ne fut pas employé du tout dans cette affaire). P. apportait une certaine connaissance du moyen âge européen, une teinture de la philosophie et de la morale japonaises, et un penchant vif pour ces fortes individualités de l'ancien Japon, aventuriers et condottieres, les Nobunaga, les leyasu, les Yamamoto Kansuka, que nous utilisâmes dans l'élaboration de notre romanesque. Ce fut l'apport de P. qui donna sa couleur au groupe.
Il faut prévenir sans tarder que tout cela était très juvénile, et plus peut-être qu'on n'attendrait de garçons dont trois étaient « majeurs » et deux guerriers, cités, blessés, etc. Mais on a répété maintes fois qu'il y a quelque chose d'enfantin dans le militaire; armée, école, tout cela est « collège »; et la chevalerie était un collège elle aussi (1). Enfin, il n'y avait pas plus de six ans qu'un des aînés fondait, à l'école, une petite société semblable à celle qui nous occupe ici : à Sainte-Croix de Neuilly nous avions eu « la Famille », composée de huit membres (comme les huit fondateurs de l'Ordre du Temple), que les autorités du lieu persécutèrent et finalement dissolvèrent : toute chevalerie se paie. Ensuite, à la guerre, nous avions connu l'esprit de corps, à tous ses degrés : le régiment, le bataillon, la compagnie, la section. Et c'est parce que nous étions très juvéniles qu'en souvenir des ordres de chevalerie nous nommâmes « l'Ordre », sans plus, notre institution. Toutefois nous évitâmes, même comme un jeu, appellations et insignes : nos insignes étaient intérieurs. Bien que deux d'entre nous fussent encore presque des enfants, on n'avait pas besoin pour les séduire d'une pacotille d'insignes, de grades ou de rites : ad populum phaleras. Nous étions juvéniles, mais je crois que jamais nous ne fûmes niais. Et je regrette que tous les mouvements éducatifs n'observent pas pour eux-mêmes cette nuance.
Un acte de séparation (orgueil de L'Ordre).
Donc, au principe de l'Ordre, un besoin de séparation d'avec le milieu, pour pouvoir vivre une vie respirable; un repliement, non sur soi-même, mais sur une poignée d'êtres choisis. Oui, l'Ordre naquit, d'abord, d'une réaction. Nous nous pensions et nous disions le meilleur, et tel que tous eussent dû être. Pour un peu, nous eussions à longueur de jour donné des leçons à tout le monde; le pli m'en est resté. Du mépris, j'avais de quoi en fournir à notre groupe au complet, sans en rien perdre. (J'ai vu depuis que le mépris est une pente qu'il est difficile de remonter.) Et, de tel de nos camarades, un autre disait : « Quand une feuille d'automne, se détachant, lui tombe sur le crâne, il trouve que l'arbre lui a manqué. »
Je crois que ces traits sont communs à toutes les chevaleries : le chevalier, chrétien ou japonais, s'oppose par essence au bourgeois. Il ne saurait en être autrement pour quelqu'un qui porte une civilisation intérieure plus rare et plus avancée que celle qui a cours autour de lui. L'orgueil est un devoir pour les bushi (chevaliers japonais) (2). Pas un des jésuites de là-bas, au XVIIe siècle, qui ne se plaigne de leurs dédains; selon moi, c'étaient des dédains attrayants. L'orgueil gonfle nos chevaliers féodaux, prenant souvent la forme délirante, un orgueil de panthère, chez ceux de Castille (3) : l'Eglise n'a pas trop de toutes ses foudres et de toutes ses pratiques d'humilité, pour les garder en main (et de cela devraient se souvenir les gouvernements : le catholicisme est un élément d'ordre dans une société pléthorique, et un élément de mort dans une société dégénérée et débile (4). D'ailleurs la chevalerie européenne n'était pas aimée. Sans parler de la haine générale, et de l'envie, contre le Temple et contre l'Ordre de Calatrava (ni même des outrages qu'on inflige à Don Quichotte), la chevalerie était détestée par l'Eglise, qui a toujours cherché à ruiner tout ce qui avait ou pouvait avoir une influence; par la royauté, qui prenait ombrage de son indépendance, de sa puissance et de sa fierté; je pense que le petit peuple lui portait plus de respect que d'amour, et qu'il y avait surtout de la crainte dans ce respect.
Et un pacte de solidarité.
Il me semble que l'Ordre fut premièrement un acte de séparation et un pacte de solidarité, et que les vertus que nous y enfournâmes ne viennent qu'après. Solidarité, c'est le caractère qui en fut le plus résistant, et observé avec le plus de scrupule. « Entre nous c'est à la vie à la mort » nous disait le cadet, ou: « Je ne te ferai jamais de vacheries », qui sont les deux expressions extrêmes, la noble et la triviale, du besoin d'absolu qu'a l'adolescence. Je fis rentrer cela dans l'humain; notre pacte fut réduit à quatre années; c'est déjà beaucoup. Il était non seulement de ne faire jamais quoi que ce fût l'un contre l'autre, mais de tenter d'empêcher, par toutes ses forces, le mal qu'un tiers pouvait vouloir à un de nous; et de s'aider, en n'importe quel rencontre.
Cet engagement, dans l'ensemble, nous le tînmes. Il n'est pas tout à fait vrai que nous nous entraimions également, comme les douze Pairs ; mais nous faisions, pour l'Ordre, ce que peut-être n'eût pas dicté l'élan spontané. Si tel d'entre nous s'oubliait à agir contre un autre membre, celui-ci le lui pardonnait incontinent : « Le pardon se formule en moi à l'instant même que vous m'offensez », est une parole que j'ai entendue. Et je me vois encore, quelques heures après avoir posté une lettre malgracieuse à l'adresse d'un de nous, pensant avoir à me plaindre de lui, lui expédier un pneumatique où je lui marquais avec fermeté que je ne l'abandonnerais jamais. Et ces seconds mouvements ne venaient pas du cœur; ils n'étaient qu'observance de notre règle.
L'assistance pécuniaire elle-même, bien que secondaire, n'était pas omise de l'Ordre, car deux de nos camarades, quoique bourgeois, crevaient de faim quasiment. Cette assistance, elle non plus, n'était donnée ni par pitié, ni par charité, ni par largesse, ni par amitié; elle n'était qu'obéissance à la loi de l'Ordre. De même déjà, dans notre chevalerie de Sainte-Croix, un des membres, Marc de Montjou, en soutenait un autre, et cela sans la moindre contre-partie d'aucune sorte de la part de celui-ci.
Il est à peine besoin de dire que le monde ne vit jamais, de notre société, que le fait que nous étions amis. Sur tout ce qui se passait entre nous, et plus particulièrement, peut-être, sur les déconvenues qu'il nous arrivait de nous donner les uns aux autres, le secret était des plus profonds.
Morale de l'Ordre. Ce qu'on y trouvait.
Quelle était notre morale, qui était, comme le bushido (5), une morale pratique (6)? (Et nous aimions fort que dans l'éducation des samouraïs il n'y eût place ni pour la métaphysique ni pour les maths, etc., mais seulement pour la morale, et pour la seule morale qui soit défendable, celle des sentiments chevaleresques.) Je renverrais volontiers mon lecteur, sans autre commentaire, à la « Lettre d'un père à son fils », de Service Inutile, si je n'avais retrouvé une mienne note manuscrite de 1919, où je lis ces mots : « Droiture, fierté, courage, sagesse. » Là-dessous un tiret, qui indique que nous avons épuisé les vertus cardinales, et que celles qui suivent sont d'un ordre un peu moins éminent; et elles sont : « Fidélité, respect de sa parole, maîtrise de soi, désintéressement, sobriété. » Cette énumération est un peu différente de celle de la « Lettre », tracée treize ans plus tard.
Il semble d'abord qu'il n'y ait rien là qui ne soit dans toutes les morales, et dans la morale « naturelle ». Mais nous poussions chacun de ces sentiments au chevaleresque, je veux dire que nous l'aiguisions fort; et un sentiment bien aiguisé pénètre toujours un peu plus profond qu'il n'est dans les convenances. En ce sens, notre morale était, comme toutes les morales de clan, un peu hors la loi, un peu « dangereuse ». C'est ainsi que nous eussions fait, sans le moindre remords, un faux témoignage devant les tribunaux, pour sauver un des nôtres.
Elle était peut-être « immorale », aussi, de ne valoir guère qu'entre nous. De même on a reproché au bushido d'être immoral par manque de respect pour les droits de ceux qui ne faisaient pas partie de la caste militaire.
………………………………………………………………………………………………….
J'ai dit que nous ne portâmes jamais d'insignes. Mais nos couleurs étaient, idéalement, le noir et le blanc, — soit que P. les eût choisies telles pour avoir été les couleurs de l'étendard des Templiers, et celles du vêtement des chevaliers teutoniques, soit que je fusse entêté du noir de ma Castille, sinon du noir et blanc de la Prusse. Mais lorsque, l'Ordre dissous, j'appris, dans les stades, que les « individuels » — sportifs, qui ne veulent appartenir à aucun club — portaient le maillot noir, parce que le noir (ce que j'ignorais) est la couleur de l'anarchie, et lorsque ce maillot fut celui que j'endossai le premier, je rêvai un peu. L'Ordre n'était pas une anarchie, puisqu'il avait sa loi. Mais sa loi n'était pas celle des autres, ou ne l'était que de ça de là, et par fortune. Une loi de cette sorte perdit le Temple.
Morale de l'Ordre. Ce qu'on n'y trouvait pas : la religion, la galanterie, le prosélytisme.
P., d'abord catholique croyant, avait eu une crise, puis s'était séparé avec violence, et se vengeait d'avoir cru. Il vidait la chevalerie chrétienne du christianisme : œuvre téméraire, et qui semblerait absurde, si nous n'avions malgré tout bonne mesure de chevaliers athées et « blasphémateurs »; je songe à Gaumadras dans Garin de Montglane, à Raoul de Cambrai qui se fait servir force viandes le vendredi saint, à Guillaume d'Orange qui donne des coups de pieds aux moines, dans le Moniage Guillaume, à Hachembaut et à son explosion de nihilisme dans Doou de Maience; Et il y en a d'autres. Par-là, P. retrouvait le bushido. La religion du bushi est très vague; le shintoïsme ne s'occupe presque pas de l’immortalité de l'âme; la chevalerie japonaise est une chevalerie d'athées, qui deviendra même, au XVIIIe siècle, une chevalerie de « blasphémateurs »; le marquis Ito, « le plus grand Oriental depuis Confucius », prétend que les Japonais sont le peuple le plus athée de l'univers. Là encore l'Ordre continuait la « Famille » de Sainte-Croix, où nous réalisâmes ce paradoxe que, gouvernés et excités par des prêtres, toute notre chevalerie, et nous en eûmes! ne fit jamais la moindre part au surnaturel, et que Jésus-Christ n'y compta aucunement.
…………………………………………………………………………………………………
Une autre façon de rejoindre le bushido, c'était d'exclure de notre morale, non pas, loin de là, tout rapport avec le sexe, mais toute galanterie. Nous nous essayions à une civilisation où il n'y avait de place ni pour les prêtres, ni pour les femmes, ni pour les bourgeois. La femme ne joue aucun rôle dans la majoration romanesque du bushi : elle est faiseuse et éleveuse d'enfants, rien de plus; hommes et femmes, d'ailleurs, ne sont jamais en commun; dans aucune classe de la société japonaise la femme n'est plus dédaignée ni moins libre. Et là encore, malgré l'apparence, nous ne sommes pas si éloignés de la chevalerie européenne. Pour quiconque « sent » la chevalerie, la grande époque de la chevalerie, où elle fut une chose qui force le respect et l'amour même d'un anti-chrétien déclaré, ce sont les XIe et XIIe siècles. Or, en ce temps-là, les chevaliers n'ont que mépris pour les femmes; presque tous pourraient dire, avec Raoul de Cambrai : « Maudit soit le chevalier qui va demander conseil à une dame »; souvent, dans notre littérature épique, on les voit les frapper jusqu'au sang, seulement parce qu'elles jaspinent trop, pour les faire taire; et ils en ont d'ailleurs le droit, O lectrices des petits journaux de modes, flétrissez comme il se doit ces soi-disant preux, qui n'étaient en somme que des « mufles »! Loin que les femmes aient joué le noble rôle que l'on croit dans la chevalerie, elles ont été un des ferments de sa décomposition, lorsque, au milieu du XIIIe siècle, leur goût, devenant maître, a imposé le passage de la saine et sublime littérature germanique des chansons de geste aux niaiseries fades et fausses des romans bretons de la Table ronde. Les romans de la Table ronde, sous le couvert de la galanterie, c'est la chiennerie qui commence; et c'est — plus grave encore, — la morale de midinette, qui, depuis lors jusqu'à nos jours, en l'émasculant et en l'éloignant du réel, a fait tant de mal à notre France.
Enfin l'esprit de prosélytisme n'était pas dans l'Ordre. Nous « donnions des leçons », mais peu nous importait si elles fructifiaient. De même, bien que nous n'eussions aucune opposition de principe à l'admission de nouveaux membres dans l'Ordre, et que nous y eussions accueilli volontiers qui nous eût plu, notre société, dans les quelque dix mois qu'elle resta vivante, ne s'accrut pas.
Caractères de l'Ordre. Une pointe de Jansénisme.
Toujours, au milieu de mon goût pour les délices, circula un courant austère : Sparte, Plutarque, Sénèque, la Castille, le Jansénisme, la guerre. Toujours je trouvai en moi deux catholicismes, le catholicisme non pris au sérieux, c'est-à-dire le catholicisme à l'italienne, le catholicisme « homme de la Renaissance », et le catholicisme pris au sérieux, c'est-à-dire le Jansénisme; et je les alternais, d'imagination (n'ayant, bien entendu, ni foi ni pratique). J'inventai de fourrer du Jansénisme dans l'Ordre. Port-Royal et l'Ordre sont de petites sociétés que roidit un esprit d'opposition et de réforme, où l'on se tire du pair, ou croit s'en tirer, par ses vertus (remarquons, d'autre part, que tous les bushi, même le shogun, prennent à cinquante ans l'habit d'un ordre religieux ou d'un tiers ordre). Saint-Cyran est Basque, le « côté espagnol » de la sœur Angélique a été souvent signalé; par eux je rejoignais la chevalerie espagnole et Don Quichotte. Je m'animais de ce que l'année 1616, où commence le règne des Tokugawa, qui selon certains auteurs voit l'apogée du bushido, fût l'année où Saint-Cyran et Jansénius, à Bayonne, étudient saint Augustin et fondent le Jansénisme. Et de quoi encore ne m'animais-je pas, la bonne volonté à coup sûr y étant!
Par-là, et par-là seulement, je mettais dans notre Ordre une goutte de christianisme. Elle ne fut pas longue à s'évaporer.
Caractères de l'Ordre. Humanisme et délices.
Le bushido, dès qu'il se forme, est déjà, à la fois, une sagesse et un héroïsme, une sagesse de cape et d'épée : la voie du sage et la voie du héros courent parallèles. Il sera aussi, plus tard, un humanisme et un jardin de délices. Des héros qui ne sont pas des imbéciles! O rare spectacle!
Nous attendions l'épreuve, mais l’épreuve-test, non l’épreuve-douleur. J'en veux et en ai toujours voulu à cette croyance, si enracinée dans l'Occident, que le héros doit n'être pas heureux. C'est une croyance petit-luxe. Il faut qu'il soit heureux, aussi; bien que héros, et parce que héros. Risquant sans cesse sa vie, par goût, et l'immolant avec folie, le bushi, nous dit un auteur, est cependant « épris d'une vie que le shinto déclare divine »; et on sait que les Japonais n'avaient pas moins de sept dieux pour le bonheur. Voluptueux et stoïque : alliance que symbolise ce condottiere japonais qui partait en campagne avec un éventail de fer, selon l'usage des généraux de ce temps, et s'en servait à l'occasion comme de masse d'armes pour assommer les ennemis.
Les bushi, du moins à partir de l'époque de la Renaissance, sont aussi lettrés et artistes. Avant, même : souvenons-nous du vers favori d'Ieyasu, homme d'action et homme d'Etat : « II avait décidé, non de vivre, mais de savoir. »
J'aime le sang et le lait, comme les Mânes. Ce sang pur et sévère, qui était celui de l'Ordre, coulait comme à travers un lac de lait parfumé. Un guerrier qui n'était pas un artiste était pour nous une bourrique, et un artiste qui n’était pas un guerrier était pour nous une femme. Deux de notre Ordre, Dieu me pardonne, faisaient figure d'intellectuels. Et tous garçons de l'enseignement secondaire : « rosa la rosé » était consciencieusement arrosée dans notre horlus deliciarum, qui était aussi un champ clos de combat : alors comme aujourd'hui j'aurais préféré voir mon fils mort, à le voir ignorer le latin. Bien qu'il y eût des chevaliers chrétiens et des samouraïs qui n'eussent pas de naissance, nous n'imaginions pas (je dis les choses telles qu'elles furent, sans juger) que l'Ordre pût fleurir en dehors d'une certaine condition sociale: condition sur laquelle, certes, nous n'étions pas exigeants; mais il y fallait un minimum.
Deux images de l'Ordre.
Avant de finir, je voudrais donner deux images de l'Ordre, choisies à ses extrémités : l'une sublime, l'autre brutale, ces deux caractères étant inhérents à toute chevalerie.
Première image. — L'Ordre était mort, et il jeta encore un long rayon de soleil couché. Notre institution, en fait, était dissoute. Mais un de nous se souvenait du pacte de quatre ans, et pensait qu'il le devait observer malgré tout, du moins avec ceux qui témoignaient d'en avoir besoin. Un tel le témoigna, et il était celui qui méritait le moins. Il avait fait sa fleur et son feu, quand l'esprit de l'Ordre l'alimentait; seul, il était peu, et allait toujours s'amincissant. Toutefois, celui de nous qui voulait soutenir le pacte n'abandonna pas ce garçon, pour autant. Durant les trois années qui restaient à courir, il l'appuya de ses conseils, de son aide, de ses deniers. Cependant il ne l'aimait pas, et ne l'avait jamais aimé. Il était comme ces catholiques de baptême qui reçoivent l'extrême-onction : le christianisme est mort dans leur cœur; ils disent les paroles sans y croire, puis cessent d'être silencieusement. «Pourquoi faire tant pour lui? » lui demandais-je un jour. Il me répondit : « Parce qu'il en est indigne. » Cela était l'Evangile, je pense.
Quel poids lourd, quel poids horrible, que donner les marques de l'affection, sans l'affection! Les quatre ans révolus, du jour au lendemain il le laissa tomber. Ouf! Quelle délivrance! L'autre eut l'esprit de le bien prendre, ou peut-être de ne s'y pas frotter. On dit que les actes restent, que les paroles restent; les êtres non. Dieu merci.
Maintenant il faut aller à l'autre bout; on croirait que nous ne vivions que sur les hauteurs. Cela n'est pas mon genre, ni celui de qui j'aime; la nature était forte en nous.
Donc, nous voici partant pour quelque forêt suburbaine, Rambouillet ou Fontainebleau. Nos épées sont des brownings, avec lesquels nous chasserons les lapins des halliers (chasse tout idéale : oncques n'en tuâmes un). Là-bas, nous louons des vélos, qui seront nos Bavieça et nos Veillantif, car il ne s'agit de rien moins que de combats singuliers; et fort singuliers, on va le voir. Sur une route un peu solitaire, deux d'entre nous, enfourchant leurs vélos, prennent du champ, en sens opposé. Puis ils virent, foncent à toute vitesse, et se jettent littéralement l'un sur l'autre, vélo sur vélo. Si on a pris son élan de quelques mètres, le vainqueur est celui qui ne sera pas démonté. Si on l’a pris, comme il nous arrivait, de soixante à cent mètres, la violence du choc démonte les deux champions, et le vainqueur est celui qui est le moins blessé.
D'ordinaire, une seule de ces rencontres suffisait à mettre hors de cause chevalier et destrier. Nous n'avions plus qu'à regagner la ville, à pied, passant d'abord chez le pharmacien, pour nous faire réparer, puis chez le loueur de vélos pour régler la douloureuse, souvent seigneuriale à souhait, car jamais vélo ne sortit tout à fait indemne de ces jugements de Dieu. Nous étions presque contents lorsqu'un de nous était un peu sérieusement blessé, et nous affections de ne nous occuper guère de lui, comme ces parents qui pour rien au monde ne sortiraient de l'immobilité, s'ils voient leur petit enfant s'étaler, à quelques pas d'eux.
Cet exercice, dont je m'honore d'avoir été l'inventeur, je l'avais baptisé le tang-tang : on admi¬rera au passage l'euphonie japonaise de ce mot. Quand je me remémore les jeux qui fouettèrent le sang de nia jeunesse, je songe à la tauroma-chie, au sport, à la guerre... Mais le tang-tang n'est pas oublié.
Déclin et mort de l'Ordre....
La petite société des héros et de ceux qu'ils aiment portait en elle un principe de mort : ma présence. C'était moi qui l'avais fondée, mais, n'est-ce pas? aedificabo et destruam. J'y mettais quelque chose de trop tendu pour ne devenir pas, un jour, un peu convulsif ; et quelque chose de douloureux; enfin, paraît-il, une atmosphère irrespirable, comme si dans tout cela je n'avais cherché, sans le vouloir, qu'à aviver une conscience toujours plus pathétique de moi-même. Où donc ai-je lu cette phrase : « De toutes les choses d'ici-bas, la chevalerie est celle qui est la plus réfractaire à la nuance »? L'Ordre mourut de trop de nuances, ou plutôt de ce que nous les ressentions avec trop de pointe. Il mourut, mourut avec lenteur, oh! On peut dire qu'il se sentit mourir dans tous ses moments; nous n'en perdîmes pas une goutte.
Il fallut donc sortir. Sortir, c'est-à-dire se salir. Mais il est hors de doute que, si nous nous salîmes quelque peu, ce fut cette fois à l'air libre. L'Ordre des derniers temps n'était plus qu'une boîte fermée, une machine à se faire souffrir les uns les autres.
P. alla vers le scoutisme (non confessionnel). Moi et N. vers le sport athlétique. Les deux autres s'écoulèrent et se diluèrent au sein d'une vie inconsistante : ils n'ont pas eu plus de part à ce monde que les poissons n'en ont à l'océan.
On peut, si on veut, trouver des analogies entre l'Ordre et le sport : le petit clan devient l'équipe, l'esprit chevaleresque le fair play; et les vertus du sport, ascèse, exclusion des femmes, etc., nous venons de les voir ailleurs. Tout ne serait pas faux dans ce rapprochement, mais je ne le nourris jamais. Ordre et sport restèrent pour moi des choses distinctes.
Vie éternelle de l’Ordre.
Quand notre « Famille » de Sainte-Croix fut arrivée à un point où, elle aussi, elle ne pouvait plus que mourir, un jésuite, qui avait vu pourtant quelque chose de son intérieur, nous dit : « Vous sourirez de tout cela quand vous aurez vingt ans. »
Phrase ineffaçable, merveille de l'aveuglement, monument de la matière. Trente années ou presque ont passé, et cette « Famille » dont je devais sourire, je ne l'évoque qu'avec un serrement du cœur; je l'évoque comme le temps le plus pur de tout le temps que j'ai jamais vécu.
De l'Ordre non plus je ne souris pas aujourd’hui. Il dura moins de dix mois, la « Famille » en avait duré six à peine; mais c'est l'intensité qui est tout. Et la magnanimité. Nous eûmes de l'une et de l'autre. Que le reste soit effacé.
En juin 1940, de la Somme à Compiègne, on voyait de petits groupes d'hommes durs et désespérés, qui s'obstinaient autour d'une mitrailleuse à chargeur rigide, ou d'un canon minuscule, tandis qu'alentour, à droite, à gauche, roulaient vers l'arrière les mille torrents de ceux qui décidément préféraient vivre. Eux aussi, comme ceux de tous les Ordres, ils étaient opposés ici et opposés là : opposés à l'ennemi, qui les massacrait, opposés à leurs frères qui les abandonnaient et qui, les abandonnant, leur en voulaient encore (car nous le savons maintenant plus que jamais, l'homme n'aime pas les braves). Eux aussi, comme ceux de tous les Ordres, croyant faire ce qu'ils faisaient pour une cause extérieure —- ou peut-être ne le faisant même pas pour cela, car dès alors la partie était perdue, — ils ne le faisaient en réalité que pour eux-mêmes; elle est fausse, la devise des Templiers, et fausse pour n'importe quel Ordre : Domine, non nobis. Et je me dis que, s'il y avait eu en France plus de ces petits groupes…
Conclusion
La « Famille » de Sainte-Croix vit le jour la veille même de la guerre de 1914. Et l'Ordre vit le jour à son lendemain même, comme si c'était la « Famille » qui ressortait après avoir coulé en souterrain pendant les quatre années de la guerre. Pareillement, lorsque, en mai 1940, j'abandonnai ma table de travail pour aller au champ de bataille, j'y laissais les feuillets d'une étude sur Port-Royal, qui m'occupait depuis plusieurs mois. Et lorsque j'en revins, je me sentis pressé d'écrire sur l'Ordre, comme si c'était, Port-Royal que je reprenais. J'en conclus que l'esprit de chevalerie fleurit au bord des guerres, comme l'edelweiss au bord des abîmes (pour moi du moins).
J'ai dit en commençant que l’Ordre naquit par réaction contre une société qui nous apparaissait abjecte. Nombreux sont donc ceux qui penseront qu'une évocation de l'Ordre n'est pas à sa place dans la France nouvelle. D'autres penseront qu'elle a peut-être sa place, dans une nation humiliée. D'autres penseront qu'il y a là un accent et un langage d'un autre monde, dont il n'y a aucune chance —- à espérer ou à craindre — qu'ils puissent être entendus aujourd'hui.
H. DE MONTHERLANT
Sources : Le Solstice de juin - Juillet 1940.
Notes :
(1) Une des formules de l'adoubement du chevalier : Te in nostro collegio accipio (quand il reçoit la chevalerie).
(2) A Nikko, au tombeau de Ieyasu, situé sur une éminence boisée, où l'on monte par deux cents marches, d'où descendent les cascades, sont inscrits ces vers enivrants, qu'il aimait à s'appliquer à soi-même :
Ici est la cime. La multitude qui est au-dessous
vit comme elle peut.
Cet homme avait décidé, non de vivre, mais de savoir.
Enterrez-le ici.
Sa place esî ici} où des météores éclatent, où des nuages se forment
d'où partent les éclairs,
où les étoiles vont et viennent.
Que la joie accueille la tempête!
Que la rosée envoie la paix!
Des desseins sublimes doivent avoir des effets sublimes.
Laissez-le être couché sur la hauteur.
Plus sublimes encore que le monde ne le soupçonne ont été sa vie et sa mort.
(3) Un seul trait : alors que partout, au moyen âge, l'homme a besoin de son semblable pour être armé chevalier, le Castillan s'arme soi-même.
(4) Tolstoï, étudiant la victoire, japonaise sur les Russes en 1905, l’attribue au fait que les Japonais ne sont pas chrétiens. (Teruaki Kobayashi, la Société japonaise, p. 40).
Les bushi combattaient aussi le bouddhisme, autre mode d’énervement. Tout ce qui est enlevé à la religion peut et doit être donne à la patrie.
Renan compte, parmi les causes d'affaiblissement de l'armée romaine à la fin de l'Empire, l'introduction du christianisme dans les cadres et la troupe. Toutefois, gardons-nous ici des généralisations trop abruptes. Mais il semble logique que le goût de la faiblesse, l'excitation nerveuse, la peur de l'enfer, propres au christianisme, anémient un peuple. L'indifférence à la mort des hommes de l'antiquité, aujourd'hui des Musulmans, des Japonais, en fournirait la contre-épreuve.
(5) Je rappelle que ce mot désigne, au Japon, le code des bushi (nobles) et des samouraïs. Peut-être, toutefois, nous étions-nous crée un bushido d'imagination. Mais y eut-il jamais un autre bushido que d’imagination? Voir, à l'article bushido ajouté par Chamberlain a la traduction française de son livre, ce qu'il y aurait a rabattre de l'idée qu'on se fait de cette institution.
(6) Comme l'avait été déjà celle de la « Famille ». « Nous y avons appris la morale par la pratique », ai-je écrit de Sainte-Croix (Relève du Malin).