- Détails
- Catégorie : MEMOIRE

La Lituanie, comme ses nations sœurs baltes, la Lettonie et l’Estonie, est un beau pays dont l’histoire a été très dure et méconnue au cours du siècle dernier. En mai 1940, en vertu du pacte Ribbentrop-Molotov, les pays baltes ont été occupés par l’Union soviétique et annexés un mois plus tard.
Comme dans le reste des territoires occupés par l’URSS, l’appareil répressif soviétique lance une campagne d’élimination des prétendus « opposants politiques » et des milliers de citoyens baltes sont assassinés et déportés.
C’est ainsi que sont nés les premiers mouvements de partisans pour combattre l’occupation, les « frères de la forêt ». Après l’invasion allemande en juin 1941, beaucoup de ces partisans ont rejoint le nouvel occupant pour combattre les Soviétiques, tandis que d’autres sont restés dans les forêts.
- Détails
- Catégorie : MEMOIRE

Lorsque Révolte contre le monde moderne (Rivolta contro il mondo moderno) a été publiée pour la première fois en Italie en 1934, le livre est passé presque inaperçu. Non pas qu'il n'ait pas trouvé ses lecteurs, car son auteur, le baron Julius Evola (1898-1974), alors âgé de trente-cinq ans, était déjà suffisamment célèbre dans certains cercles (artistiques, hermétiques, philosophiques et politiques), mais il a été écarté par les autorités locales. Six ans plus tôt, en 1928, au moment même du rapprochement de l'État italien avec l'Église catholique, qui aboutira bien vite à la conclusion des accords du Latran, le baron doit faire face à des attaques indiscriminées tant du côté catholique que du côté du régime - fasciste -, après avoir publié un recueil de ses essais sous le titre Imperialismo pagano (Impérialisme païen). Cela n'a cependant fait que contribuer à la notoriété du titre et de l'auteur. Cette fois, donc, les adversaires d'Evola ont décidé de passer son œuvre plutôt sous silence...
Lire la suite : L'histoire de « Révolte contre le monde moderne », le livre-culte de Julius Evola
- Détails
- Catégorie : MEMOIRE
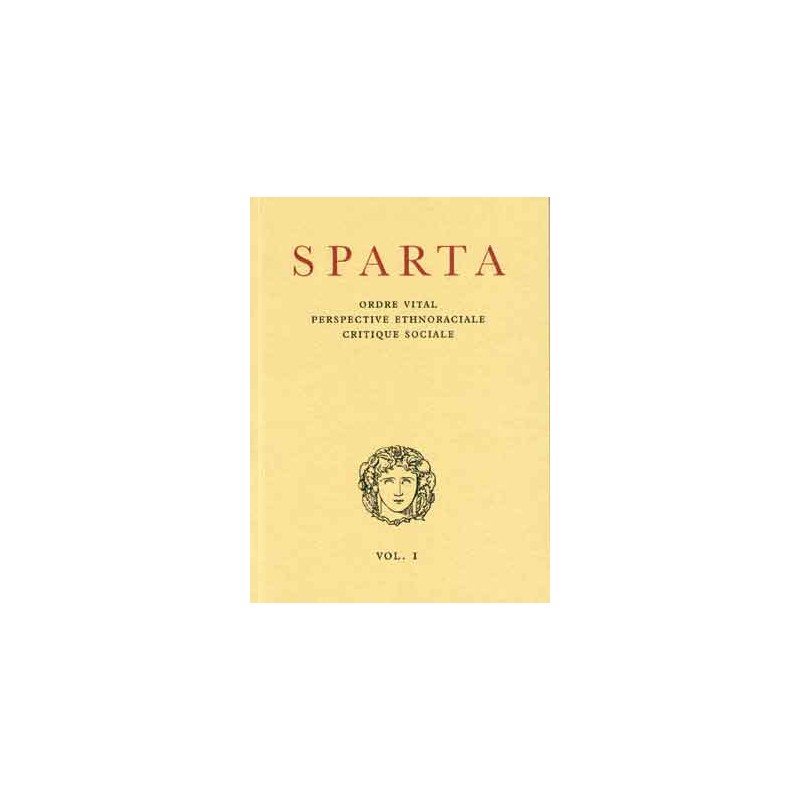
Nous vous proposons ci-dessous de découvrir la publication Sparta, nouvelle revue de réflexion culturelle, politique, métapolitique et philosophique, qui est parue il y a quelques mois sous la direction de Philippe Baillet (Terre & Peuple avait déjà annoncé la sortie de cet excellante publication) . Pour en parler, Breizh-Info.com a interviewé P. Baillet :
Breizh-info.com : Pouvez-vous tout d’abord vous présenter à nos lecteurs ?
Philippe Baillet : Né le 21 janvier 1951, je viens d’avoir 70 ans. Je suis issu d’une famille du Pas-de-Calais, non pas de l’ancien bassin houiller, mais du littoral, de Boulogne-sur-Mer à Berck en passant par Le Touquet. Socialement parlant, je viens d’un milieu de la classe moyenne, mais qui connut un grand déclassement à partir du milieu des années 50. J’insiste sur ce point car il me singularise : tout au long de mon itinéraire politico-culturel — soit depuis 1966, année de mon adhésion, à l’âge de quinze ans seulement, à la section de Saint-Cloud (alors dirigée par un certain Bernard Lugan) de la Restauration Nationale d’inspiration maurrassienne, jusqu’à la fondation toute récente de Sparta —, je n’ai pratiquement côtoyé, au sein de la droite radicale française, que des fils de la moyenne et grande bourgeoisie, chez lesquels j’ai pu constater trop souvent un grand écart entre la nature des idées défendues et la façon de les incarner. C’est aussi à cause de ce déclassement que je dus renoncer à poursuivre des études universitaires, à cause de cela encore, dans une certaine mesure, que je n’ai pu publier mon premier livre proprement dit qu’en 2010, soit un an avant de prendre ma retraite.
Je renvoie les lecteurs à mes fiches Wikipédia et Metapedia. Pour résumer très vite : après des débuts dans les rangs maurrassiens, je suis passé par ce qu’il restait du REL (fondé par Dominique Venner), puis par le groupuscule Pour une Jeune Europe, fondé par Patrick Mahé et Nicolas Tandler après la dissolution du mouvement Occident en octobre 1968. À la fin des années 60 et au début de la décennie suivante, j’eus aussi l’occasion de bien connaître le Suisse romand Gaston-Armand Amaudruz (animateur du Nouvel Ordre Européen), qui me reçut à plusieurs reprises. Ma découverte de l’œuvre d’Evola date de cette période. Cette découverte me conduisit à apprendre l’italien, jusqu’à devenir ensuite traducteur professionnel, travaillant notamment pour deux éditeurs catholiques importants (Le Cerf et Desclée De Brouwer), pour les éditions du Rocher et, ponctuellement, pour Robert Laffont. En 1977, je fus l’un des trois fondateurs de la revue Totalité, d’inspiration évolienne, avant de devenir, au milieu des années 80, secrétaire de rédaction de toutes les publications de la ND, auxquelles je collaborais moi-même. À date plus récente, entre 2010 et aujourd’hui, j’ai publié cinq ouvrages aux éditions Akribeia et plusieurs articles dans les cahiers annuels Tabou.
Breizh-info.com : Quelle est la genèse de la revue Sparta ? Quels sont ses objectifs ?
Philippe Baillet : Sparta n’est pas à proprement parler une revue, puisqu’elle n’a pas de périodicité fixe. Elle se présente comme un copieux volume de « mélanges », que nous espérons pouvoir faire paraître une fois par an. Sparta est le fruit d’une longue réflexion personnelle, partagée au fil des ans avec quelques amis et avec mon éditeur, Jean Plantin, sur les échecs répétés, depuis 1945, de la droite radicale française, que ce soit sur le plan politique (exemple le plus retentissant : l’OAS) ou culturel (exemple le plus marquant : le GRECE des quinze premières années et ce qu’il en reste aujourd’hui), et sur les causes profondes de ces échecs.
En 2018, j’ai publié un ouvrage qui est à la fois un pamphlet (par le ton) et un essai (par ses analyses et son appareil de notes abondant). Son titre résume bien les critiques que mes amis et moi adressons à la DR française : De la confrérie des Bons Aryens à la nef des fous. Par « Bons Aryens », je vise bien sûr les bons à rien franco-gaulois et leurs tares apparemment inguérissables : le « réalisme » à courte vue de ceux qui, pourtant cocufiés tous les dix ou vingt ans à ce petit jeu, s’imaginent encore que le commencement du salut viendra de la politique ; la frivolité et la futilité typiquement françaises, héritées des salons de la noblesse décadente d’Ancien Régime et sur lesquelles Abel Bonnard et Céline ont écrit des lignes féroces, mais justes ; le manque de soubassement historique (la France n’a pas connu de vrai mouvement fasciste, mais seulement des intellectuels fascistes, le seul mouvement sérieux dans le paysage ayant été le PPF, d’ascendance communiste comme par hasard) ; l’anti-intellectualisme (le pseudo-fascisme français est avant tout littéraire) et l’indifférence méprisante à la formation doctrinale ; l’esthétisme à corps perdu, stéréotypé et envahissant, façon typiquement bourgeoise de se donner une posture — mais seulement une posture — de révolutionnaire, et qui est une pathologie du « connaître par sensation immédiate », antérieurement à tout discours (c’est le sens même du terme « esthétique »), comme l’idéologie est une projection pathologique et passionnelle de la subjectivité.
Quant à la formule « nef des fous », elle vise un phénomène plus récent et dévastateur, qui n’est pas propre à la DR française, mais qui a trouvé chez une grande partie de celle-ci un terrain fertile pour une progression cancérigène : le complotisme et ce qui l’accompagne souvent, à savoir un antijudaïsme obsessionnel, rabique et, fréquemment, pour ceux qui en sont les fauteurs, « alimentaire ». Propre à satisfaire les petites têtes qui jouent aux matamores du clavier en s’imaginant qu’ils font peur au Système, le complotisme est aussi du pain bénit pour expliquer et justifier les lamentables échecs de toute une mouvance depuis 1945, en faisant ainsi l’économie de toute « autocritique positive ». Il est aussi un attrape-dingues particulièrement pernicieux.
Or, avec Sparta nous entendons précisément renouer avec des formes de vraie critique sociale, au lieu du « on nous cache tout, on nous dit rien » d’aujourd’hui, beaucoup moins drôle que la chanson de Jacques Dutronc qui avait égayé la fin de mon adolescence. Alors que la DR franco-gauloise s’est ruée goulûment sur l’Internet et ses innombrables poubelles psychiques — soit pour y fouiller, soit encore pour les remplir à son tour —, nous entendons développer une critique argumentée de la pénétration invasive du « tout-numérique » dans la vie quotidienne et de ses conséquences sur le plan anthropologique. Cela nous permettra de bien mettre en relief la tare majeure, en plus de celles déjà énumérées, de la DR franco-gauloise : un énorme « déficit d’incarnation » entre les idées supposément défendues et la vie casanière et bourgeoise de tant de soi-disant « antimodernes » qui n’ont pas compris que, fondamentalement, le monde moderne est une gigantesque entreprise d’avilissement de l’humain, autrement dit, en termes nietzschéens, une usine à fabriquer le « Dernier Homme », lequel, en dépit (ou à cause ?) des prothèses technologiques qui l’entourent, relève d’une forme de sous-humanité. À ce sujet, la vertu de probité chère à Nietzsche oblige à reconnaître que l’on observe bien plus de cohérence chez certains libertaires et certains héritiers de l’Internationale situationniste – je pense en particulier au groupe réuni autour des éditions L’Échappée, déjà en pointe il y a quelques années dans la défense de l’objet-livre face à la barbarie internétique. Les vrais « réactionnaires », au meilleur sens du terme, ne sont en effet pas toujours là où l’on s’attend à les trouver…
Toujours avec la même volonté d’explorer des pistes nouvelles, Sparta — publication ouvertement racialiste, identitaire et païenne — entend revisiter le patrimoine doctrinal en lien avec ces trois adjectifs : donc, avant tout, mais non exclusivement, le patrimoine national-socialiste. Nous avons commencé à le faire et le ferons sans aucune concession au folklore, à la complaisance, aux stéréotypes, mais avec la rigueur et la compétence qui n’auraient jamais dû faire défaut. Des auteurs comme Mabire et Venner, par exemple, qui ont beaucoup écrit sur l’histoire du national-socialisme, se sont surtout penchés sur son volet militaire, guerrier et politique, mais, en définitive, très peu sur ce prolifique laboratoire d’idées que fut le mouvement völkisch, avant 1933 et de 1933 à 1945, sans doute parce que l’un et l’autre ne lisaient pas assez bien l’allemand.
Ce sont ces lacunes que nous voulons pallier, à travers des études sur des historiens de l’art représentatifs de l’esthétique nordique, sur des théoriciens comme Baeumler, Rosenberg ou le grand penseur païen Ludwig Klages, sur le mouvement de la Foi allemande (qui entendait fédérer tous les groupes religieux non chrétiens favorables au régime national-socialiste), sur l’ordre SS et l’Ahnenerbe, etc. Quant au fascisme italien, nous ferons connaître une institution tardive du régime mussolinien, l’École de Mystique fasciste, fondée à Milan en 1940 et qui était censée jouer le rôle d’une espèce d’Ordre au sein du parti unique. Enfin, dans un registre plus classique, mais essentiel, nous poursuivrons l’étude des valeurs de l’« indo-européanité », grâce avant tout à la collaboration de Jean Haudry, qui, avec la disponibilité généreuse d’un esprit totalement libre, a d’emblée accepté d’intégrer notre comité de rédaction et de nous donner un premier article.
En résumé, nous nous proposons donc, d’abord, de remplir une fonction d’approfondissement doctrinal. Seul l’avenir dira s’il est possible d’aller plus loin que ce travail de nature théorique pour déboucher sur la constitution d’un réseau informel d’amis de Sparta et sur la formation d’une véritable sodalité nourrie par les contenus les plus élevés de l’héritage ancestral des peuples indo-européens.
Breizh-info.com : À l’heure de l’effondrement de la lecture, n’est-il pas un peu « fou » de publier une revue intellectuelle, du type de Nouvelle École, qui sera forcément une revue « de niche » encore plus petite du fait de cet effondrement ? Comment, selon vous, redonner le goût de la lecture et de la culture, notamment à la jeunesse ?
Philippe Baillet : Nous faisons le pari de l’existence d’un public exigeant, lassé des bateleurs du complotisme qui commencent à se dégonfler comme des baudruches, d’un public qui attend aussi, de la part de ceux capables d’un certain niveau de réflexion, autre chose que de l’eau tiède. Nous défendons des idées très dures par rapport aux idéologies dominantes, mais sous une forme de type universitaire, plus difficile à attaquer par le Système, avec des références précises et vérifiées, une écriture élégante et des traductions fiables. Quelques centaines de lecteurs fidèles, heureux de pouvoir lire une publication dont ils seront fiers, suffiraient à faire vivre Sparta. Nous avons bon espoir de les trouver. N’ayant pas réponse à tout, je suis incapable de répondre à votre seconde question. Parce que je ne suis pas matérialiste, je crois à la réalité des affinités électives plutôt qu’aux démarches volontaristes : Sparta arrivera entre les mains de ceux, mêmes jeunes, à qui elle était destinée avant même de voir le jour.
Breizh-info.com : Pouvez-vous nous présenter le contenu du premier numéro pour donner envie à nos lecteurs ? Il est beaucoup question d’Allemagne et d’Italie dans le contenu…
Philippe Baillet : Le grand détour par l’Allemagne est logique puisque cette livraison contient une étude sur Nietzsche, l’origine des valeurs et le fait que les idées ne sont jamais des données immédiates de la conscience, mais des produits dont il faut mettre au jour l’origine et qui reflètent toujours des conditions d’existence proprement vitales. Je fais ressortir l’intérêt de cette grille interprétative de toutes les religions, croyances et idéologies, avant de traiter des thèmes comme le rapport entre art, vie et vérité, ou encore la « grande raison » du corps chez Nietzsche. Dans une partie finale consacrée à l’antijudaïsme culturel de Nietzsche, j’évoque en passant le cas du grand indo-européaniste et celtisant Julius Pokorny, éditeur avant et après la guerre de la Zeitschrift für celtische Philologie. D’origine partiellement juive, il avait prêté serment à Hitler en 1934 et défendu des idées völkisch. Par l’intermédiaire de Friedrich Hielscher — tout à la fois ami d’Ernst Jünger, figure du courant national-révolutionnaire et de la « résistance intérieure », et néo-païen — sa revue était lue, à l’époque de Stur, par des esprits aussi radicaux qu’Olier Mordrel et Célestin Lainé.
Quand on sait cela, on commence à comprendre toute l’importance du sens des nuances : c’est aussi l’une des raisons d’être de Sparta.
J’ai également rédigé pour cette première livraison une très longue étude sur « le mythologue du romantisme », à savoir le Suisse Johann J. Bachofen (1815-1887), qui croisa Nietzsche à l’université de Bâle. Encore trop peu connu en France, Bachofen bénéficia pourtant d’une « réception » considérable : il est établi qu’il fut lu par des esprits aussi différents que Friedrich Engels, Walter Benjamin, Thomas Mann, Robert Musil, Hermann Hesse, Baeumler, Rosenberg et Klages, sans oublier le grand helléniste Walter F. Otto et, bien sûr, Julius Evola. Notre dossier sur Bachofen comprend d’ailleurs des textes d’Evola sur l’auteur suisse. L’Italie est encore à l’honneur avec plusieurs textes d’un sociologue de l’art italien consacrés à l’histoire de la subversion organisée des arts visuels en Occident par des « avant-gardes » nihilistes. Cette première livraison contient également un article de J. Haudry sur la notion grecque d’aidôs, terme souvent rendu par « retenue, pudeur », mais qui connote aussi le sens de « respect, révérence » envers sa propre conscience et ceux à qui l’on est uni par des devoirs réciproques ; un témoignage de Pierre Krebs sur le mouvement national-révolutionnaire allemand Der Dritte Weg, dont les méthodes ne sont pas sans rappeler celles du mouvement romain Casa Pound ; un article inédit d’Evola sur la véritable signification de l’« antimilitarisme » des nations victorieuses à l’issue de la Seconde Guerre mondiale ; et un index pour se repérer dans toute cette matière.
Breizh-info.com : Travaillez-vous déjà à un deuxième volume ? Quels retours avez-vous du premier ?
Philippe Baillet : La deuxième livraison est déjà en chantier, afin qu’elle puisse paraître en novembre prochain. Les thèmes philosophiques, religieux et liés au domaine indo-européen prédominent dans le premier numéro. Le deuxième numéro contiendra, lui, plus d’articles « métapolitiques ».
Nous devrions pouvoir présenter un comité de rédaction élargi, avec des collaborateurs étrangers. La naissance de Sparta a été relayée et favorablement accueillie sur le blog de Robert Steuckers, sur les sites de Terre & Peuple et de Synthèse nationale, sur la page Païens et Fiers de Jean-Jacques Vinamont, et même sur la page Facebook de quelqu’un qui ne nous aime pas, Christian Bouchet, mais qui a affirmé que Sparta, en tant que revue païenne, est très supérieure à la défunte revue Antaios du Belge Christopher Gérard. Quant aux commandes, elles arrivent en nombre tout à fait satisfaisant. Nous sommes donc raisonnablement optimistes sur l’avenir de Sparta.
Propos recueillis par YV
Sparta — volume I — 262 pages, 26 € (à commander ici)
Sources : Breizh-info.com, 2021.
- Détails
- Catégorie : MEMOIRE

Juvénal fait de l’Oronte un symbole de l'Orient dans une de ses Satires, qui dénonce les dérives du syncrétisme romain : in Tiberim defluxit Orontes, « L'Oronte s'est déversé dans le Tibre » (III, 62).
« Je ne puis, Romains, supporter une Rome grecque ! Et encore s'il n'y avait que les Grecs ! Depuis longtemps déjà le fleuve syrien de l'Oronte a déversé dans le Tibre la langue et les mœurs de son pays. » C'est ainsi qu'au début du IIe siècle ap. J.-C, le poète satirique Juvénal rend les Grecs et les Orientaux responsables de la décadence de son pays.
- Détails
- Catégorie : MEMOIRE

La dernière pensée à la mode chez les bien-pensants est de prétendre que la cohabitation entre les races se passait bien dans l’Empire romain alors que cet État possédait une minorité noire presque aussi importante que la nôtre.
Ce dernier point est une contre-vérité flagrante bien qu’Uderzo ait représenté les esclaves numides par des noirs dans Le domaine des dieux et ajouté un pirate noir à l’équipage de pirates. (Je m’étonne que le dessinateur n’ait pas été traité de raciste vu que le flibustier de couleur s’exprime dans un langage sans « r »). Aucun peuple de l’immense Empire romain n’était noir ! Les Numides (ancêtres des Berbères) étaient blancs (désolé Uderzo !).
Le Sahara dressait une muraille difficilement franchissable entre l’Afrique romaine (blanche) et son homologue noire. L’Égypte, conquise après Actium en 31 avant J.-C., était la seule province à avoir une frontière commune avec un royaume noir, celui de Koush (nord du Soudan actuel), État brillant, héritier et continuateur de la grande civilisation égyptienne. Les candaces (reines) de Koush traitaient d’égale à égal avec les empereurs romains et le commerce était florissant le long du Nil. Des commerçants noirs de Koush fréquentaient les terres impériales, quelques-uns ont dû s’y installer, mais étaient trop peu nombreux pour qu’on puisse parler de civilisation multiraciale. L’étude génétique comparative des momies de l’époque ptolémaïque (-323 avant J.-C. / 31 avant J.C.) et de celle des Égyptiens actuels montre que les habitants du delta du Nil de l’Antiquité avaient un génome principalement blanc contrairement à ceux du XXIe siècle qui, pour beaucoup, sont issus d’unions mixtes entre Blancs et Nubiens. Les activistes noirs ont pris l’habitude de prétendre que les Égyptiens de l’Antiquité étaient noirs et qu’ils auraient été supplantés par les Arabes blancs après la conquête musulmane de 640, pourtant c’est une contre-vérité totale. Nous venons de voir un argument imparable appuyé par une étude scientifique. En outre, les Coptes, qui descendent directement des Égyptiens du temps des Pyramides et qui n’ont eu aucun d’apport de sang arabe, sont blancs.
Néanmoins, au cours de la longue Histoire de l’Égypte ancienne (plus de 3 500 années), un souverain de Koush a conquis le delta du Nil et a été le premier d’une dynastie de pharaons noirs qui s’est maintenue de -744 à -656, mais cette occupation, comme nous l’avons vu, n’a pas modifié la composition ethnique du delta du Nil.
Notons également l’existence du royaume d’Aksoum, un des quatre empires mondiaux aux côtés de Rome, des Sassanides et de la Chine, État brillant qui est à l’origine de l’Éthiopie. Idéalement placé pour le commerce avec l’Inde et la Chine, Aksoum était prospère et ses marchands fréquentaient les ports de l’Égypte et du Levant, mais encore une fois, les ressortissants de ce royaume n’étaient pas assez nombreux pour qu’on puisse qualifier l’Empire romain de multiracial.
Si le besoin d’esclaves avait été criant à Rome, peut-être aurait-on, comme l’ont fait les États maghrébins après l’an mil, cherché les esclaves en Afrique noire avant de les ramener par caravanes en Afrique du Nord, mais les innombrables guerres fournissaient suffisamment de captifs pour que ce type de commerce transsaharien n’ait aucun intérêt.
Une minorité commence à compter à partir de 1 %. Auguste régnait sur un État comptant moins de 0,1 % de sujets de couleur. Rien n’est plus absurde que l’argument que j’ai lu sous la plume de bien-pensants : « Rome ne connaissait pas de problème racial, puisque les écrivains et les auteurs de l’époque n’en parlent pas ». Évidemment, puisque tout le monde ou presque était blanc !
En revanche, l’Empire était un État multicommunautaire qui a réussi à perdurer pendant près de 500 ans. Cet exploit s’explique par l’existence et l’acceptation par tous de deux cultures dominantes (latine à l’Ouest, grecque à l’Est) et par l’ancrage de chaque habitant dans sa ville (son terroir). Il faut concevoir Rome comme une immense confédération de cités. Celles-ci gardaient une totale autonomie municipale et culturelle ainsi que le droit d’honorer ses dieux, mais déléguaient les Affaires étrangères, la sécurité et la justice à Rome.
Leurs seules obligations était le paiement d’impôts confédéraux (qui sont devenus trop lourds à partir de 250 après J.-C.) et la célébration de la suprématie de Rome, à travers des autels sur lesquels les habitants de l’Empire, en sacrifiant des animaux, prouvaient leur loyauté. Le refus de se conformer à ce rite a provoqué les multiples révoltes juives (66-73, 115-117, 132-133…) et plus tard a entraîné la sécession des chrétiens, ce qui a fissuré l’unité de l’Empire et peut-être entraîné sa chute.
Christian de Moliner
Sources : Breizh-info.com, 2020, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine – 17/10/2020

- CHARLES V DE LORRAINE, LES HABSBOURG ET LA GUERRE CONTRE LES TURCS DE 1683 A 1687 par le Colonel Jean NOUZILLE (c.r.) Université de Strasbourg II
- Le couronnement de Julien (Empereur)
- L’agonie du vieux sud par Dominique Venner
- Août 1936 : le siège de l’Alcazar de Tolède.
- Frédéric II de Hohenstaufen, l'empereur « antéchrist» par Pierre VIAL
- Russie : la renaissance de l'identité cosaque
- EUROPE, NOTRE PATRIE
- EUROPE, NOTRE PATRIE
- TIAN'ANMEN : LE MASSACRE DONT IL NE FAUT PAS PARLER
- Avancer...







