
Kadhafi est donc mort et l’OTAN a mené une guerre en Afrique du Nord pour la première fois depuis que le FLN a vaincu la France en 1962. Le seul et unique « État des masses » [néologisme arabe qui est la traduction de Jamahiriya, NdT] du monde arabe, la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, a mal fini.
Contrairement au coup d’État sans effusion de sang du 1er septembre 1969 qui a renversé le roi Idris et porté Kadhafi et ses collègues au pouvoir, la campagne combinée de rébellion, de guerre civile et de bombardements de l’OTAN pour protéger les civils a fait plusieurs milliers (5 000 ? 10 000 ? 25 000 ?) de morts, plusieurs milliers de blessés, a entraîné le déplacement de centaines de milliers de personnes, et provoqué des dégâts massifs aux infrastructures. Qu’est-ce que la Libye a obtenu, si tant est qu’elle ait obtenu quoi que ce soit, en échange de la mort et de la destruction qu’elle a subie au cours des sept mois et demi écoulés ?
Le renversement de Kadhafi & Co était loin d’être une simple révolution contre la tyrannie, cependant la dernière intervention militaire de l’Occident ne peut être considérée comme une simple affaire de pétrole. Présenté par le Conseil national de transition (CNT) et acclamé par les médias occidentaux comme faisant partie intégrante du Printemps arabe, et donc censé être du même type que les bouleversements en Tunisie et en Égypte, le drame libyen vient plutôt s’ajouter à la liste des guerres occidentales ou soutenues par l’Occident contre des régimes hostiles, « contestataires », insuffisamment « dociles » ou « voyous » : Afghanistan I (contre le régime communiste, 1979-92), Irak I (1990-91), République fédérale de Yougoslavie (au Kosovo, 1999), Afghanistan II (contre le régime taliban, 2001) et Irak II (2003), auxquels on pourrait ajouter, avec des réserves, les interventions militaires au Panama (1989-90), en Sierra Leone (2000) et en Côte d’Ivoire (2011).
Parmi les événements plus anciens que nous pourrions avoir à l’esprit, citons la Baie des Cochons (1961), l’intervention de mercenaires occidentaux au Congo (1964), le coup d’État de palais soutenu par la Grande-Bretagne à Oman en 1970 et – last but not least – trois complots avortés, sous-traités à David Stirling et à divers autres mercenaires sous l’œil initialement bienveillant des services de renseignement occidentaux, pour renverser le régime de Kadhafi entre 1971 et 1973 dans un épisode connu sous le nom de « Hilton Assignment. »
Dans le même temps, l’histoire de la Libye de 2011 génère plusieurs débats différents. Le premier, sur les avantages et les inconvénients de l’intervention militaire, a généralement éclipsé les autres. Mais de nombreux États d’Afrique et d’Asie, et sans doute aussi d’Amérique latine (on pense à Cuba et au Venezuela), souhaiteraient peut-être se pencher sur les raisons pour lesquelles la Jamahiriyya, bien qu’elle soit parvenue à rétablir ses relations avec Washington et Londres en 2003-2004 et à négocier en bonne intelligence avec Paris et Rome, a pu se montrer si vulnérable face à leur hostilité soudaine. Et la guerre en Libye devrait également nous amener à nous interroger sur les conséquences des actions des puissances occidentales vis-à-vis de l’Afrique et de l’Asie, et du monde arabe en particulier, en ce qui concerne les principes démocratiques et l’idée de l’État de droit.
Les Afghans qui se sont rebellés contre les régimes communistes de Noor Mohammed Taraki, Hafizullah Amin et Babrak Karmal, soutenus par l’Union soviétique, et qui, en 1992, ont renversé Mohammed Najibullah avant de dévaster Kaboul au cours d’une longue guerre de clans, se sont donné le nom de moudjahidines, « combattants de la foi ». Ils menaient un jihad contre des marxistes impies et ne voyaient pas l’intérêt de s’en cacher, compte tenu de la couverture médiatique enthousiaste et du soutien logistique que l’Occident leur apportait.
Mais les Libyens qui ont pris les armes contre la Jamahiriyya de Kadhafi ont soigneusement évité cette étiquette, du moins lorsqu’ils se trouvaient proches des micros occidentaux. La religion avait bien peu à voir avec les soulèvements en Tunisie et en Égypte : en Tunisie, les islamistes étaient presque totalement absents de la scène jusqu’à la chute de Ben Ali ; en Égypte, les Frères musulmans n’ont pas été les instigateurs du mouvement de protestation (auquel les chrétiens coptes ont également pris part) et ont veillé à ce que leur soutien reste discret. Ainsi, la non-pertinence de l’islamisme dans la révolte populaire contre les régimes despotiques a fait partie de la façon dont l’Occident a procédé à la lecture du Printemps arabe. Les rebelles libyens, tout comme les fidèles de Kadhafi, ont tacitement reconnu ce fait.
Les médias occidentaux ont généralement approuvé que les rebelles se présentent comme des démocrates libéraux progressistes et ont rejeté l’affirmation exagérée de Kadhafi selon laquelle al-Qaïda était derrière la révolte. Mais il est devenu impossible d’ignorer le fait que la rébellion a mobilisé les islamistes et s’est teintée d’islamisme. Lors de sa première visite à Tripoli, Mustafa Abdul Jalil, le président du Conseil national de transition (CNT), alors encore installé à Benghazi, a déclaré que toute la législation du futur État libyen serait fondée sur la charia, devançant ainsi tout corps électoral sur ce point cardinal.
Et Abdul Hakim Belhadj (alias Abu Abdallah al-Sadiq), que le CNT a nommé au tout nouveau poste de commandant militaire de Tripoli, est un ancien dirigeant du Groupe islamique combattant libyen, un mouvement qui a mené une campagne de terrorisme contre l’État libyen dans les années 1990 et a ensuite fourni des recrues à al-Qaïda. Les révolutionnaires démocrates en Tunisie s’inquiètent aujourd’hui de la réapparition du mouvement islamiste qui a eu pour effet de détourner le débat politique des questions constitutionnelles vers des questions toxiques d’identité et pourrait faire dérailler la démocratie naissante du pays ; dans cette optique, l’aspect islamiste de la rébellion libyenne devrait nous mettre en garde. Cela fait partie des nombreuses raisons pour lesquelles il faut se demander si ce à quoi nous assistons est une révolution ou une contre-révolution.
Le nom des rebelles a changé plusieurs fois dans le lexique des médias occidentaux : ils ont d’abord été des manifestants pacifiques, des contestataires de la démocratie, des civils ; puis (aveu tardif) des rebelles ; et, enfin, des révolutionnaires. Révolutionnaires – en arabe, thuwwar (singulier : tha’ir) – est l’étiquette qu’ils préfèrent au moins depuis la chute de Tripoli. Tha’ir peut simplement signifier « agité » ou « excité ». Les jeunes gens qui ont passé une grande partie de la période d’avril à juillet à parcourir la route côtière dans des pick-ups Toyota (et tout le mois de septembre à faire des allers-retours autour de Bani Walid), tout en tirant autant leurs munitions en l’air que sur l’ennemi, étaient certainement excités. Mais combien de vétérans d’autres révolutions, à la différence des journalistes occidentaux, les reconnaîtraient comme leurs homologues ?
Les événements en Tunisie et en Égypte ont été révolutionnaires dans leur intention, mais le changement qui s’est produit en Égypte ne ressemble en rien à une véritable révolution : le retour de l’armée au pouvoir signifie que la politique du pays doit encore transcender la logique de l’État des officiers libres établi en 1952. Mais la façon dont des centaines de milliers de personnes se sont dressées contre Moubarak, l’hiver dernier, est un événement historique que les Égyptiens n’oublieront jamais. Il en va de même pour la Tunisie, sauf que là-bas, une révolution n’a pas seulement renversé Ben Ali, elle a également mis fin au monopole du vieux parti au pouvoir. Les Tunisiens sont entrés dans l’inconnu. Leur plus grand défi sera de savoir s’ils ont les ressources nécessaires pour faire face au mouvement islamiste. Les récentes élections laissent à penser qu’ils s’en sortent plutôt bien.
A deux égards, la Libye s’inscrit dans le contexte plus large du « réveil arabe ». Les troubles ont commencé le 15 février, trois jours après la chute de Moubarak : il y a donc eu un effet de contagion. Et il est clair que bon nombre des Libyens qui sont descendus dans la rue au cours des jours suivants étaient animés par les mêmes sentiments que leurs homologues ailleurs. Mais le soulèvement libyen a divergé des modèles tunisien et égyptien de deux façons : la rapidité avec laquelle il est devenu violent – destruction de bâtiments publics et attaques xénophobes contre des Égyptiens, des Serbes, des Coréens et, surtout, des Africains noirs ; et la façon dont, brandissant le vieux drapeau libyen de l’ère 1951-69, les manifestants ont assimilé leur cause à la monarchie que Kadhafi & Co ont renversée. Cette divergence devait beaucoup aux influences extérieures. Mais elle devait aussi beaucoup au caractère de l’État et du régime de Kadhafi.
Largement ridiculisée comme la création bizarre de son « Guide » excentrique, voire cinglé, la Jamahiriyya arabe libyenne populaire et socialiste partageait en fait de nombreuses caractéristiques avec d’autres États arabes. Avec l’augmentation spectaculaire des revenus pétroliers au début des années 1970, la Libye est devenue une « société d’hydrocarbures » qui ressemblait davantage aux États du Golfe qu’à ses voisins d’Afrique du Nord. Les revenus pétroliers de la Libye ont été distribués très largement, le nouveau régime misant sur un État-providence dont pratiquement tous les Libyens ont bénéficié, tout en comptant également sur la richesse pétrolière, comme le font les États du Golfe, pour acheter tout ce qui lui manquait en termes de technologie et de biens de consommation, sans oublier [la rémunération] de centaines de milliers de travailleurs étrangers. Pour Kadhafi et ses collègues, le rôle distributif de l’État est rapidement devenu l’élément central de leur stratégie pour diriger le pays.
Le coup d’État de 1969 s’inscrit dans la série de soulèvements qui ont remis en cause les dispositions prises par la Grande-Bretagne et la France pour dominer le monde arabe après la Première Guerre mondiale et la destruction de l’Empire ottoman. Ces ententes ont repris de la vigueur suite aux défaites de la Seconde Guerre mondiale et du remplacement de l’hégémonie britannique par l’hégémonie américaine au Moyen-Orient.
Ces arrangements impliquaient le patronage, la protection et la manipulation de monarchies nouvellement créées en Arabie saoudite, en Jordanie, en Irak, en Égypte, en Libye et dans les micros états du Golfe et, dans la plupart des cas, les défis ont été accélérés par les développements catastrophiques du conflit israélo-arabe. Tout comme les officiers libres qui ont déposé le roi Farouq et pris le pouvoir en Égypte en 1952 étaient scandalisés par l’incompétence des forces armées égyptiennes en 1948, et alors que la révolution en Irak en 1958 devait beaucoup à l’hostilité accrue contre la monarchie pro-britannique après Suez, la défaite arabe de 1967 et, surtout, la frustration de l’absence de la Libye dans la lutte arabe ont incité Kadhafi et ses collègues à tenter leur coup d’État contre la monarchie libyenne. Cependant, à part la fermeture de la base américaine de Wheelus Field et la nationalisation du pétrole, ils ne savaient pas vraiment quoi faire ensuite.
Contrairement à ses homologues hachémites, qui venaient de la Mecque et étaient des étrangers en Jordanie et en Irak, le roi Idris, lui, au moins était Libyen. Il avait également une légitimité en tant que chef de l’ordre religieux Sanussiyya qui, au cours du XIXe et du début du XXe siècle, s’était établi dans toute la Libye orientale et s’était distingué dans la résistance à la conquête italienne à partir de 1911. Mais à l’instar des Hachémites, Idris est monté sur le trône en tant que protégé des Britanniques, qui sont allés le dénicher au Caire, où il avait passé plus de 20 ans en exil, pour en faire le roi et faire ainsi de la Libye une monarchie en 1951, lorsque l’ONU a enfin décidé du sort de l’ancienne colonie italienne.
La Sanussiyya, à l’origine un ordre de renouveau islamique, a été créée dans le nord-est de la Libye, la province que les Italiens appelaient Cyrénaïque, par un immigrant « divin » de l’ouest de l’Algérie, Sayyid Mohammed ben Ali al-Sanussi al-Idrisi, qui a fondé son ordre à La Mecque en 1837 mais l’a transféré en Libye en 1843. Il s’est enraciné dans toute la province orientale dans les interstices de la société tribale bédouine et s’est répandu au sud le long des routes commerciales qui traversaient le Sahara vers le Soudan, le Tchad et le Niger. Il était moins présent dans l’ouest de la Libye : en Tripolitaine au nord-ouest, qui avait ses propres traditions religieuses et politiques fondées sur le rattachement ottoman, et au Fezzan au sud-ouest. Les deux provinces occidentales ont toujours été considérées comme faisant partie du Maghreb (l’ouest arabe), liées principalement à la Tunisie et à l’Algérie, tandis que la Libye orientale a toujours fait partie du Machrek (l’est arabe), orientée vers l’Égypte et le reste du Levant arabe.

La base sociale interne de la nouvelle monarchie était donc très inégale et Idris était mal placé pour promouvoir un véritable processus d’intégration nationale, optant plutôt pour une constitution fédérale qui laissait la société libyenne telle qu’il l’avait trouvée, tandis que, par déférence envers ses sponsors occidentaux et par crainte de la montée du nationalisme radical arabe et du nassérisme en particulier, il isolait le pays du reste du monde arabe. Le coup d’État de Kadhafi était une révolte contre cet état de fait, et la flamboyance par ailleurs déroutante de sa politique étrangère prouvait bien sa détermination à faire en sorte que la Libye ne soit plus un trou perdu.
Le cercle restreint du nouveau régime était issu d’un petit nombre de tribus, surtout les Gadadfa du centre de la Libye, les Magarha du Fezzan au sud-ouest et les Warfalla du sud-est de la Tripolitaine. Ce contexte ne conduisait pas Kadhafi et ses associés à s’identifier aux traditions politiques et culturelles des élites de Tripoli ou à celles de Benghazi et des autres villes de la Cyrénaïque côtière. Pour les élites, le coup d’État de 1969 avait été perpétré par des « bédouins », c’est-à-dire des rustres campagnards. Pour Kadhafi & Co, les traditions des élites urbaines n’offraient aucune formule pour gouverner la Libye : elles ne feraient que perpétuer sa désunion.
La Méditerranée et le Moyen-Orient ne manquent pas d’exemples de terres transformées à grand-peine en États qui sont fondés, non pas sur les sociétés cosmopolites des bords de mer, mais sur les régions mornes et dures de l’intérieur. Ce sont la société austère et les villes sombres du plateau castillan, et non la Barcelone sophistiquée ou la Valence ensoleillée ou Grenade, qui ont donné naissance au royaume qui, une fois uni à l’Aragon, a uni le reste de l’Espagne au détriment de la riche culture de l’Andalousie en particulier. De même, Ibn Saoud, souverain de l’impitoyable plateau du Nejd, au centre de la péninsule arabique, avait uni les Arabes par l’épée tout en forçant les habitants du Hedjaz, près de la côte de la mer Rouge, nourris des traditions des quatre madhahib (écoles juridiques) de l’Islam sunnite et connaissant bien les diverses traditions chiites, à plier le genou devant le dogmatisme wahhabite. Ibn Saoud était soutenu par la tradition religieuse militante des muwahiddun, les disciples du réformateur religieux nejdi Muhammad Ibn Abd al-Wahhab, dans sa volonté d’unifier l’Arabie par la conquête. Même les révolutionnaires du FLN avaient la religion pour eux, non seulement parce qu’ils affrontaient une puissance coloniale chrétienne, mais aussi en tant qu’héritiers du mouvement réformateur al-Islah. Mais Kadhafi et ses comparses n’avaient pas de bannière religieuse militante et l’Islam organisé en Libye était bien décidé à lui résister.
Devancés dans la sphère religieuse par la Sanussiyya à l’est et la tradition panislamique des oulémas tripolitains, qui datait de l’époque ottomane, ils étaient désespérément à la recherche d’une source doctrinale pour susciter un enthousiasme idéologique capable de réorganiser la société libyenne. Au départ, ils pensaient en trouver une dans le panarabisme, qui, surtout dans sa version nassérienne, avait suscité l’enthousiasme dans toute l’Afrique du Nord à partir de 1952, mettant les champions de l’Islam sur la touche.
Mais Kadhafi & Co étaient des retardataires dans le bal révolutionnaire nationaliste arabe et un peu plus d’un an après leur prise de pouvoir, Nasser était mort. Pendant un certain temps, Kadhafi a persisté dans l’idée d’une relation stratégique avec l’Égypte, ce qui aurait contribué à résoudre plusieurs des problèmes de la nouvelle Libye, en lui fournissant un allié et en soutenant les efforts du régime pour faire face aux courants réfractaires en Cyrénaïque. Mais l’Égypte de Sadate s’éloignait du panarabisme et le projet d’union égypto-libyenne, annoncé en août 1972, n’a abouti à rien. Fin 1973, une campagne anti-égyptienne est lancée dans la presse libyenne, et l’ambassade de Libye au Caire est fermée.
En janvier 1974, Kadhafi tente alors de conclure une alliance avec son voisin occidental, en déclarant une nouvelle « République arabo-islamique » avec le Tunisien Habib Bourguiba. Cette tentative est également mort-née. Nombreux sont ceux qui se demandent à quoi pouvait bien penser Bourguiba, mondain, francophile, laïque et modéré, et Houari Boumediène, le président algérien, a pesé de tout son poids pour rappeler à Tunis qu’il ne pouvait y avoir de changement dans l’équilibre géopolitique du Maghreb sans l’accord de l’Algérie. Suivant cette logique, Kadhafi a conclu une alliance avec l’Algérie et, en 1975, Boumediène et Kadhafi ont signé un traité d’amitié mutuelle.
Il semblait que la Libye avait enfin conclu une alliance sur laquelle elle pouvait compter. Deux ans plus tard, après la visite de Sadate à Tel Aviv, la Libye rejoint l’Algérie, la Syrie, le Yémen du Sud et l’OLP au sein du Front de constance et de confrontation, qui s’oppose à tout rapprochement avec Israël. Mais Boumediène meurt subitement, à la fin 1978. Son successeur, Chadli Bendjedid, à la manière de Sadate, renonce aux engagements révolutionnaires de l’Algérie et à l’alliance qui protégeait Tripoli ; la Libye était à nouveau seule. Le désespoir de Kadhafi est manifeste quand il signe un traité éphémère avec le roi Hassan du Maroc en 1984. C’était là sa dernière tentative pour rejoindre les autres États arabes et nord-africains. Au lieu de cela, il s’est tourné vers l’Afrique subsaharienne, où la Jamahiriyya pouvait jouer le rôle de protecteur bienveillant.
Tous les États d’Afrique du Nord ont eu une sorte de politique africaine. Et tous, à l’exception de la Tunisie, ont un arrière-pays stratégique constitué des pays situés au sud : pour l’Égypte, le Soudan ; pour l’Algérie, les États du Sahel (Niger, Mali et Mauritanie) ; pour le Maroc, la Mauritanie, qui constitue également une pomme de discorde permanente avec l’Algérie. Dans la poursuite de leurs politiques africaines, les États d’Afrique du Nord sont souvent en concurrence, mais ils le sont aussi avec les puissances occidentales soucieuses de préserver ou, dans le cas des États-Unis, de contracter des relations de type patron-client avec ces États. Ce qui distingue la Libye de Kadhafi de ses voisins nord-africains, c’est l’ampleur de son investissement dans cette stratégie méridionale, qui est devenue centrale dans la conception que le régime se faisait de la mission de la Libye dans le monde.
La politique africaine de la Jamahiriyya avait un côté plus sombre. Le soutien de Kadhafi à Idi Amin en est l’exemple le plus frappant, même si cela semble moins grotesque si on considère le soutien apporté par divers gouvernements occidentaux à Mobutu Sese Seko. Il y a également eu l’implication de la Libye dans la guerre civile au Tchad (et la tentative d’annexion de la bande d’Aouzou) et son implication constante dans la question touareg au Niger et au Mali.
Dans le même temps, elle a apporté un soutien financier et concret important à l’Union africaine, s’est opposée à l’installation de l’Africom de l’armée américaine sur le sol de tout pays africain et a financé un large éventail de projets de développement dans les pays subsahariens. Kadhafi avait prévu d’exploiter les immenses réserves d’eau du Sahara libyen et de fournir de l’eau aux pays du Sahel, ce qui aurait pu transformer leurs perspectives économiques, mais cette possibilité a maintenant été presque sûrement anéantie par l’intervention de l’OTAN, puisque les compagnies des eaux occidentales (et peut-être particulièrement françaises) font la queue aux côtés des compagnies pétrolières occidentales pour avoir leur tranche du gâteau Libyen.
La politique africaine de Kadhafi a donné à la Libye une position géopolitique solide et a consolidé son arrière-pays stratégique tout en profitant à l’Afrique. L’opposition de l’Union arabe à l’intervention de l’OTAN et ses efforts soutenus pour négocier un cessez-le-feu et des négociations entre les deux camps de la guerre civile ont montré que de nombreux pays africains appréciaient la contribution de la Libye aux affaires du continent.
Ces efforts ont été rejetés avec mépris par les gouvernements et la presse occidentaux, l’opposition africaine à l’intervention militaire étant cyniquement tournée en dérision, les pays clients de la Libye faisant leur devoir envers leur protecteur, ce qui était un jugement égoïste et injuste, tout particulièrement pour l’Afrique du Sud. On n’a jamais précisé que la Ligue arabe, dont le soutien à une zone d’exclusion aérienne a été brandi par Londres, Paris et Washington pour justifier la légitimation arabe de l’intervention de l’OTAN, comptait parmi ses membres presque uniquement des États clients des puissances occidentales.
La situation était lourde d’ironie pour la Libye. Le commentaire méprisant du fils de Kadhafi, Saif al-Islam, sur la résolution de la Ligue arabe, « El-Arab ? Toz fi el-Arab ! » (Les Arabes ? Au diable les Arabes !), exprimait l’amère constatation de la famille pour qui le panarabisme à l’origine de la révolution de 1969 était depuis longtemps devenu obsolète, la majorité des États arabes ayant sombré dans une soumission honteuse aux puissances occidentales.
Pour Kadhafi & Co, le problème était que la perspective africaine qu’ils avaient diligemment défendue comme solution de rechange au panarabisme défunt, et ce, conformément à leur vision originale du monde anti-impérialiste, ne signifiait pas grand-chose pour les nombreux Libyens qui voulaient que la Libye se rapproche de Dubaï ou, pire encore, suscitait un ressentiment virulent à l’encontre du régime et de l’Afrique noire. Ainsi, en faisant entrer la Libye dans l’Afrique tout en tendant à l’écarter des affaires régionales arabes, la politique étrangère de la Jamahiriyya, comme celle de la monarchie d’Idris, a éloigné les Libyens des autres Arabes, en particulier des Arabes du Golfe bien nantis dont le mode de vie était celui auquel aspiraient de nombreux Libyens de la classe moyenne. En ce sens, la politique étrangère du régime rendait celui-ci vulnérable à une révolte inspirée par les événements survenus ailleurs dans le monde arabe. Mais il y avait une autre raison à cette vulnérabilité.
Les auteurs du coup d’État de 1969 ont d’abord pris l’Égypte de Nasser pour modèle, imitant ses institutions et sa terminologie – Officiers libres, Conseil de commandement de la révolution – et se dotant d’un « parti » unique, l’Union socialiste arabe (ASU), comme le prototype de Nasser, essentiellement un appareil d’État fournissant une façade au nouveau régime. Mais en l’espace de deux ans, les purges de dé-nassérisation de Sadate étaient en cours et il se réconciliait avec les Frères musulmans, tandis que le début de l’Infitah – sa politique d’ouverture de l’économie – annonçait le recul du « socialisme arabe » et que la rupture avec Moscou présageait le tournant vers l’Amérique. Ainsi, le modèle égyptien s’est rapidement transformé en un anti-modèle, tandis que l’expérience de l’ASU s’est avérée être un échec instructif. L’idée d’un parti unique semblait avoir du sens en Libye, comme elle en avait eu à l’origine en Égypte et aussi en Algérie. Les dirigeants des régimes militaires avaient besoin de mettre en place une façade civile afin d’offrir un certain degré de représentation contrôlée et d’intégrer les personnages politiques ambitieux dans la nouvelle répartition.
Mais en Égypte et en Algérie, les architectes du nouveau parti unique avaient affaire à des populations comparativement politisées. Kadhafi & Co ont été confrontés à une société politiquement inerte, avec peu de tradition étatique, pulvérisée par une conquête coloniale brutale et réduite à l’état de spectatrice alors que le pays devenait un champ de bataille pendant la Seconde Guerre mondiale, pour être ensuite libérée de la domination coloniale par des forces extérieures et enfin pacifiée par la monarchie Sanussi. En essayant de lancer l’ASU, le nouveau régime n’a pas trouvé grand-chose sur lequel s’appuyer en termes de talent ou d’énergie politique au sein de la population ; ce sont plutôt les vieilles élites de Tripoli et de Benghazi qui se sont investis dans le parti, qui non seulement n’a pas réussi à susciter l’enthousiasme populaire mais est devenu un foyer de résistance contre la révolution que Kadhafi avait en tête.
Kadhafi a donc commencé à développer une idée qu’il a exprimée quelques semaines après avoir pris le pouvoir en 1969 : la démocratie représentative n’était pas adaptée à la Libye. D’autres dirigeants d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient pensaient la même chose concernant leur propre pays. Mais en prétendant permettre la représentation, ils reconnaissaient leur vice en rendant tacitement hommage à la vertu. Dans son Livre vert, cependant, Kadhafi a scandalisé les gens par son refus d’être hypocrite : il a élevé son rejet de la représentation en un principe constitutif explicite qu’il a appelé l’État des masses. Mais le vrai problème est que sa nouvelle orientation a conduit la Libye dans une impasse historique.

Il s’est débarrassé de l’ASU et de l’idée d’un parti unique, favorisant plutôt les Congrès du peuple et les Comités révolutionnaires comme institutions politiques clés de la Jamahiriyya, qui a été proclamée en 1977. Les premiers devaient assumer la responsabilité de l’administration publique et garantir la participation populaire, les seconds devaient entretenir la flamme de la révolution. Les membres des Congrès du peuple étaient élus, et ces élections ont été prises au sérieux, du moins au niveau local et pendant un certain temps. Mais les électeurs n’élisaient pas, en théorie, des représentants, ils décidaient simplement lequel des candidats proposés devait assumer les responsabilités principalement administratives des organes en question. Le système encourageait l’unanimité politique et idéologique, ne permettant pas aux opinions dissidentes de s’exprimer, sauf sur des questions triviales. Il a permis à de nombreux Libyens ordinaires de participer d’une certaine façon aux affaires publiques, bien que cette participation ait diminué au milieu des années 1990, mais il ne les a pas éduqués à d’autres aspects de la politique et ce système n’a pas non plus bien fonctionné en soi.
L’État des masses de Kadhafi s’est inspiré d’idées développées ailleurs. La défense de la démocratie directe par rapport à la démocratie représentative était une caractéristique importante de la vision utopique des jeunes gauchistes occidentaux des années 1960. Et la décision stratégique de mobiliser les énergies « révolutionnaires » des jeunes pour déjouer les appareils conservateurs des partis était au cœur de la Révolution culturelle de Mao et c’était une caractéristique de la « Révolution socialiste » de Boumediene.
Kadhafi est allé plus loin en abolissant l’ASU et en interdisant complètement les partis, mais il pouvait se prévaloir d’un fondement doctrinal : l’idée qu’il ne devrait pas y avoir de partis politiques dans un pays musulman est défendue depuis longtemps par certains courants de l’islamisme sunnite, au motif que le mot « parti » évoque la fitna, ou la division de la communauté des fidèles, le danger suprême. À ce jour, l’Arabie saoudite, le Koweït, Oman et les Émirats arabes unis n’autorisent aucun parti politique. (Le pouvoir de Kadhafi a toujours eu un aspect islamique plus prononcé que celui des régimes du Caire et d’Alger ; son intolérance à l’égard des islamistes devait beaucoup au fait qu’il entendait rester la source du radicalisme et ne voulait pas accepter de rivaux). Enfin, l’idée d’une participation populaire directe à l’administration publique pouvait trouver son origine locale dans la tradition des tribus bédouines connue sous le nom de hukumat ‘arabiyya (signifiant ici « gouvernement du peuple » et non « gouvernement arabe »), dans laquelle chaque homme adulte peut avoir son mot à dire.
La Jamahiriyya a duré 34 ans (42 si l’on remonte à 1969), une durée respectable. Elle n’a pas fonctionné pour les hommes d’affaires, les diplomates et les journalistes étrangers, qui ont trouvé son fonctionnement plus exaspérant que celui des États arabes et africains, et leurs opinions ont façonné l’image du pays à l’étranger. Mais le régime n’avait pas été conçu pour fonctionner pour les étrangers et semble, la plupart du temps, avoir assez bien fonctionné pour de nombreux Libyens. Il a permis de faire plus que tripler la population totale (6,5 millions d’habitants aujourd’hui, contre 1,8 million en 1968), d’atteindre des normes élevées en matière de soins de santé, des taux de scolarisation élevés pour les filles comme pour les garçons, un taux d’alphabétisation de 88 %, un degré de promotion sociale et professionnelle des femmes que les femmes de nombreux autres pays arabes pourraient envier et un revenu annuel par habitant de 12 000 dollars, le plus élevé d’Afrique. Mais ces indices, régulièrement cités, naturellement, par les critiques de l’intervention de l’Occident en réponse à la propagande qui n’a cessé de noircir le régime de Kadhafi, sont, dans un certain sens, hors sujet.
Les réalisations socio-économiques du régime peuvent être attribuées essentiellement à l’État distributif : c’est-à-dire au succès du secteur des hydrocarbures et des mécanismes mis en place très tôt pour distribuer les pétrodollars. Mais les institutions centrales de la Jamahiriyya, le tandem Congrès du peuple et Comités révolutionnaires, n’ont pas du tout permis une gouvernance efficace, en partie parce qu’elles impliquaient une tension entre deux notions et sources de légitimité distinctes. Les Congrès incarnaient l’idée du peuple en tant que source de légitimité et agent de légitimation. Mais les Comités incarnaient l’idée très différente de la Révolution comme possédant une légitimité qui surpassait toutes les autres. Au sommet de la Révolution se trouvait Kadhafi lui-même, et il était logique qu’il se positionne en dehors de la structure des Congrès et donc des institutions formelles du gouvernement, ni Premier ministre ni président mais simplement Murshid, Guide, Frère Leader.
Cette position lui permettait de jouer le rôle de médiateur en roue libre entre les différentes composantes du système et l’opinion publique, critiquant le gouvernement (et en exprimant ainsi le mécontentement de l’opinion publique) ou déplorant son inefficacité et corrigeant les erreurs des Congrès du peuple, et ce toujours du point de vue de la Révolution. La tradition d’un dirigeant arabe qui se fait vertu de prendre le parti de l’opinion publique contre ses propres ministres remonte à Haroun al-Rashid. Mais la manière dont la légitimité révolutionnaire pouvait l’emporter sur la légitimité populaire dans le système de Kadhafi ressemble également à l’insistance de Khomeini sur le fait que les intérêts de la révolution iranienne pouvaient l’emporter sur les préceptes de la charia – c’est-à-dire que les considérations politiques pouvaient l’emporter sur le dogme islamique – et dont il était l’arbitre toutes les fois où cela était nécessaire.
Il est frappant de constater que Kadhafi considérait que l’intérêt de la révolution exigeait que le secteur des hydrocarbures échappe tant au contrôle des Congrès du peuple que de celui des Comités révolutionnaires.
Des mots tels que « autoritarisme », « tyrannie » (un des chevaux de bataille des Britanniques) et « dictature » n’ont jamais vraiment rendu compte du caractère particulier de ce système, mais l’ont au contraire caricaturé sans relâche. Contrairement à tout autre chef d’État, Kadhafi se trouvait au sommet non pas de la pyramide des institutions gouvernementales, mais du secteur informel de la politique, qui jouissait d’un degré d’hégémonie sur le secteur formel sans équivalent moderne. Cela veut dire que les institutions formelles de la Jamahiriyya étaient extrêmement faibles, et cela inclut l’armée, dont Kadhafi se méfiait et qu’il marginalisait.
De Kadhafi, on est tenté de dire : « L’Etat, c’était lui » [en français dans le texte, NdT]. Mais ce qui a légitimé son pouvoir, a été l’idée de plus en plus mystique de la Révolution, et non l’hérédité et le droit divin. Et le contenu intangible de cette Révolution, ce que Ruth First appelait son caractère insaisissable, était étroitement lié au fait que la Révolution n’était jamais terminée.
Une distinction entre le gouvernement révolutionnaire et le gouvernement constitutionnel a été faite en 1793 par Robespierre, lorsqu’il a écrit : « Le but du gouvernement constitutionnel est de conserver la République ; celui du gouvernement révolutionnaire est d’en jeter les bases. » La fonction historique effective du gouvernement révolutionnaire en Libye a été de faire en sorte que, si le pays était modernisé sur des points importants, il n’était cependant pas devenu et ne pouvait pas devenir une république. La révolution libyenne s’est avérée permanente parce que ses objectifs étaient imprécis, que ses architectes ne prévoyaient aucune forme de gouvernement légal et constitutionnel comme but final et aucune conception d’un rôle politique pour eux-mêmes ou pour quiconque après la révolution.
L’État des masses, al-jamahiriyya, était considéré comme bien supérieur à une simple république – jumhuriyya – mais, en fait, il était surtout bien loin d’en être une. Et, à la différence des États qui se disent des républiques mais ne sont pas à la hauteur de leur nom, ses prétentions étaient claires, il n’avait jamais eu l’intention d’établir une véritable république dans laquelle le gouvernement serait véritablement du ressort du peuple. L’État des masses n’était en réalité guère plus qu’un jeu destiné à occuper et à endiguer les Libyens ordinaires, tandis que les adultes s’occupaient de la politique en coulisses, celle-ci étant l’affaire d’une élite mystérieuse et irresponsable.
La mobilisation de la société lors de la Révolution française a mis en lumière plusieurs leaders indépendants d’esprit – Danton, Marat, Hébert et autres, ainsi que Robespierre – rendant psychologiquement possible la révolte des Jacobins contre Robespierre et la mise en place du processus tortueux de remplacement du gouvernement révolutionnaire par un gouvernement constitutionnel. Jusqu’à un certain point, on peut dire la même chose de l’Algérie (où la lutte pour l’indépendance a donné naissance à une surabondance de révolutionnaires résolus), bien que 49 ans plus tard, le chemin sinueux vers la république démocratique soit encore long, comme ce fut le cas en France. Mais l’inertie politique de la société libyenne explique que sa révolution ait eu un et un seul leader.
Les plus proches collaborateurs de Kadhafi avaient sans aucun doute une réelle influence personnelle, mais seul l’un d’entre eux, Abdessalam Jalloud, avait le cran d’exprimer ses désaccords ouverts avec Kadhafi sur des questions majeures (et il a fini par démissionner de lui-même en 1995). Ainsi, le régime de Kadhafi peut être considéré comme un exemple extrême de ce que Rosa Luxembourg appelait le « substitutionnisme » : le gouvernement informel qui était le véritable gouvernement de la Libye était un one-man-show. Incarnant tout à la fois la nébuleuse Révolution, l’intérêt imprécis de la nation et la volonté imprécise du peuple, Kadhafi était absolument convaincu qu’il devait fournir un spectacle intéressant. Sa flamboyance poursuivait un objectif politique. Mais combien de temps le tape-à-l’œil peut-il recueillir l’assentiment, sans parler de loyauté ? Un joueur de pipeau conduisant les Libyens – pour la plupart bien nourris, logés et scolarisés, mais maintenus dans une perpétuelle infantilisation politique – vers une destination inconnue. Ce qui est étonnant, c’est que le spectacle ait pu durer si longtemps.
Kadhafi semble avoir réalisé il y a des années ce qu’il avait fait – l’impasse quasi-utopique dans laquelle il s’était mis ainsi que la Libye – et a tenté d’échapper aux conséquences. Dès 1987, il faisait des tentatives de libéralisation : il autorisait le commerce privé, restreignait les Comités révolutionnaires et réduisait leurs pouvoirs, autorisait les Libyens à voyager pour se rendre dans les pays voisins, redonnait les passeports confisqués, libérait des centaines de prisonniers politiques, invitait les exilés à revenir en leur garantissant qu’ils ne seraient pas menacés, et rencontrait même les dirigeants de l’opposition pour envisager la possibilité d’une réconciliation, tout en reconnaissant que de graves abus avaient été commis et que l’État de droit était défaillant en Libye.
Ces réformes signifiaient une évolution vers un gouvernement constitutionnel, les éléments les plus marquants étant les propositions de Kadhafi visant à codifier les droits des citoyens et les crimes passibles de sanctions, qui devaient mettre fin aux arrestations arbitraires. Cette évolution a été interrompue par les sanctions internationales imposées en 1992 suite à l’attentat de Lockerbie : une urgence nationale qui a renforcé l’aile conservatrice du régime et empêché toute réforme ambitieuse pendant plus de dix ans. Ce n’est qu’en 2003-04, après que Tripoli ait versé une somme colossale en compensation aux familles endeuillées en 2002 (après avoir déjà livré Abdelbaset Ali al-Megrahi et Al Amin Khalifa Fhima afin qu’ils soient jugés en 1999), que les sanctions ont été levées, et qu’un nouveau courant réformateur dirigé par Saif al-Islam, le fils de Kadhafi, a émergé au sein du régime.
Il y a quelques années, il était de bon ton dans les cercles proches du gouvernement Blair – dans les médias, surtout, et parmi les universitaires – de chanter les louanges de l’engagement de Saif al-Islam en faveur de la réforme et il est maintenant très tendance de le traiter avec opprobre, parce qu’il est le fils de son affreux père. Aucun des deux jugements n’est pertinent, les deux sont orientés. Saif al-Islam avait commencé à jouer un rôle important et constructif dans les affaires de l’État libyen, en persuadant le Groupe islamique de combat libyen (LIFG) de mettre fin à sa campagne terroriste en échange de la libération de prisonniers du LIFG en 2008, en promouvant une série de réformes pragmatiques et en lançant l’idée que le régime devrait reconnaître officiellement les Berbères du pays.
S’il a toujours été irréaliste de penser qu’il aurait pu transformer la Libye en une démocratie libérale s’il avait succédé à son père, il a certainement reconnu les problèmes de la Jamahiriyya et la nécessité d’une réforme approfondie. La perspective d’une voie réformiste sous Saif a été écartée par les événements de ce printemps. Peut-on établir un parallèle avec la façon dont les sanctions internationales prises après Lockerbie ont fait échouer la première initiative de réforme antérieure ?
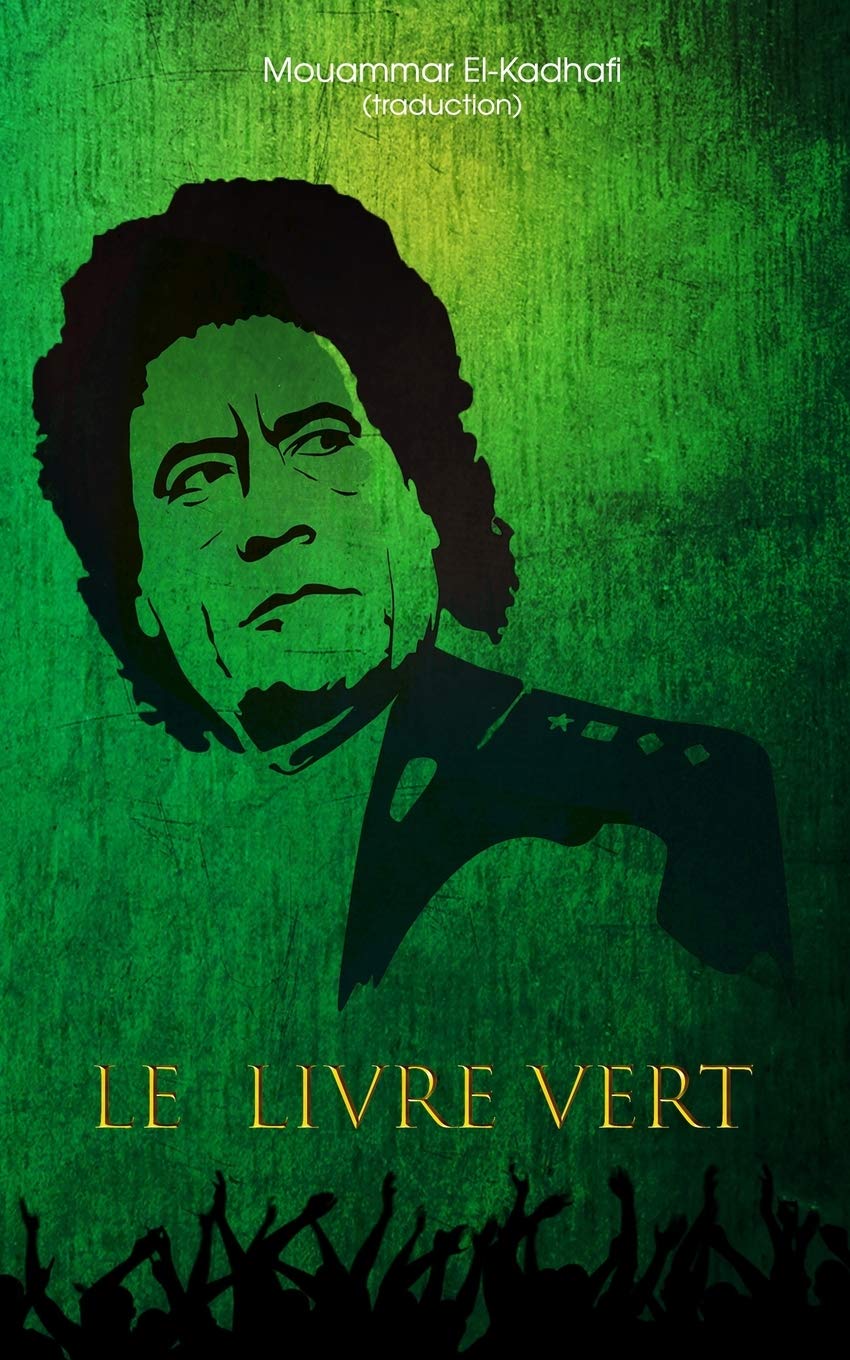
Depuis février, il a été affirmé sans relâche que le gouvernement libyen était responsable à la fois de l’attentat à la bombe contre une discothèque de Berlin le 5 avril 1986 et de l’attentat de Lockerbie le 21 décembre 1988. La nouvelle de la fin violente de Kadhafi a été accueillie avec satisfaction par les familles des victimes américaines de Lockerbie, naturellement pleines d’amertume envers l’homme dont le gouvernement américain et la presse leur avaient assuré qu’il était le commanditaire de l’attentat contre le vol Pan Am 103. Mais de nombreux observateurs avertis s’interrogent depuis longtemps sur ces deux histoires, en particulier celle de Lockerbie. Jim Swire, le porte-parole de UK Families Flight 103, dont la fille a été tuée dans l’attentat, a exprimé à plusieurs reprises son désaccord avec la version officielle.
Hans Köchler, juriste autrichien nommé par les Nations Unies en tant qu’observateur indépendant du procès, s’est dit inquiet de la manière dont celui-ci s’est déroulé (notamment concernant le rôle de deux fonctionnaires du ministère de la Justice américain qui se sont assis tout au long du procès à côté des procureurs écossais et ont semblé leur donner des instructions). Köchler a décrit la condamnation d’al-Megrahi comme « une spectaculaire erreur judiciaire ». Swire, qui a également assisté au procès, a ensuite lancé la campagne Justice pour Megrahi. Dans un résumé de la carrière de Kadhafi diffusé sur BBC World Service Television dans la nuit du 20 octobre, John Simpson s’est bien gardé d’approuver l’une ou l’autre des accusations, notant à propos de l’attentat de Berlin que « c’est peut-être ou peut-être pas l’œuvre du colonel Kadhafi », une formule honnête qui reconnaît qu’il y a place pour le doute. À propos de Lockerbie, il a fait remarquer avec prudence que la Libye avait par la suite été « désignée entièrement coupable », ce qui est tout à fait vrai.
Le personnel des gouvernements britannique et américain ainsi que la presse occidentale affirment souvent que la Libye a reconnu sa responsabilité dans l’attentat de Lockerbie en 2003-2004. Cette affirmation est fausse. Dans le cadre de l’accord conclu avec Washington et Londres, qui prévoyait le versement par la Libye de 2,7 milliards de dollars aux 270 familles des victimes, le gouvernement libyen a déclaré, dans une lettre adressée au président du Conseil de sécurité des Nations Unies, que la Libye « a facilité la traduction en justice des deux suspects accusés de l’attentat à la bombe contre le vol Pan Am 103 et accepte la responsabilité des actions de ses fonctionnaires ».
Le fait que cette formule ait été convenue lors de négociations entre les gouvernements libyen et britannique (voire américain) est apparu clairement lorsqu’elle a été reprise mot pour mot par Jack Straw à la Chambre des Communes. La formule a permis au gouvernement de donner à l’opinion publique l’impression que la Libye était effectivement coupable, tout en permettant à Tripoli de dire qu’elle n’avait rien admis de tel. La déclaration ne mentionne même pas le nom d’al-Megrahi, et reconnaît encore moins sa culpabilité ou celle du gouvernement libyen, et tout gouvernement qui se respecte souscrirait au principe général selon lequel il est responsable des actions de ses fonctionnaires. La position de Tripoli a été précisée par le Premier ministre, Shukri Ghanem, le 24 février 2004, dans le cadre de l’émission Today : il a précisé que le versement d’une indemnité n’impliquait pas une reconnaissance de culpabilité et a expliqué que le gouvernement libyen avait « acheté la paix. »
Les normes concernant les preuves qui sous-tendent les jugements occidentaux sur la Libye de Kadhafi n’ont pas été d’un niveau très exigeant. Le doute entourant le verdict du procès de Lockerbie a encouragé les théories contradictoires sur les véritables commanditaires de l’attentat, qui ont été, comme on pouvait s’y attendre, qualifiées de « théories du complot ». Mais les arguments de l’accusation dans le procès de Lockerbie étaient eux-mêmes une théorie du complot. Et les maigres preuves présentées auraient justifié un acquittement pour cause de doute raisonnable ou, tout au plus, le verdict « non prouvé » que la loi écossaise autorise, plutôt que le verdict sans équivoque de « culpabilité » prononcé, bizarrement, pour un des accusés mais pas pour l’autre. Je ne prétends pas connaître la vérité sur l’affaire Lockerbie, mais les Britanniques sont lents à pardonner aux auteurs d’atrocités commises contre eux et leurs amis.
J’ai donc du mal à croire qu’un gouvernement britannique se serait empressé, comme il l’a fait en 2003-2005, d’accueillir à nouveau la Libye dans son giron s’il avait réellement tenu Kadhafi pour responsable. Et compte tenu du nombre de victimes écossaises de l’attentat, il est tout aussi difficile de croire que les politiciens du SNP auraient approuvé la libération d’al-Megrahi s’ils avaient estimé que le verdict de culpabilité était fondé. L’hypothèse selon laquelle la Libye, Kadhafi et al-Megrahi auraient été piégés, est à prendre très au sérieux. Et si c’était le cas, il s’ensuivrait que les perspectives de réforme fortement réduites à partir de 1989, alors que le régime a fermé les écoutilles pour résister aux sanctions internationales, les souffrances matérielles du peuple libyen pendant cette période et l’aggravation du conflit interne (notamment la campagne terroriste islamiste menée par le LIFG entre 1995 et 1998) peuvent toutes, dans une certaine mesure, être imputées à l’Occident.
Quel que soit le responsable, la Jamahiriyya a survécu jusqu’en 2011 en conservant fondamentalement ses principales caractéristiques politiques : l’absence de partis politiques, l’absence d’associations, de journaux et de maisons d’édition indépendants et la faiblesse correspondante de la société civile, le caractère dysfonctionnel des institutions officielles du gouvernement, la faiblesse des forces armées et le caractère indispensable de Kadhafi lui-même en tant qu’initiateur de la révolution qui a constitué l’État. Après 42 ans de règne de Kadhafi, le peuple libyen n’était, politiquement parlant, pas beaucoup plus avancé qu’il ne l’était le 31 août 1969. La Jamahiriyya était donc vulnérable à une remise en cause interne dès que les mouvements de masse arabes faisant de la dignité humaine et des droits des citoyens un enjeu majeur ont démarré.
L’ironie tragique est que les caractéristiques de la Jamahiriyya qui l’ont rendue vulnérable au Printemps arabe ont aussi, dans leur ensemble, complètement exclu toute idée d’une émulation venant des scénarios tunisien et égyptien. Les facteurs qui ont permis une évolution fondamentalement positive dans ces deux pays, une fois le mouvement de protestation de masse lancé, étaient absents en Libye. En Tunisie et en Égypte, une plus grande expérience de l’action politique au sein de la population a conféré aux manifestations un certain degré de sophistication, de cohérence et de sens de l’organisation. Le fait qu’aucun des deux présidents n’ait été une figure fondatrice a permis de faire la distinction entre une protestation contre le président et ses comparses et une rébellion contre l’État : le patriotisme des manifestants n’a jamais été remis en question. Et dans les deux cas, le rôle des forces armées a été crucial : fidèles à l’État et à la nation plutôt qu’à un dirigeant particulier, elles étaient disposées à jouer le rôle d’arbitre et à faciliter une résolution sans que l’existence de l’État ne soit mise en péril.
Rien de tout cela ne s’appliquait à la Libye. Kadhafi était le fondateur de la Jamahiriyya et le garant de sa pérennité. Les forces armées étaient incapables de jouer un rôle politique indépendant. L’absence de toute tradition d’opposition non violente et d’organisation indépendante explique que la révolte au niveau populaire ait été une affaire grossière, incapable de formuler des demandes que le régime aurait pu négocier. Au contraire, la révolte était un défi à Kadhafi et à la Jamahiriyya dans son ensemble (et donc à ce qui existait en tant qu’État).
La situation qui s’est développée au cours du week-end qui a suivi les premiers troubles du 15 février laissait entrevoir trois scénarios possibles : un effondrement rapide du régime à mesure que le soulèvement populaire s’étendait ; l’écrasement de la révolte à mesure que le régime se ressaisissait ; ou – en l’absence d’une résolution rapide – le début d’une guerre civile. Si la révolte avait été écrasée immédiatement, les implications pour le Printemps arabe auraient été graves, mais pas nécessairement plus dommageables que les événements au Bahreïn, au Yémen ou en Syrie ; l’opinion publique arabe, depuis longtemps habituée à l’idée que la Libye était un endroit à part, était protégée contre la dimension d’exemplarité qu’auraient pu jouer les événements qui y survenaient.
Si la révolte avait rapidement entraîné l’effondrement du régime, la Libye aurait pu sombrer dans l’anarchie. Un Somalistan riche en pétrole sur la Méditerranée aurait eu des répercussions déstabilisantes pour tous ses voisins et préjugé des perspectives de développement démocratique en Tunisie notamment. Une longue guerre civile, bien que coûteuse en vies humaines, aurait pu donner à la rébellion le temps de se regrouper en un centre rival pour former un État et ainsi la préparer à la tâche d’établir un État libyen fonctionnel en cas de victoire. Et, même si elle avait été vaincue, une telle rébellion aurait sapé les prémisses de la Jamahiriyya et assuré sa disparition. Aucun de ces scénarios n’a eu lieu. A la place, on a assisté à une intervention militaire des puissances occidentales sous le couvert de l’OTAN et de l’autorité des Nations Unies.
Comment évaluer ce quatrième scénario au regard des principes démocratiques qui ont été invoqués pour justifier l’intervention militaire ? Il ne fait aucun doute que de nombreux Libyens considèrent l’OTAN comme leur sauveur et que certains d’entre eux aspirent sincèrement à un avenir démocratique pour leur pays. Malgré cela, j’ai ressenti une grande inquiétude lorsque l’intervention a commencé à être évoquée et j’y reste opposé encore aujourd’hui bien qu’elle ait rencontré un triomphe apparent, parce que je considérais que les arguments démocratiques étaient en faveur d’une action totalement différente.
L’affirmation selon laquelle la « communauté internationale » n’avait d’autre choix que d’intervenir militairement et que l’alternative était de ne rien faire est fausse. Une alternative active, concrète et non violente a été proposée, et délibérément rejetée. L’argument en faveur d’une zone d’exclusion aérienne, puis d’une intervention militaire employant « toutes les mesures nécessaires » était que seules ces mesures pouvaient mettre fin aux répressions du régime et protéger les civils. Pourtant, nombreux sont ceux qui affirmaient que le moyen de protéger les civils n’était pas d’intensifier le conflit en intervenant d’un côté ou de l’autre, mais d’y mettre fin en obtenant un cessez-le-feu suivi de négociations politiques. Un certain nombre de propositions ont été avancées.
L’International Crisis Group (ICG), par exemple, où je travaillais à l’époque, a publié le 10 mars une déclaration plaidant pour une initiative en deux points : (1) la formation d’un groupe ou d’un comité de contact composé des voisins nord-africains de la Libye et d’autres États africains, avec pour mandat de négocier un cessez-le-feu immédiat ; (2) des négociations entre les protagonistes, à l’initiative du groupe de contact, visant à remplacer le régime actuel par un gouvernement plus responsable, plus représentatif et plus respectueux des lois. Cette proposition a été reprise par l’Union africaine et était conforme aux vues de nombreux grands États non africains – Russie, Chine, Brésil et Inde, sans oublier l’Allemagne et la Turquie. Elle a été réitérée par le ICG de manière plus détaillée (en ajoutant une disposition prévoyant le déploiement, sous mandat de l’ONU, d’une force internationale de maintien de la paix pour assurer le cessez-le-feu) dans une lettre ouverte adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies le 16 mars, à la veille du débat qui s’est conclu par l’adoption de la résolution 1973 du CSNU.
En bref, avant que le Conseil de sécurité ne vote pour approuver l’intervention militaire, une proposition élaborée avait été présentée, qui répondait à la nécessité de protéger les civils en cherchant à mettre rapidement fin aux combats, et qui exposait les principaux éléments d’une transition ordonnée vers une forme de gouvernement plus légitime, qui éviterait le danger d’un basculement brutal dans l’anarchie, avec tout ce que cela pourrait signifier pour la révolution tunisienne, la sécurité des autres voisins de la Libye et la région au sens large. Imposer une zone d’exclusion aérienne serait un acte de guerre : comme le secrétaire américain à la Défense, Robert Gates, l’a déclaré au Congrès le 2 mars, elle nécessitait comme préalable indispensable la neutralisation des défenses aériennes de la Libye. En autorisant cette mesure et « toutes les mesures nécessaires », le Conseil de sécurité a choisi la guerre alors qu’aucune autre politique n’avait été tentée. Pourquoi ?

De nombreux détracteurs de l’intervention de l’OTAN se sont plaints qu’elle s’écartait des termes de la résolution 1973 et qu’elle était pour cette raison illégale ; que la résolution n’autorisait ni le changement de régime ni l’introduction de troupes sur le terrain. C’est une erreur d’interprétation. L’article 4 exclut l’introduction d’une force d’occupation. Or, l’article 42 du règlement de La Haye de 1907 stipule qu’un « territoire est considéré comme occupé lorsqu’il est effectivement placé sous l’autorité de l’armée ennemie », définition conservée par les Conventions de Genève de 1949.
Ce que la résolution 1973 excluait, c’était l’introduction d’une force destinée à assumer la pleine responsabilité politique et juridique du pays, mais cela n’a jamais été le but ; des forces terrestres ont effectivement été déployées par la suite, mais elles n’ont à aucun moment accepté la responsabilité politique ou juridique de quoi que ce soit et ne correspondent donc pas à la définition conventionnelle d’une force d’occupation. Il se peut que cette interprétation erronée de la résolution ait été convenue par les gouvernements qui l’ont rédigée afin d’obtenir le meilleur (ou le moins mauvais) nombre de votes favorables le 17 mars ; ce ne serait bien sûr qu’un exemple des sophismes auxquels les metteurs en scène de l’intervention ont eu recours. Et le changement de régime était tacitement couvert par l’expression « Toutes les mesures nécessaires ». La rhétorique de Cameron et de La Haye, de Sarkozy et de Juppé, d’Obama et de Clinton, avant le vote du Conseil de sécurité, avait déjà clairement montré que c’était la bonne façon de lire la résolution.
Puisque la question a été définie dès le départ comme étant la protection des civils contre l’attaque meurtrière de Kadhafi « contre son propre peuple », il s’ensuit qu’une protection efficace exigeait l’élimination de la menace, qui était Kadhafi lui-même, tant qu’il était au pouvoir (ultérieurement révisé en « tant qu’il est en Libye » avant de devenir finalement « tant qu’il est en vie »).
Au vu des attitudes adoptées par les puissances occidentales au cours de la période précédant le débat au Conseil de sécurité, il était évident que la résolution, habilement rédigée, autorisait tacitement une guerre pour effectuer un changement de régime. Ceux qui ont déclaré par la suite qu’ils ne savaient pas qu’un changement de régime avait été autorisé soit ne comprenaient pas la logique des événements, soit faisaient semblant de ne pas comprendre afin d’excuser leur incapacité à s’y opposer. En insérant « Toutes les mesures nécessaires » dans la résolution, Londres, Paris et Washington se sont autorisés, avec l’OTAN comme mandataire, à faire ce qu’ils voulaient quand ils le voulaient, en sachant parfaitement qu’ils ne seraient jamais tenus de rendre des comptes, puisqu’en tant que membres permanents du Conseil de sécurité disposant d’un droit de veto, ils sont au-dessus de toutes les lois.
À deux égards, le comportement des puissances occidentales et de l’OTAN semblait en effet violer explicitement les termes des résolutions du Conseil de sécurité. Le premier fait concerne la fourniture répétée d’armes à la rébellion par la France, le Qatar, l’Égypte (selon le Wall Street Journal) et sans doute d’autres membres de la « coalition des volontaires » dans ce qui semblait être une violation claire de l’embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité dans les articles 9, 10 et 11 de la résolution 1970 adoptée le 26 février et réitérée dans les articles 13, 14 et 15 de la résolution 1973. Il a été expliqué plus tard que la résolution 1973 remplaçait la résolution 1970 à cet égard et que l’expression magique « Toutes les mesures nécessaires » autorisait la violation de l’embargo sur les armes ; ainsi, l’article 4 de la résolution 1973 l’emportait sur les articles 13 à 15 de la même résolution. De cette manière, tout État pouvait fournir des armes aux rebelles, mais aucun ne pouvait le faire pour le gouvernement libyen, qui avait alors été déclaré illégitime par Londres, Paris et Washington. Presque personne n’a attiré l’attention sur la deuxième violation.
Les efforts du ICG et d’autres personnes cherchant une alternative à la guerre ne sont pas passés totalement inaperçus. Apparemment, leurs propositions ont fait une certaine impression sur les membres les moins enthousiastes du Conseil de sécurité, si bien que les rédacteurs de la résolution 1973 leur ont rendu un hommage appuyé. Dans la version finale – contrairement aux versions précédentes – l’idée d’une solution pacifique est incorporée dans les deux premiers articles, qui se lisent comme suit :
[Le Conseil de sécurité …]
(1) Exige l’instauration immédiate d’un cessez-le-feu et l’arrêt complet de la violence et de toutes les attaques et exactions contre les civils ; (2) Souligne qu’il faut redoubler d’efforts pour apporter une solution à la crise, qui satisfasse les revendications légitimes du peuple libyen, et note que le Secrétaire général a demandé à son Envoyé spécial de se rendre en Jamahiriya arabe libyenne et que le Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine a décidé d’envoyer son Comité ad hoc de haut niveau sur la Libye sur place pour faciliter un dialogue qui débouche sur les réformes politiques nécessaires à un règlement pacifique et durable;
Ce qui fait que la résolution de 1973 semblait envisager activement une alternative pacifique comme sa première préférence, tout en autorisant une intervention militaire comme solution de repli si un cessez-le-feu était refusé. En réalité, rien n’aurait pu être plus éloigné de la vérité.
La résolution 1973 a été adoptée à New York tard dans la soirée du 17 mars. Le lendemain, Kadhafi, dont les forces campaient à la lisière sud de Benghazi, annonçait un cessez-le-feu conforme à l’article 1 et proposait un dialogue politique conforme à l’article 2. Ce que le Conseil de sécurité avait exigé et indiqué, il l’a fait en quelques heures. Son cessez-le-feu a été immédiatement rejeté au nom du CNT par un commandant rebelle de haut rang, Khalifa Haftar, et écarté par les gouvernements occidentaux. « Nous le jugerons sur ses actes et non sur ses paroles », a déclaré David Cameron, laissant entendre que Kadhafi devait assurer par lui-même le cessez-le-feu dans son entier, c’est-à-dire non seulement ordonner à ses troupes de cesser le feu, mais aussi veiller à ce que ce cessez-le-feu soit indéfiniment pérenne, en dépit du fait que le CNT refuse de s’y soumettre.
Le commentaire de Cameron ne tenait pas compte non plus du fait que l’article 1 de la résolution 1973 ne faisait évidemment pas peser la charge d’un cessez-le-feu exclusivement sur Kadhafi. À peine Cameron avait-il couvert la violation indubitable de la résolution 1973 par le CNT qu’Obama est intervenu, insistant sur le fait que pour que le cessez-le-feu de Kadhafi puisse être pris en compte, il devrait (en plus de le garantir indéfiniment, seul, indépendamment du CNT), il devrait retirer ses forces non seulement de Benghazi mais aussi de Misrata et des villes les plus importantes que ses troupes avaient reprises à la rébellion, Ajdabiya à l’est et Zawiya à l’ouest – en d’autres termes, il devait accepter d’avance sa défaite stratégique. Ces conditions, qui étaient impossibles à accepter pour Kadhafi, étaient absentes de l’article 1.
Cameron et Obama avaient clairement indiqué que la dernière chose qu’ils souhaitaient était un cessez-le-feu, que le CNT pouvait violer l’article 1 de la résolution en toute impunité et que, ce faisant, il agirait avec l’accord de ses soutiens au Conseil de sécurité. La première offre de cessez-le-feu de Kadhafi n’a pas abouti, tout comme sa deuxième offre du 20 mars. Une semaine plus tard, la Turquie, qui avait travaillé dans le cadre de l’OTAN pour aider à organiser l’acheminement de l’aide humanitaire à Benghazi, a annoncé qu’elle s’était entretenue avec les deux parties et a proposé de négocier un cessez-le-feu. Cette offre a reçu ce qu’Ernest Bevin aurait appelé « une non-prise en compte totale » et n’a pas abouti, tout comme une initiative ultérieure, visant à obtenir un cessez-le-feu et des négociations (auxquelles Kadhafi a explicitement consenti), lancée par l’Union africaine en avril. Elle a également été rejetée d’emblée par le CNT, qui a exigé la démission de Kadhafi comme condition à tout cessez-le-feu. Cette exigence allait même au-delà de la liste de conditions établie précédemment par Obama, dont aucune ne figurait dans la résolution 1973. Plus précisément, cette exigence rendait le cessez-le-feu impossible, car pour obtenir un cessez-le-feu, il faut des commandants ayant une autorité décisive sur leurs armées, et la démission de Kadhafi aurait signifié que plus personne n’avait d’autorité sur les forces du régime.
En intégrant les propositions alternatives de politique non-violente dans son texte, le parti de la guerre occidental a réalisé un tour de passe-passe, en attirant quelques États indécis pour les amener à voter en faveur de la résolution le 17 mars : une guerre jusqu’au bout, un changement de régime violent et la fin de Kadhafi, telle était la politique depuis le début. Toutes les offres ultérieures de cessez-le-feu faites par Kadhafi – le 30 avril, le 26 mai et le 9 juin – ont été traitées avec le même mépris.
Ceux qui croient au « droit international » et se satisfont de guerres qu’ils considèrent comme « légales » voudront peut-être exploiter ce point. Mais le point crucial ici est lié à la logique des événements et aux choix politiques qui y sont associés. En incorporant les suggestions de l’ICG – ou, plus généralement, du parti de la paix – dans le texte révisé de la résolution 1973, Londres, Paris et Washington ont habilement écarté un véritable débat au Conseil de sécurité, un débat qui aurait permis d’envisager des alternatives, même si le prix en était que leur propre résolution se révèlerait alors incohérente.

Londres, Paris et Washington ne pouvaient pas autoriser un cessez-le-feu parce que cela aurait impliqué des négociations, d’abord au sujet des lignes de paix, des gardiens de la paix et tout ce qui s’ensuit, et puis aussi au sujet des différences politiques fondamentales. Et tout cela aurait compromis la possibilité du type de changement de régime qui intéressait les puissances occidentales. Le fait de voir des représentants de la rébellion s’asseoir pour discuter avec des représentants du régime de Kadhafi, des Libyens parlant à des Libyens, aurait remis en question la diabolisation de Kadhafi. Dès lors qu’il serait redevenu quelqu’un avec qui les gens parlent et négocient, il aurait été réhabilité. Et cela aurait exclu un changement de régime violent – révolutionnaire ? – ce qui aurait privé les puissances occidentales de la possibilité d’une intervention majeure dans le Printemps nord-africain, et tout le projet interventionniste aurait échoué.
La logique de la diabolisation de Kadhafi à la fin du mois de février, couronnée par le renvoi de ses crimes contre l’humanité présumés devant la Cour pénale internationale par la résolution 1970, puis par la décision de la France, le 10 mars, de reconnaître le CNT comme le seul représentant légitime du peuple libyen, a fait que Kadhafi a été banni à jamais du discours politique international, de toute possibilité de négociation, même pour la reddition de Tripoli lorsqu’il a proposé, en août, de négocier des conditions pour épargner à la ville une nouvelle destruction, une offre une fois de plus rejetée avec mépris. Et cette logique a été maintenue du début à la fin, comme le prouve le nombre de victimes civiles à Tripoli et surtout à Syrte. La mission était toujours un changement de régime, une vérité occultée par le brouhaha autour du massacre prétendument imminent de Benghazi.
Selon la version officielle, c’est la perspective d’un « second Srebrenica » ou même d’un « autre Rwanda » à Benghazi, si Kadhafi était autorisé à reprendre la ville, qui a contraint la « communauté internationale » (sans la Russie, la Chine, l’Inde, le Brésil, l’Allemagne, la Turquie et d’autres pays) à agir. Quelles raisons y avait-il de supposer qu’une fois que les forces de Kadhafi auraient repris Benghazi, elles recevraient l’ordre de se lancer dans un massacre général ?
Kadhafi a fait face à de nombreuses révoltes au fil des ans. Il les a invariablement matées par la force et a généralement exécuté les meneurs. Le CNT et d’autres chefs rebelles avaient de bonnes raisons de craindre qu’une fois Benghazi tombée aux mains des troupes gouvernementales, ils seraient rassemblés et auraient à en payer le prix. Il était donc naturel qu’ils essaient de convaincre la « communauté internationale » que ce n’était pas seulement leur vie qui était en jeu, mais celle de milliers de civils ordinaires. Mais en reprenant les villes que le soulèvement avait brièvement arrachées au contrôle du gouvernement, les forces de Kadhafi n’ont commis aucun massacre. Les combats ont été âpres et sanglants, mais il n’y a pas eu de massacre comparable à celui de Srebrenica, et encore moins à celui du Rwanda.
Le seul massacre connu perpétré sous le régime de Kadhafi est le meurtre de quelque 1 200 prisonniers islamistes à la prison d’Abu Salim en 1996. Il s’agissait d’une affaire très sombre, et que Kadhafi l’ait ordonnée ou non, il est juste de l’en tenir pour responsable. Il était donc raisonnable de s’inquiéter de ce que le régime pourrait faire et de la façon dont ses forces se comporteraient à Benghazi une fois qu’elles l’auraient reprise, et de dissuader Kadhafi d’ordonner ou de permettre tout excès. Mais ce n’est pas ce qui a été décidé. Ce qui a été décidé, c’est de déclarer Kadhafi coupable à l’avance d’un massacre de civils sans défense et de lancer le processus de destruction de son régime et de lui-même (et de sa famille) pour le punir d’un crime qu’il n’avait pas encore commis et qu’il était peu probable qu’il commette, et de poursuivre ce processus malgré ses offres répétées de suspendre l’action militaire.
Il n’a jamais été question de quoi que ce soit qui puisse être décrit comme un nettoyage ethnique ou un génocide dans le contexte libyen. Tous les Libyens sont musulmans, la majorité étant d’origine arabo-berbère, et si la petite minorité berbérophone avait un grief concernant la reconnaissance de sa langue et de son identité (ses membres sont des musulmans ibadites et non sunnites), ce n’était pas l’objet du conflit.
Le conflit n’était pas ethnique ou racial mais politique, entre les défenseurs et les opposants au régime de Kadhafi ; on pouvait s’attendre à ce que le camp qui l’emporterait traite ses adversaires de manière brutale, mais les prémisses d’un massacre à grande échelle de civils en raison de leur identité ethnique ou raciale étaient absentes. Tous les discours sur un autre Srebrenica ou un autre Rwanda étaient des hyperboles extrêmes visant clairement à faire paniquer les différents gouvernements pour qu’ils soutiennent le projet d’intervention militaire du parti de la guerre afin de sauver la rébellion d’une défaite imminente.
Pourquoi le facteur panique a-t-il si bien fonctionné auprès de l’opinion publique internationale, ou en tout cas occidentale, et surtout des gouvernements ? Selon des informations fiables, la crainte d’Obama d’être accusé de permettre un autre Srebrenica a fait pencher la balance à Washington, alors que non seulement Robert Gates mais aussi, au départ, Hillary Clinton s’étaient opposés à une participation américaine. Je pense que la réponse est que Kadhafi avait déjà été si soigneusement diabolisé que les accusations les plus folles sur son comportement futur probable (ou, comme beaucoup l’ont prétendu, certain) seraient crues quel que soit son comportement réel. Cette diabolisation a eu lieu le 21 février, le jour où toutes les cartes importantes ont été distribuées.
Le 21 février, le monde a été choqué par la nouvelle selon laquelle le régime de Kadhafi utilisait son aviation pour massacrer des manifestants pacifiques à Tripoli et dans d’autres villes. Le principal diffuseur de cette nouvelle était al-Jazeera, mais l’information a rapidement été reprise par les chaînes Sky, CNN, la BBC, ITN, etc. Avant la fin de la journée, l’idée d’imposer une zone d’exclusion aérienne à la Libye était largement acceptée, tout comme l’idée d’une résolution du Conseil de sécurité imposant des sanctions et un embargo sur les armes, gelant les avoirs de la Libye et déférant Kadhafi et ses comparses devant la CPI pour crimes contre l’humanité. La résolution 1970 a été dûment adoptée cinq jours plus tard et à partir de là, la proposition de zone d’exclusion aérienne a monopolisé les discussions internationales sur la crise libyenne.
Beaucoup d’autres choses se sont produites le 21 février. On a rapporté que le chaos régnait à Zawiya. Le ministre de la Justice, Mustafa Abdul Jalil, a démissionné. Cinquante travailleurs serbes ont été attaqués par des pillards. Le Canada a condamné « la répression violente de manifestants innocents ». Deux pilotes de l’armée de l’Air ont posé leurs chasseurs à Malte, affirmant qu’ils l’avaient fait pour éviter d’exécuter l’ordre de bombarder et de mitrailler les manifestants.
En fin d’après-midi, des troupes du régime et des tireurs d’élite ont tiré sur la foule à Tripoli, selon des sources fiables. Dix-huit travailleurs coréens ont été blessés lorsque leur lieu de travail a été attaqué par une centaine d’hommes armés. L’Union européenne a condamné la répression, suivie par Ban Ki-moon, Nicolas Sarkozy et Silvio Berlusconi. Dix Égyptiens auraient été tués par des hommes armés à Tobrouk. William Hague, qui avait condamné la répression la veille (tout comme Hillary Clinton), a annoncé lors d’une conférence de presse qu’il disposait d’informations selon lesquelles Kadhafi aurait fui la Libye et serait en route pour le Venezuela. L’ambassadeur de Libye en Pologne a déclaré que les défections au sein des forces armées et du gouvernement ne pouvaient être contrôlées et que les jours de Kadhafi étaient comptés.
De nombreux médias ont rapporté que la plus grande tribu de Libye, les Warfalla, avait rejoint la rébellion. Les ambassadeurs de la Libye à Washington, en Inde, au Bangladesh et en Indonésie ont tous démissionné, et l’ambassadeur adjoint de la Libye aux Nations Unies, Ibrahim Dabbashi, a clôturé la journée en convoquant une conférence de presse à la mission de la Libye à New York et a déclaré que Kadhafi avait « déjà commencé le génocide contre le peuple libyen » et faisait venir des mercenaires africains. C’est Dabbashi, plus que quiconque, qui, après avoir ainsi conditionné son public, a lancé l’idée que l’ONU devrait imposer une zone d’exclusion aérienne et que la CPI devrait enquêter sur les «crimes contre l’humanité et les crimes de guerre » de Kadhafi.
À ce stade, le nombre total de morts depuis le 15 février était de 233, selon Human Rights Watch. La Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) avance le chiffre de 300 à 400 (mais elle a également annoncé le même jour que Syrte était tombée aux mains des rebelles). Nous pouvons comparer ces chiffres avec le nombre total de morts en Tunisie (300) et en Égypte (au moins 846). On peut également comparer les chiffres de HRW et de la FIDH avec le bilan, plausiblement estimé entre 500 et 600 morts, des sept jours d’émeutes en Algérie en octobre 1988, alors que le gouvernement français s’était rigoureusement abstenu de tout commentaire sur les événements. Mais le 21 février, les chiffres n’avaient pas d’importance ; ce sont les impressions qui comptaient. L’impression produite par l’histoire selon laquelle l’armée de l’Air de Kadhafi massacrait des manifestants pacifiques était phénoménale, et il était naturel de considérer les démissions d’Abdul Jalil et des ambassadeurs, la fuite des deux pilotes, et surtout la déclaration dramatique de Dabbashi sur le génocide comme corroborant l’histoire d’al-Jazeera.
Les bons et les méchants (pour reprendre les catégories de Tony Blair) avaient été clairement identifiés, l’attention indignée des médias occidentaux était totalement mobilisée, le Conseil de sécurité s’était saisi d’urgence de la question, la CPI s’organisait pour être prête, et un virage fondamental en faveur de l’intervention avait été pris – tout cela en quelques heures. Et à juste titre, diront certains. Sauf que l’histoire d’al-Jazeera était fausse, tout comme l’histoire du soutien de Warfalla à la rébellion était fausse et l’histoire de La Haye selon laquelle Kadhafi fuyait vers Caracas était fausse. Et, bien sûr, l’affirmation de Dabbashi sur le « génocide » était une ineptie hystérique qu’aucune des organisations intéressées par l’utilisation de ce terme n’a voulu contester.
Ces considérations soulèvent des questions délicates. Si la raison invoquée par ces ambassadeurs et d’autres membres du régime pour faire défection le 21 février était fausse, qu’est-ce qui les a réellement poussés à faire défection et à faire les déclarations qu’ils ont faites ? Que préparait al-Jazeera ? Et que préparait La Haye ? Un travail historique sérieux sur cette affaire, lorsque davantage de preuves seront mises en lumière, cherchera à répondre à ces questions.
Mais je n’ai pas de mal à comprendre que Kadhafi et son fils aient soudainement eu recours à une rhétorique aussi féroce. Ils pensaient clairement que, loin d’être confrontés à de simples « manifestants innocents », comme l’ont dit les Canadiens, ils étaient déstabilisés par des forces agissant selon un plan aux ramifications internationales. Il est possible qu’ils se soient trompés et que tout ait été spontané, accidentel et chaotique ; je ne prétends pas avoir de certitudes. Mais il y avait déjà eu des plans pour déstabiliser leur régime auparavant, et ils avaient des raisons de penser que c’était de nouveau le cas.

La couverture biaisée des médias britanniques en particulier, notamment l’insistance sur le fait que le régime n’était confronté qu’à des manifestants pacifiques alors que, outre les Libyens ordinaires qui tentaient de faire entendre leur voix de manière non violente, il était confronté à des violences tant politiques qu’aléatoires (par exemple, le lynchage de 50 mercenaires présumés à al-Baida le 19 février), était conforme à la théorie de la déstabilisation. Et d’après les preuves que j’ai pu recueillir depuis, je suis enclin à penser qu’il s’agissait bien d’une déstabilisation en due forme qui était en oeuvre.
Dans les jours qui ont suivi, je me suis efforcé de vérifier par moi-même l’histoire d’al-Jazeera. L’une des sources que j’ai consultées est le blog très respecté Informed Comment, tenu et mis à jour quotidiennement par Juan Cole, spécialiste du Moyen-Orient à l’université du Michigan. Le 21 février, ce blog a publié un article intitulé « Les bombardements de Kadhafi rappellent ceux de Mussolini », qui soulignait qu’en « 1933-1940, Italo Balbo s’est fait le champion de la guerre aérienne comme étant le meilleur moyen de traiter les populations coloniales rebelles ».
Le message commençait ainsi : « Les manifestants civils à Tripoli mitraillés et bombardés par les avions de chasse de Mouammar Kadhafi lundi… », les mots soulignés renvoyant à un article de Sarah El Deeb et Maggie Michael pour Associated Press publié le 21 février à 21 heures. Cet article ne corrobore en rien l’affirmation de Cole selon laquelle les avions de chasse de Kadhafi (ou tout autre appareil) auraient mitraillé ou bombardé qui que ce soit à Tripoli ou ailleurs. Il en va de même pour toutes les sources indiquées dans les autres articles sur la Libye relayant l’histoire de l’attaque aérienne que Cole a publiée le même jour.
J’étais en Égypte pendant la majeure partie du temps, mais comme de nombreux journalistes se rendant en Libye transitaient par le Caire, je me suis fait un devoir de demander à ceux que j’ai pu joindre ce qu’ils avaient observé sur le terrain. Aucun d’entre eux n’avait trouvé la moindre confirmation de cette histoire. Je me souviens en particulier d’avoir demandé, le 18 mars, à Jon Marks, expert britannique de l’Afrique du Nord, qui revenait d’une longue tournée en Cyrénaïque (Ajdabiya, Benghazi, Brega, Derna et Ras Lanuf), ce qu’il avait entendu de cette histoire. Il m’a répondu qu’il avait discuté avec de nombreuses personnes dont aucune n’avait entedu parler de ça. Quatre jours plus tard, le 22 mars, USA Today a publié un article saisissant d’Alan Kuperman, auteur de The Limits of Humanitarian Intervention et coéditeur de Gambling on Humanitarian Intervention. L’article, intitulé « Five Things the US Should Consider in Libya » (Cinq choses que les États-Unis devraient prendre en considération en Libye), critiquait vigoureusement l’intervention de l’OTAN, estimant qu’elle violait les conditions à respecter pour qu’une intervention humanitaire soit justifiée ou réussie.
Mais ce qui m’a le plus intéressé, c’est sa déclaration selon laquelle « malgré l’omniprésence des caméras des téléphones portables, il n’y a pas d’images de violence génocidaire, une affirmation qui a un goût de propagande des rebelles ». Ainsi, quatre semaines plus tard, je n’ai pas été le seul à ne trouver aucune preuve de cette histoire de massacre aérien. J’ai découvert par la suite que la question avait été soulevée plus de quinze jours auparavant, le 2 mars, lors d’auditions de témoignage au Congrès américain de Gates et de l’amiral Mike Mullen, président des chefs d’état-major interarmées, auprès du Congrès américain. Ils ont déclaré au Congrès qu’ils n’avaient aucune confirmation d’informations concernant des avions contrôlés par Kadhafi qui auraient tiré sur des citoyens.
Cette histoire était fausse, tout comme l’était celle qui a fait le tour du monde en août 1990, selon laquelle les troupes irakiennes massacraient des bébés koweïtiens en éteignant leurs couveuses, et comme l’affirmait le dossier racoleur sur les ADM (Armes de destruction massive) de Saddam. Mais comme l’a fait remarquer un jour Mohammed Khider, l’un des fondateurs du FLN, « lorsque tout le monde reprend une idée fausse, elle devient une réalité ». La ruée vers le changement de régime par la guerre était lancée et ne pouvait être arrêtée.
L’intervention a entaché chacun des principes que le parti de la guerre invoquait pour la justifier. Elle a provoqué la mort de milliers de civils, dévalorisé l’idée de démocratie, dévalorisé l’idée de droit et fait passer une contrefaçon pour une vraie révolution. Deux affirmations sans cesse répétées – elles étaient essentielles pour justifier le déclenchement de la guerre par les puissances occidentales – étaient que Kadhafi était en train de « massacrer son propre peuple » et qu’il avait « perdu toute légitimité », la seconde étant présentée comme le corollaire de la première. Ces deux assertions relevaient de mystifications.
« Tuer son propre peuple » est une phrase héritée de la précédente guerre de changement de régime contre Saddam Hussein. Dans les deux cas, elle indiquait deux choses : que le despote était un monstre et qu’il ne représentait rien dans la société qu’il dirigeait. Il est tendancieux et malhonnête de dire simplement que Kadhafi « tuait son propre peuple » ; il tuait les gens de son peuple qui se rebellaient. Il faisait à cet égard ce que tous les gouvernements de l’histoire ont fait quand ils se sont trouvés face à une rébellion. Dans une situation donnée nous sommes tous libres de préférer les rebelles au gouvernement. Mais les mérites relatifs des deux camps ne sont pas une question de situation : le problème est le droit d’un État à se défendre contre la subversion violente. Ce droit, autrefois considéré comme acquis et corollaire de la souveraineté, est aujourd’hui compromis.
Théoriquement, il est conditionné par certaines règles. Mais, comme nous l’avons vu, l’invocation de règles (par exemple, pas de génocide) peut aller de pair avec une exagération et une déformation cyniques des faits par d’autres États. En fait, il n’existe pas de règles fiables. Un État peut réprimer une révolte si les détenteurs du droit de veto permanent au Conseil de sécurité l’y autorisent (par exemple, le Bahreïn, mais aussi le Sri Lanka) et pas autrement. Et si un État pense qu’il peut considérer cette autorisation informelle de se défendre comme acquise parce qu’il est en bons termes avec Londres, Paris et Washington et qu’il satisfait à tous les accords qu’il avait passés avec ces pays, comme c’était le cas de la Libye, il doit se méfier. Les termes peuvent changer sans avertissement d’un jour à l’autre. La chose est désormais arbitraire, et l’arbitraire est le contraire du droit.
La thèse selon laquelle Kadhafi ne serait pas représentatif de la société libyenne, qu’il s’en prenait à tout son peuple et que celui-ci était contre lui était une autre déformation des faits. Comme le montrent la durée de la guerre, l’énorme manifestation pro-Kadhafi à Tripoli le 1er juillet, la résistance acharnée des forces de Kadhafi, le mois qu’il a fallu aux rebelles pour arriver à quelque chose à Bani Walid et le mois supplémentaire en ce qui concerne Syrte, le régime de Kadhafi bénéficiait d’un soutien important, tout comme le CNT. La société libyenne était divisée et la division politique était en soi un développement encourageant puisqu’elle signifiait la fin de l’ancienne unanimité politique enjointe et maintenue par la Jamahiriyya.
Dans cette optique, le portrait que les gouvernements occidentaux dressent du « peuple libyen », uniformément opposé à Kadhafi, a une implication sinistre, précisément parce qu’il insinue une nouvelle unanimité parrainée par l’Occident dans la vie libyenne. Cette idée profondément antidémocratique découlait naturellement de l’idée tout aussi antidémocratique selon laquelle, en l’absence de consultation électorale ou même de sondage d’opinion pour connaître l’opinion réelle des Libyens, les gouvernements britannique, français et américain avaient le droit et l’autorité de déterminer qui faisait partie du peuple libyen et qui n’en faisait pas partie. Aucune personne soutenant le régime de Kadhafi ne comptait. Parce qu’ils ne faisaient pas partie du « peuple libyen », ils ne pouvaient pas faire partie des civils à protéger, même s’ils étaient des civils de fait. Et ils n’ont pas été protégés ; ils ont été tués par des frappes aériennes de l’OTAN ainsi que par des unités rebelles incontrôlées.
Le nombre de ces victimes civiles du mauvais côté de la guerre doit être plusieurs fois supérieur au nombre total de morts au 21 février. Mais elles ne comptent pas, pas plus que les milliers de jeunes hommes de l’armée de Kadhafi qui s’imaginaient innocemment qu’ils faisaient eux aussi partie du « peuple libyen » et ne faisaient que leur devoir envers l’État, lorsqu’ils ont été calcinés par les avions de l’OTAN ou exécutés hors tout cadre juridique après leur capture, comme à Syrte.
Le même mépris du principe démocratique a caractérisé les déclarations répétées de l’Occident selon lesquelles Kadhafi avait « perdu toute légitimité ». Tout État a besoin d’une reconnaissance internationale et, dans cette mesure, dépend de sources extérieures de légitimation. Mais le principe de la démocratie donne la priorité à la légitimité nationale sur la légitimité internationale. En affirmant que Khadafi avait perdu toute légitimité, les puissances occidentales ne se contentaient pas d’anticiper une éventuelle élection en Libye qui aurait permis de connaître le véritable rapport de force des rapports dans l’opinion publique, mais elles imitaient le régime de Kadhafi : dans la Jamahiriyya, le peuple était susceptible d’être supplanté par la révolution comme source de légitimité supérieure.
« Si vous cassez, vous payez », a fait remarquer Colin Powell, alors qu’il alertait le Beltway [compagnies privées siégeant à proximité des centres de pouvoir, NdT] sur les risques d’une nouvelle guerre contre l’Irak. La leçon du désordre en Irak a été tirée, du moins dans la mesure où les puissances occidentales et l’OTAN ont insisté à plusieurs reprises pour que le peuple libyen – le CNT et les milices révolutionnaires – soit le seul maître de sa révolution. Ainsi, n’étant pas en charge de la Libye après la chute de Kadhafi, l’OTAN, Londres, Paris et Washington ne peuvent être accusés de l’avoir détruite ou être tenus responsables des débris. Le résultat est un théâtre d’ombres. Le CNT occupe le devant de la scène en Libye, mais depuis février, chaque décision clé a été prise dans les capitales occidentales en consultation avec les autres membres, notamment arabes, du « groupe de contact » réunis à Londres, Paris ou Doha. Il est peu probable que la structure du pouvoir et le système de prise de décision qui ont guidé la « révolution » depuis mars changent radicalement.

Par conséquent, à moins que quelque chose ne vienne bouleverser les calculs qui ont conduit l’OTAN et le CNT jusqu’ici, il est probable que l’on va assister à l’émergence d’un système de double pouvoir, en quelque sorte analogue à celui de la Jamahiriyya elle-même, et tout aussi peu favorable à la responsabilité démocratique. En d’autres termes, un système de prise de décision formelle sur des questions secondaires servant de façade à un système de prise de décision dans les coulisses, distinct et indépendant parce qu’offshore, concernant tout ce qui compte vraiment (pétrole, gaz, eau, finances, commerce, sécurité, géopolitique) . Le gouvernement officiel de la Libye sera un partenaire mineur des investisseurs occidentaux de la nouvelle Libye. Il s’agira davantage d’un retour aux anciennes méthodes de la monarchie qu’à celles de la Jamahiriyya.
Hugh Roberts
Hugh Roberts est titulaire de la chaire Edward Keller d’histoire de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient à l’université Tufts. Ses livres les plus récents sont The Battlefield : Algeria 1988-2002 et Berber Government : The Kabyle Polity in Pre-Colonial Algeria.
Source : London Review of Books, Hugh Roberts, 17-11-2011
Traduit par les lecteurs du site Les-Crises
