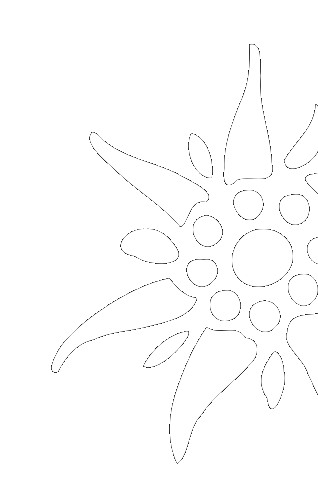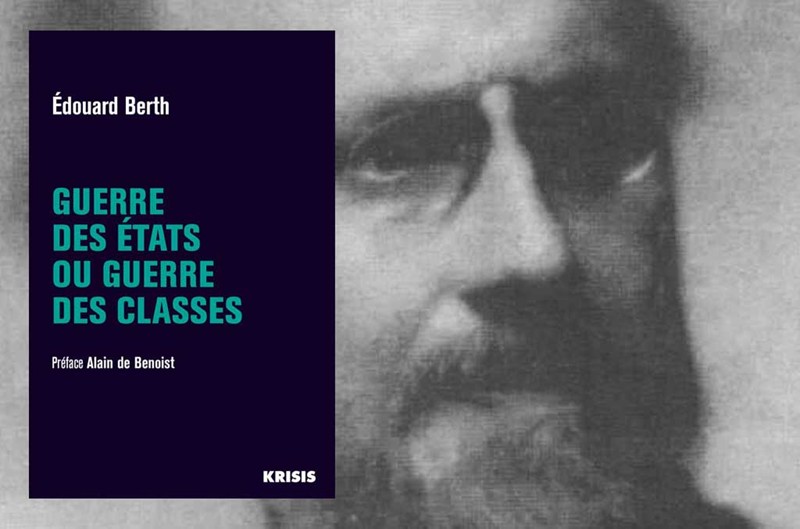
À l’occasion de la réédition de l’ouvrage d’Edouard Berth, « Guerre des États ou guerre des classes », aux éditions Krisis, nous avons interrogé Alain de Benoist, qui en a rédigé la préface, sur cette figure iconoclaste et inclassable du « socialisme française », restant encore largement méconnue du grand public malgré une œuvre majeure pour comprendre l’entre-deux guerres.
ÉLÉMENTS. Dans le cadre des éditions Krisis, mais aussi dans les pages de la revue Éléments, vous avez entrepris un important travail de réédition et de « redécouverte » de la figure d’Edouard Berth et de son œuvre. Quelles sont les origines et raisons de votre intérêt particulier pour cet auteur ?
ALAIN DE BENOIST : Edouard Berth (1875-1939) est généralement présenté dans les manuels d’histoire des idées comme « le plus fidèle disciple de Georges Sorel ». C’est donc, fondamentalement un auteur qui s’inscrit dans la mouvance du syndicalisme révolutionnaire, pour laquelle j’éprouve depuis toujours une grande sympathie. Mais si je me suis intéressé à lui, c’est aussi parce que son évolution l’a amené à assumer ses idées dans des contextes très différents, ce qui fait aussi de lui un personnage « transversal ». J’aime bien les personnages « transversaux », car ce sont des personnalités polyphoniques : tout le contraire des disques rayés ! C’est aussi ce qui rend passionnant son itinéraire politique et intellectuel, dont j’ai essayé de rendre compte dans le livre que je lui ai consacré en 2013.
En 2007, j’avais déjà réédité chez Krisis son essai le plus connu, Les méfaits des intellectuels, paru en 1914. A cette époque, Berth était très proche de Georges Valois, lui-même passé de l’anarchisme à l’Action française. C’est avec lui qu’il lança le Cercle Proudhon, structure éphémère devenue « mythique », où se retrouvèrent à la fois des royalistes et des syndicalistes révolutionnaires. Guerre des Etats ou Guerre des Classes est paru dix ans plus tard, en août 1924. Dès les premières pages, on constate que le ton a changé, les idées qui s’y expriment également. L’ennemi est toujours le même – « nos démocraties bourgeoises qui ne savent qu’osciller entre un césarisme omnipotent et un individualisme de pure dissolution sociale » –, et l’objectif est toujours d’en finir avec l’« ère ploutocratique », pour retrouver les « allures décentes et modestes » dont se nourrit le « sublime prolétarien », mais l’angle d’attaque est différent.
ÉLÉMENTS. Dans Guerre des États ou Guerre des Classes, Edouard Berth interroge, pour les militants politiques de l’époque, l’alternative entre « fascisme » et « communisme », entre Lénine et Mussolini. Peut-on considérer Berth comme un théoricien de cette fameuse « troisième voie » politique que beaucoup ont recherché, mais que bien peu ont réussi à véritablement tracer ?
ALAIN DE BENOIST : Non. La « troisième voie », Edouard Berth a plutôt essayé de la trouver à l’époque du Cercle Proudhon, quand il voulait concilier l’« esprit apollinien » de Maurras et l’« esprit dionysien » de Sorel. En 1924, deux ans après la mort de Sorel, Berth n’attend plus rien d’une droite qui l’a trop déçu. A ses yeux, l’heure n’est plus à une synthèse des idées de Maurras et de Sorel. L’alternative qui domine ce début des années 1920, c’est « Lénine ou Mussolini » – voire « Maurras ou Lénine » ! La révolution russe est passée par là – et, avant elle, la Grande Guerre qui a tout changé. Comme Sorel, Berth a condamné avec force le ralliement de l’Action française à l’« Union sacrée », tout comme celui de la CGT, en laquelle il avait placé tant d’espoirs à l’époque de la Charte d’Amiens. Ce ralliement a été à ses yeux doublement inacceptable : Maurras, qu’il traite de « Jacobin blanc », s’est trahi lui-même « en rebaptisant national ce qui n’est que bourgeois », et la classe ouvrière s’est laissé séduire par les partis. « Depuis août 1914, écrit Berth, l’A.F. a cessé moralement d’exister » ! D’où le titre de son livre.
Georges Sorel a d’abord accueilli la révolution de 1917 comme une divine surprise. « Il faut être aveugle pour ne pas voir que la révolution russe est l’aurore d’une ère nouvelle », dira-t-il dans l’avant-propos des Matériaux d’une théorie du prolétariat. En octobre 1918, il publie même une « Apologie pour Lénine », texte bien connu de tous les soréliens qui sera incorporé à la 4e édition des Réflexions sur la violence. Edouard Berth, pendant quelques années, va camper sur la même position. Contrairement à Georges Valois, avec qui il a (provisoirement) rompu, il n’éprouve pas la moindre sympathie pour le fascisme. A partir de 1922, il collabore à la revue communiste Clarté, fondée l’année précédente par Henri Barbusse, faisant de Lénine une sorte de saint sorélien, « qui ne vécut littéralement que pour la Révolution, corps et âme, avec le dévouement absolu et total d’un jésuite pour son ordre, d’un grognard pour son Empereur ou d’un Machiavel pour son Prince » ! Mais son enthousiasme retombera vite et, contrairement à beaucoup d’autres, il reconnaîtra très tôt son erreur. Dès 1925, il cesse d’écrire dans Clarté et fait son autocritique. Loin de redonner vie aux idéaux de Sorel et de Proudhon, la révolution russe n’a fait qu’instaurer une nouvelle dictature d’Etat – un « communisme de termites ».
ÉLÉMENTS. L’œuvre de Berth n’a-t’elle désormais qu’un intérêt purement « historique » dans le domaine des idées politiques ou peut-on encore trouver aujourd’hui des échos aux réflexions et questionnements qu’elle contient ?
ALAIN DE BENOIST : « L’histoire pour l’histoire », c’est un peu comme « l’art pour l’art « : une formule qui ne veut pas dire grand-chose. L’histoire abonde toujours en exemples, en contre-exemples et en leçons. Tiraillé entre la droite et la gauche, Sorel et Marx, Lénine et Maurras, Edouard Berth est toujours resté fidèle à ses convictions, à commencer par l’idée que « tous les héroïsmes sont frères, le militaire comme le religieux et le révolutionnaire ». L’objectif premier du syndicalisme révolutionnaire était la lutte contre la démocratie libérale et le système de l’argent. Berth, qui se voulait un « serviteur désintéressé du prolétariat », a toujours fait passer ses idées avant tout (et d’abord avant lui-même). Son parti-pris résolu en faveur du peuple – et des peuples –, sa conviction qu’il faut organiser la société à partir du bas, et non de manière autoritaire à partir du haut, sa théorie des antagonismes, son combat en faveur de la pluralité, son goût de l’autonomie et de la liberté, sa hantise de la décadence, sa dénonciation des valeurs marchandes et bourgeoises, son goût du « sublime », sa volonté sans cesse réaffirmée d’associer des idéaux opposés, qui l’a souvent amené à se battre en même temps sur deux fronts, l’originalité même de son itinéraire personnel, rendent sa pensée plus actuelle que jamais.
- Je laisse le lecteur découvrir son livre. J’en extrairai pour ma part cette simple remarque que ne désavoueraient certainement ni Jean-Claude Michéa ni Christophe Guilluy à l’époque de la « France périphérique » et de la montée des populismes : « En tout pays, c’est le peuple, beaucoup plus soudé au sol et à la langue et à tout ce qui constitue une patrie que les classes riches, dont la vie est plus cosmopolite (la richesse étant un facteur de rapide dénationalisation), qui représente ce qu’il y a en tous pays de plus indigène ». Indigènes de tous les pays, unissez-vous !
- Propos recueillis par Xavier Eman - 15 avril 2025
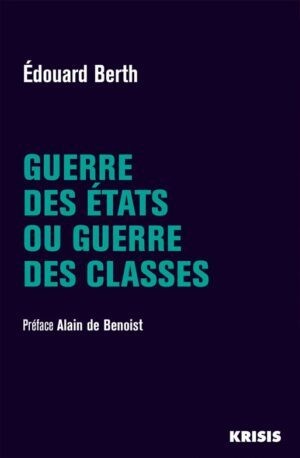
Guerre des états ou guerre des classes
29,90€