
Une réédition qui sera pour beaucoup une révélation surprenante (Poche Club).
La lecture du préambule au plus célèbre ouvrage d'Arthur de GOBINEAU, aujourd'hui possible, sera pour le plus grand nombre, une révélation surprenante.
C'est que « l’essai sur l'Inégalité des Races humaines » appartient à cette catégorie de livres qui ont fait école, suscité les plus âpres, les plus violentes controverses passionnées, voire passionnelles et que, tout compte fait, fort peu de personnes ont lu. N'en est-il pas ainsi pour Marx dans une certaine mesure et l'exégèse ne remporte-t-elle pas largement sur le texte?
Le fait est certain pour GOBINEAU, aussi faut-il se féliciter que le texte essentiel soit aujourd'hui facilement accessible. Le texte essentiel puisqu'il s'agit de « l’Introduction à l'Essai sur l'Inégalité des races humaines » loyale déclaration d'intentions, déjà fortement motivée, ou bien encore « véritable ouverture d'opéra » comme l'écrit l'éditeur dans sa préface, précédant cinq volumes consacrés aux développements des thèmes qui sont : le caractère mortel de toute civilisation, la permanence des caractères raciaux et l'accord de ceux-ci avec les formes de gouvernement, même imposées, l'importance toute secondaire dans les processus de décadence des mauvais gouvernements, du relâchement des mœurs et autres raisons généralement produites, mais la constatation de la cause première dans la « dégénération », c'est-à-dire un mélange de sang, le rôle enfin du rameau aryen, le plus inventif de la race blanche que Gobineau nomme la race « Ariane » et l'intervention décisive desdits « Arians » dans l'avènement de toute civilisation.
Sans doute, et nous ne l'ignorons pas, l'ethnologie et l'anthropologie sont des sciences qui ont largement progressé depuis les années de composition de « l'Essai » (1848-1852), mais si Gobineau, dans l'avant-propos à la seconde édition de son livre, pouvait écrire qu'il n'y avait pas changé une ligne « non pas que dans l'intervalle des travaux considérables n'aient déterminé bien des progrès de détails » sans pour autant ébranler « aucune des vérités » qu'il avait émises, il nous semble qu'à très peu près il pourrait encore souscrire à ce jugement, tant il y a de prudence et de réserve dans les constatations de l'auteur.
Sans doute serait-il aujourd'hui catégorique sur la multiplicité des origines de l'espèce humaine, encore qu'il n'ait guère dissimulé son point de vue, mais les précautions dont il use lorsqu'il aborde, tout à fait incidemment l'origine même de l'homme, finalement n'ont pas autrement d'importance, puisque les seules périodes qu'il considère pour sa démonstration sont strictement mesurées par l'apparition de l'Histoire.
Ce sont les civilisations elles-mêmes qui sont l'objet de son propos et les conditions de leur apparition, de leur épanouissement et de leur déclin.
Il faut ici encore remarquer que Gobineau, dans cette préface, met en cause l'idéologie dominante de son siècle et du siècle précédent, le progressisme et la doctrine égalitaire aussi fermement qu'il prend ses distances avec le Darwinisme et les affirmations des congrès préhistoriques.
Alors au milieu des incohérences les plus fantasques, on ouvre tout à coup, dans tous les coins du globe terrestre, des trous, des caves, des cavernes de l'aspect le plus sauvage, et «: on en fait sortir des amoncellements épouvantables de crânes et de tibias fossiles, de détritus comestibles, d'écaillés d'huîtres et d'ossements de tous les animaux possibles et impossibles, taillés, gravés, éraflés, polis et non polis, de haches, de têtes de flèches, d'outils sans noms ; et le tout s'écroulant sur les imaginations troublées, aux fanfares retentissantes d'une pédanterie sans pareille, les ahurit d'une « manière si irrésistible que les adeptes peuvent sans scrupule, « avec sir Hoba Lubbock et M. Evans, héros de ces rudes labeurs, assigner à toutes ces belles choses une antiquité, tantôt de cent mille années, tantôt une autre de cinq cent mille, « et ce sont des différences d'avis dont on ne s'explique pas le « moins du monde le motif. »
Qu'on remplace les milliers d'années par des millions d'années et l'on aura un texte parfaitement lisible aujourd'hui encore ! C'est donc seulement sur le terrain historique que Gobineau se place et son racisme, très pessimiste comme on va le voir et des plus mesurés, est la conséquence d'une série de constatations d'évidences.
La première, la plus inéluctable, semble-t-il, c'est le caractère précaire des civilisations. Gobineau est aussi un français cartésien et s'il reconnaît que « nulle civilisation ne s'éteint sans que Dieu le veuille » et que « toutes les sociétés sont coupables », il n'en veut pas moins savoir par quelles voies et moyens, sociétés et civilisations disparaissent.
« Les Spartiates n'ont vécu et gagné l'admiration que par les effets d'une législation de bandits. Les Phéniciens ont-ils dû leur perte à la corruption qui les rongeait et qu'ils allaient semant partout ? Non, tout au contraire, c'est cette corruption qui a été l'instrument principal de leur puissance et de leur gloire ; depuis le jour où, sur les rivages des îles grecques (1) ils allaient, trafiquants fripons, hôtes scélérats, séduisant les femmes pour en faire marchandise, et volant çà et là les denrées qu'ils couraient vendre, leur réputation fut, à coup sûr, bien et justement flétrissante ; ils n'en ont pas moins grandi et tenu dans les annales du monde un rang dont leur rapacité et leur mauvaise foi n'ont nullement contribué à les faire descendre.
« Loin de découvrir dans les sociétés jeunes une supériorité de morale, je ne doute pas que les nations en vieillissant, et par conséquent en approchant de leur chute, ne présentent aux yeux du censeur un état beaucoup plus satisfaisant. Les usages s'adoucissent, les hommes s'accordent davantage, chacun trouve à vivre plus aisément, les droits réciproques ont eu le temps de mieux se définir et comprendre ; si bien que les théories sur le juste et l'injuste ont acquis peu à peu un plus haut degré de délicatesse. »
De même il « établira sans difficulté que le fanatisme, le luxe, les mauvaises mœurs et l'irréligion n'amènent pas nécessairement la chute des sociétés », les civilisations anciennes en fournissent des témoignages assez probants, non plus même que les mérites ou les tares des gouvernements.
Toutes ces causes secondaires ne sont pas suffisantes pour justifier l'effondrement des sociétés tant « qu'un principe destructif né d'elles-mêmes » n'intervient pas. C'est-à-dire aussi longtemps que les éléments de ces sociétés ne sont pas dégénérés.
Et l'homme dégénéré est un produit différent, au point de vue ethnique, du héros des grandes époques.
De poser alors la grande question :
« Y a-t-il entre les races humaines des différences de valeur intrinsèque réellement sérieuses, et ces différences sont-elles possibles à apprécier ?».
Et d'invoquer le témoignage des tribus les plus primitives qui ne sont pas parvenues à s'élever, en s'incorporant leurs voisins, à l'échelon de peuplade, ou qui y « croupissent, sans passer à l'état de nation, c'est-à-dire en prenant « non seulement les habitants mais le sol avec eux. »
Et, ce sera une surprise pour beaucoup, c'est dans les croisements qui s'opéreront plus ou moins facilement que Gobineau trouvera la cause des transformations et au contraire dans la répugnance instinctive aux mélanges dont l'auteur cite de nombreux exemples, celle de la stagnation. Conquérants et conquis ce sont les deux termes de l'histoire des nations, et d'illustrer son propos en ces termes :
« Je ne sais si le lecteur y a déjà pensé, mais, dans le tableau que je trace, et qui n'est autre, à certains égards, que celui présenté par les Hindous, les Egyptiens, les Perses, les Macédoniens, deux faits me paraissent bien saillants. Le premier, c'est qu'une nation, sans force et sans puissance, se trouve tout à coup, par le fait d'être tombée aux mains de maîtres vigoureux, appelée au partage d'une nouvelle et meilleure destinée ainsi qu'il arriva aux Saxons de l'Angleterre, lorsque les Normands les eurent soumis ; la seconde, c'est qu'un peuple d'élite, un peuple souverain, armé, comme tel, d'une propension marquée à se mêler à un autre sang, se trouve désormais en contact intime avec une race dont l'infériorité n'est pas seulement démontrée par la défaite, mais encore par le défaut des qualités visibles chez les vainqueurs. Voilà donc, à dater précisément du jour où la conquête est accomplie et où la fusion commence, une modification sensible dans la constitution du sang des maîtres. Si la nouveauté devait s'arrêter là, on se trouverait, au bout d'un laps de temps d'autant plus considérable que les nations superposées auraient été originairement plus nombreuses, avoir en face une race nouvelle, moins puissante, à coup sûr, que le meilleur de ses ancêtres, forte encore cependant, et faisant preuve de qualités spéciales résultant du mélange même et inconnues aux deux familles génératrices. Mais il n'en va pas ainsi d'ordinaire, et l'alliage n'est pas longtemps borné à la double race nationale seulement.
« L'empire que je viens d'imaginer est puissant : il agit sur ses voisins. Je suppose de nouvelles conquêtes ; c'est encore un nouveau sang qui, chaque fois, vient se mêler au courant. Désormais, à mesure que la nation grandit, soit par les armes, soit par les traités, son caractère ethnique s'altère de plus en plus. Elle est riche, commerçante, civilisée ; les besoins et les plaisirs des autres peuples trouvent chez elle, dans ses capitales, dans ses grandes villes, dans ses ports, d'amples satisfactions, et les mille attraits qu'elle possède fixent au milieu d'elle le séjour de nombreux étrangers. Peu de temps se passe, et une distinction de castes peut, à bon droit, succéder à la distinction primitive par nations. »
Mais les conquêtes sans fusion ne modifient nullement le peuple conquis et Gobineau avec un siècle d'avance sur l'événement avait bel et bien prévu que l'Inde reprendrait « la plénitude de sa personnalité politique ». D'où cette loi ainsi exprimée :
« Le hasard des conquêtes ne saurait trancher la vie d'un peuple. Tout au plus, il en suspend pour un temps les manifestations, et en quelque sorte, les honneurs extérieurs. Tant que le sang de ce peuple et ses institutions conservent encore, dans une mesure - suffisante, l'empreinte de la race initiatrice, ce peuple existe ; et, soit qu'il ait affaire, comme les Chinois, à des conquérants qui ne sont que matériellement plus énergiques que lui ; soit, comme les Hindous, qu'il soutienne une lutte de patience, bien autrement ardue, contre une nation en tous points supérieure, telle qu'on voit les Anglais, son avenir certain doit le consoler ; il sera libre un jour. Au contraire, ce peuple, comme les Grecs, comme les Romains du Bas-Empire, a-t-il absolument épuisé son principe ethnique et les conséquences qui en découlaient, le moment de sa défaite sera celui de sa mort : il a usé les temps que le ciel lui avait d'avance concédés, car il a complètement changé de race, donc de nature, et par conséquent il est dégénéré. »
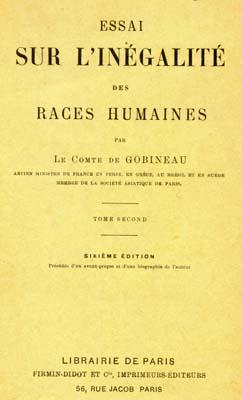
Le siècle de Gobineau n'avait pas manqué d'expliquer les différences ethniques par les conditions du climat à quoi il rétorque :
« Malgré le vent, la pluie, le froid, le chaud, la stérilité, la plantureuse abondance, partout le monde a vu fleurir tour à tour, et sur les mêmes sols, la barbarie et la civilisation. Le fellah abruti se calcine au même soleil qui brûlait le puissant prêtre de Memphis ; le savant professeur de Berlin enseigne sous le même ciel inclément qui vit jadis les misères du sauvage finnois. »
Les inégalités ethniques ne sont pas, par ailleurs, le fait des institutions et l'on peut dire, au contraire, que les institutions d'un peuple sont toujours une création de sa race, même lorsqu'elles leur sont imposées.
La persistance des mœurs sauvages en Armorique, « au 17e les massacres de naufragés et l'exercice du droit de bris subsistaient dans toutes les paroisses maritimes où le sang kymrique s'était conservé pur ».
Les colonisations contemporaines, en Orient, en Afrique du Nord, montrent assez que « les nations les plus éclairées ne parviennent pas à donner à des peuples conquis les institutions antipathiques à leur nature. »
Si la civilisation n'est pas commandée par la nature du sol, du climat, Gobineau constate aussi que le Christianisme, par essence, puisqu'il est œcuménique, ne saurait constituer une civilisation, à l'opposé du judaïsme et du paganisme dont les dieux étaient propres à chaque peuple.
« Depuis dix-huit cents ans qu'existé l'Eglise, elle a converti bien des nations, et chez toutes elle a laissé régner, sans l'attaquer jamais, l'état politique qu'elle avait trouvé. Son début, vis-à-vis du monde antique, fut de protester qu'elle ne voulait toucher en rien à la forme extérieure de la société. On lui a même reproché, à l'occasion, un excès de tolérance à cet égard. J'en veux pour preuve l'affaire des jésuites dans la question des cérémonies chinoises. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'elle ait jamais fourni au monde un type unique de civilisation auquel elle ait prétendu que ses croyants dussent se rattacher. Elle s'accommode de tout, même de la hutte la plus grossière, et là où il se rencontre un sauvage assez stupide pour ne pas vouloir comprendre l'utilité d'un abri, il se trouve également un missionnaire assez dévoué pour s'asseoir à côté de lui sur la roche dure, et ne penser qu'à faire pénétrer dans son âme les notions essentielles du salut. Le christianisme n'est donc pas civilisateur comme nous l'entendons d'ordinaire ; il peut donc être adopté par les races les plus diverses sans heurter leurs aptitudes spéciales, ni leur demander rien qui dépasse la limite de leurs facultés.
Je viens de dire plus haut qu'il élevait l'âme par la sublimité de ses dogmes, et qu'il agrandissait l'esprit par leur subtilité. Oui, dans la mesure où l'âme et l'esprit auxquels il s'adresse sont susceptibles de s'élever et de s'agrandir. Sa mission n'est pas de répandre le don du génie ni de fournir des idées à qui en manque. Ni le génie ni les idées ne sont nécessaires pour le salut. Le christianisme a déclaré, au contraire, qu'il préférait aux forts les petits et les humbles. »
La constatation de l'inégalité des races n'empêche nullement d'ailleurs Gobineau de reconnaître une différence absolue entre « la plus grossière variété, le sous-genre le plus misérable de notre espèce » et certaines espèces de singes.
Mais, d'autre part, les aptitudes que peuvent montrer certains noirs, à l'école des blancs, ne prouvent rien d'autre qu'une disposition plus ou moins grande à l'imitation.
« L'imitation n'indique pas nécessairement une rupture sérieuse avec les tendances héréditaires, et l'on n'est vraiment entré dans le sein d'une civilisation que lorsqu'on se trouve en état d'y progresser soi-même, par soi-même et sans guide. »
En fait il constate que les états de civilisations proprement originales ne sont pas comparables. Un siècle après Gobineau l'accélération de l'histoire ne confirme-t-elle pas le propos ?
Mais si, jusqu'à présent, au tiers de son introduction le mot Civilisation a été souvent employé, il n'a pas encore été explicité dans l'acception que lui donne son auteur. Négligeons la discussion ouverte avec Guizot qui la tenait pour un « fait », alors que Gobineau nous dit qu'il s'agit bien « d'une série d’enchaînement de faits » d'où résultent « un état », « un milieu » dont il précisera les caractères, en distinguant soigneusement, comme le fait Guillaume de Humbolt que Gobineau prisait fort, les particularités de cet état et le perfectionnement de grandes .individualités, « Différence telle que les civilisations étrangères à la nôtre ont pu, de toute évidence, posséder des hommes très supérieurs sur certains rapports à ceux que nous admirons le plus : la civilisation brahmanique, par exemple. »
Tribus, peuplades, peuples, civilisations elles-mêmes, se trouveront finalement classés en deux catégories selon qu'ils sont plus ou moins aptes à l'action ou à la contemplation, les types les plus représentatifs de ces deux civilisations étant à ses yeux la civilisation chinoise (ancienne) pour l'action et la civilisation hindoue pour la contemplation, qu'il désignera encore en civilisation mâle et civilisation femelle, les deux types étant évidemment toujours mêlés plus ou moins. L'endocrinologie moderne n'a-t-elle pas montré que les éléments masculins et féminins coexistaient aussi dans les deux sexes.
Gobineau tempère d'ailleurs la rigueur de sa doctrine :
« On remarquera, en outre, qu'aux différentes époques de la vie d'un peuple et dans une stricte dépendance avec les inévitables mélanges du sang, l'oscillation devient plus forte entre les deux principes, et il arrive que l'un l'emporte alternativement sur l'autre. Les faits qui résultent de cette mobilité sont, très importants, et modifient d'une manière sensible le caractère d'une civilisation en agissant sur sa stabilité. »
Et les civilisations naissent de l'accord entre les régimes politiques et sociaux et la nature des peuples, elles se transforment :
« Avec les mélanges de sang, viennent les modifications dans les idées nationales ; avec ces modifications, un malaise qui exige des changements corrélatifs dans l'édifice. Quelquefois ces changements amènent des progrès véritables, et surtout à l'aurore des sociétés où le principe constitutif est, en généra!, absolu, rigoureux, par suite de la prédominance trop complète d'une seule race. Ensuite, quand les variations se multiplient au gré de multiples hétérogènes et sans convictions communes, l'intérêt général n'a plus toujours à s'applaudir des transformations. Toutefois, aussi longtemps que le groupe aggloméré subsiste sous la direction des impressions premières, il ne cesse pas de poursuivre, à travers l'idée du mieux-être qui l'emporte, une chimère de stabilité. »
La civilisation quelle qu'elle soit sera finalement : « un état de stabilité relative, où des multitudes s'efforcent de chercher pacifiquement la satisfaction de leurs besoins, et raffinent leur intelligence et leurs mœurs. » La plus haute civilisation contemplative sera pour Gobineau l'Hindoue et du type actif la chinoise.
Quant à l'Europe :
« Les vainqueurs du Ve siècle apportèrent en Europe un esprit de la même catégorie que celle de l'esprit chinois, mais bien autrement doué. On le vit armé, dans une plus grande mesure, de facultés féminines. Il réalisa un plus heureux accord des deux mobiles. Partout où domina cette branche de peuples, les tendances utilitaires, ennoblies, sont méconnaissables. En Angleterre, dans l'Amérique du Nord, en Hollande, en Hanovre, ces dispositions dominent les autres instincts nationaux. Il en est de même en Belgique, et encore dans le nord de la France, où tout ce qui est d'application positive a constamment trouvé des facilités merveilleuses à se faire comprendre. A mesure qu'on avance vers le sud, ces prédispositions s'affaiblissent. Ce n'est pas à l'action plus vive du soleil qu'il faut l'attribuer, car certes les Catalans, les Pièmontais habitent des régions plus chaudes que les Provençaux et les habitants du bas Languedoc ; c'est à l'influence du sang. »
« La série des races féminines ou féminisées tient la plus grande place sur le globe ; cette observation s'applique à l'Europe en particulier. Qu'on en excepte la famille teutonique et une partie des Slaves, on ne trouve, dans notre partie du monde, que des groupes faiblement pourvus du sens utilitaire, et qui, ayant déjà Joué leur rôle dans les époques antérieures, ne pourraient plus le recommencer. Les masses, nuancées dans leurs variétés, présentent, du Gaulois au Celtibérien, du Celtibérien au mélange sans nom des nations italiennes et romanes, une échelle descendante non pas quant à toutes les aptitudes mâles, du moins quant aux principales. »
D'autre part, la civilisation n'atteint qu'une minorité dans chaque peuple. En France, il admettait que 10 millions sur 36 y participaient et que ces 26 millions, la paysannerie dans son ensemble, y sont hostiles.
Est-elle supérieure à celles qui ont précédée ? Oui et non, répondra l'auteur. Oui, parce qu'issue de l’élément germanique, elle n'a pas détruit et s'est approprié à peu près tout, non, car précisément elle n'excelle en rien. Ni dans les arts, ni dans le raffinement des mœurs ; dans notre passé même : « ce qu'on appelle bien-être n'appartenait comparativement qu'à peu de monde. Je le crois : mais, s'il faut admettre, fait incontestable, Que l'élégance des mœurs élève autant l'esprit des multitudes spectatrices qu'elle ennoblit inexistence des individus favorisés, et qu'elle répand sur tout le pays dans lequel elle s'exerce un vernis de grandeur et de beauté, devenue le patrimoine commun, notre civilisation, essentiellement mesquine dans ses manifestations extérieures, n'est pas comparable à ses rivales ».
Après avoir ainsi constaté, avec modestie, on le voit, la supériorité de la civilisation blanche, Gobineau va faire l'inventaire, avec les moyens de son temps, des caractères propres à chaque race et il est évident que l'anthropologie moderne et l'ethnologie ont cheminé depuis, il reviendra aux constatations d'évidence, à la permanence des traits raciaux, quelles que soient les transplantations, à l'exclusion de tout croisement, et l'anarchie ethnique d'une bonne part de l'Europe, dans les grandes villes et dans les ports, l'inégalité intellectuelle des races, exception faite encore des individualités, pour porter finalement jugement sur notre civilisation :
« Attendons pour nous vanter, que nos pays, qui depuis le commencement de la civilisation moderne ne sont pas encore restés cinquante ans sans massacres, puissent se glorifier, comme l'Italie romaine, de deux siècles de paix, qui n'ont d'ailleurs, hélas ! rien prouvé pour l'avenir !
« La perfectibilité humaine n'est donc pas démontrée par l'état de notre civilisation. L'homme a pu apprendre certaines choses, il en a oublié beaucoup d'autres. Il n'a pas ajouté un sens à ses sens, un membre à ses membres, une faculté à son âme. Il n'a fait que tourner d'un autre côté du cercle qui lui est dévolu, et la comparaison de ses destinées à celles de nombreuses familles d'oiseaux et d'insectes n'est pas même propre à inspirer toujours des pensées bien consolantes sur son bonheur d'ici-bas. »
Le comte de Gobineau était certes un pessimiste, mais un siècle après lui il faut bien constater que les problèmes qu'il citait — notamment celui de la faim — sont encore posés aujourd'hui et que si les progrès dans les domaines de la science sont patents, il n'avait pas tort de douter du pouvoir civilisateur de l'Imprimerie et pouvons-nous lui reprocher de dire que c'est bien à tort que toutes les civilisations qui nous ont précédés ont cru à leur immortalité ?
Au demeurant ses conclusions sont sans complaisance et d'une rare objectivité :
« A la multitude de toutes ces races métisses si bigarrées qui composent désormais l'humanité entière, il n'y a pas à assigner d'autres bornes que la possibilité effrayante de combinaisons des nombres. »
C'est sans doute à partir de cette constatation qu'on put prétendre d'abord arrêter le processus de décadence, ensuite restaurer de belles races.
Y parviendra-t-on ? A terme nous sommes évidemment condamnés, mais quand on se contente, comme Gobineau, de vivre dans l'Histoire, quelques millénaires de plus ou de moins ne sont pas rien !
Si l'on veut en tout cas éviter de dire trop de sottises en parlant d'un si brûlant problème que le racisme — et qu'il est urgent de résoudre humainement — il convient de lire ce livre.
J.M. AYMOT
Note :
(1) Odyssée XV.
Sources : Introduction à « l'Essai sur l'Inégalité des Races humaines » Poche-Club.

