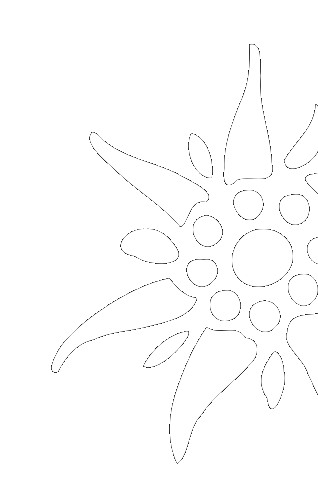Le 17 avril 1975, Phnom Penh tombait aux mains des Khmers rouges. Cinquante ans plus tard, le souvenir du génocide cambodgien orchestré par Pol Pot s’estompe dans le brouillard d’un oubli savamment entretenu par ceux-là mêmes qui, à l’époque, saluaient cette “libération” comme une victoire du peuple. Un demi-siècle plus tard, il est temps de rappeler les faits, et les responsabilités.
Ce jour-là, vêtus de noir, une écharpe rouge autour du cou, les soldats du Kampuchea démocratique entrent dans Phnom Penh. Derrière leurs sourires de façade, c’est la terreur qui s’installe. En quelques heures, la ville est vidée de ses deux millions d’habitants : femmes, enfants, vieillards, malades, tous contraints de marcher vers des campagnes transformées en camps de rééducation. Ceux qui portent des lunettes, possèdent un livre ou enseignent sont exécutés. Les autres seront affamés, battus, utilisés jusqu’à l’épuisement. Le Cambodge, à l’image de la Chine maoïste, devient un immense goulag rural, où toute trace d’individualité doit disparaître.
Le prix du communisme : deux millions de morts
De 1975 à 1979, entre 1,5 et 2 millions de Cambodgiens sont massacrés dans l’indifférence générale. Soit plus de 20 % de la population du pays. Un peuple entier anéanti par un régime idéologique inspiré par la Révolution culturelle chinoise, formé dans les universités françaises, et soutenu bruyamment par les élites intellectuelles de la gauche progressiste.
La presse française complice
En France, cette prise de pouvoir fut saluée comme une page glorieuse tournée sur le passé colonial. Le Monde se réjouit d’une « ville libérée dans l’enthousiasme populaire », Libération titra « Sept jours de fête pour la libération », et L’Humanité dénonça plus tard les premiers témoignages de massacres comme de la « désinformation ». Pire encore, lorsque des centaines de Cambodgiens tentent de se réfugier à l’ambassade de France à Phnom Penh, Paris cède sous la pression idéologique et les livre à la mort.
Ce fut une redite sinistre des trahisons de Dien Bien Phu en 1954 ou des harkis en 1962. À chaque fois, une même logique : sacrifier des innocents sur l’autel du progressisme révolutionnaire.
Aujourd’hui, rares sont les voix qui rappellent la réalité du régime de Pol Pot. Rares sont les journaux qui reconnaissent leur aveuglement complice. Seule Marine Le Pen, dans un sobre message, a rendu hommage aux victimes. À gauche, le silence est pesant. Pas de repentance, pas de remise en question. L’amnésie est sélective.
Pourtant, ce crime de masse fut encouragé, idéologiquement justifié, et nié pendant des années par ceux qui prétendent aujourd’hui incarner la morale, la justice et l’humanisme.
Un devoir de mémoire à contre-courant
Alors que le mot « fascisme » est galvaudé quotidiennement pour disqualifier l’adversaire politique, il serait temps de rappeler que les régimes communistes – de l’URSS à la Chine, de Cuba au Cambodge – sont responsables de plus de cent millions de morts. Ce chiffre, lui, n’est jamais affiché dans les manuels scolaires.
Commémorer la chute de Phnom Penh et le début de l’enfer khmer rouge, c’est rappeler que la barbarie ne porte pas toujours l’uniforme brun. Parfois, elle avance en costume noir, brandissant le petit livre rouge.
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
Source : Breizh-info.com - 18/04/2025