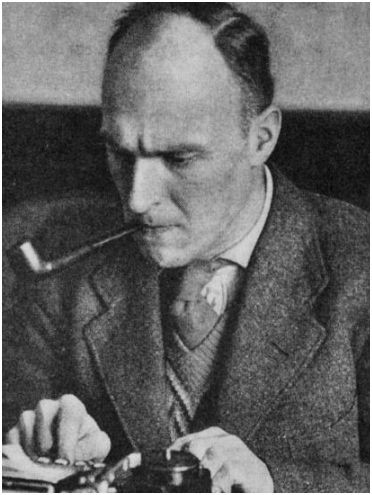
Une très belle maison à Elbdeich (Stöckte), entre le Schleswig et Hambourg : une barrière de bois, deux grands bâtiments au toit de chaume, un jardin, des arbres. Blanc, brun, vert. L'écrivain Ernst von Salomon y est mort le 9 août. La veille, il s'inquiétait d'un orage dont il n'aura jamais vu la fin.
« Ce n'est jamais d'agir qui déshonore, c'est de subir». Walter Rathenau a écrit cela dans ses « Réflexions». Ernst von Salomon et ses amis ne voulaient pas subir. Ils ont tué Walter Rathenau. L'œuvre de von Salomon, c'est l'histoire de sa vie, et l'Histoire de l'Allemagne. L'une se confond avec l'autre. On ne peut les évoquer séparément. Cela commence aux lendemains de la Grande Guerre.
29 octobre 1918. Allemagne du Nord. La 3e escadre de la Flotte impériale, entrée à Kiel, a adopté une attitude insurrectionnelle. Les équipages ont formulé des revendications révolutionnaires et menacé d'abattre des officiers. Rapidement, les insurgés se sont emparés de la ville. Puis le mouvement a gagné les vieilles cités de la Hanse : Hambourg « la rouge», Lubeck, Wilhelmshafen, Brème. Et enfin, Berlin. Guillaume II abdique le 9 novembre. Le jour même, le social-démocrate Scheidemann proclame la République. Quelques heures plus tard, le spartakiste Karl Liebknecht annonce la « République socialiste». Le 10, un Conseil des commissaires du peuple est élu à Berlin, par une Assemblée plénière d'ouvriers et de soldats.
Une vague d'antimilitarisme submerge le pays. Les officiers sont attaqués dans la rue. Von Salomon, qui porte fièrement l'uniforme, raconte aux premières pages des « Réprouvés» comment il fut roué de coups : «Je me vis soudain encerclé d'une quantité de gens, dont quelques femmes. Un homme, coiffé d'un chapeau melon, brandit son parapluie au-dessus de ma tête, un autre se mit à rire et beaucoup l'imitèrent, mais moi je ne pensais qu'à mes épaulettes. Tout dépendait de mes épaulettes : mon honneur (ridicule l de quelle importance pouvaient être des épaulettes!), tout dépendait de cela, et je saisis ma baïonnette. Alors le poing s'abattit sur ma figure». Il venait d'avoir seize ans.
Ernst von Salomon est né le 25 septembre 1902 à Kiel. Famille originaire de Venise et de France. Un Louis-Frédéric Cassian de Salomon participa au complot de Pichegru contre Napoléon. Père né en Angleterre, tué sur le front. Mère née en Russie. Prussiens par affinités : « Si je n'étais pas Prussien, je le serais devenu par élection» («Le questionnaire »).
D'abord élevé dans une institution de Karlsruhe, il entre très jeune à l'École des Cadets de l'Empereur. Un Prytanée prussien. Éducation inoubliable, dont il fera le récit dans « Les Cadets». La défaite de 1918 vient fracasser son univers. La nouvelle de la signature de l'armistice arrive à la figure du jeune Cadet comme une balle. Il jure de ne jamais s'en relever. C'est alors qu'il décide de rejoindre ces « réprouvés» (« die Geächteten »), ces proscrits des corps-francs que l'Allemagne vaincue hésite à regarder en face, parce qu'à l'heure de la défaite, ils veulent maintenir vivante l'idée de la patrie qui se bat.

Dans un ouvrage devenu classique, « Die deutsche Freikorps, 1918-23» (F. Bruckmann-Verlag, 1936), F.W von Oertzen explique que les corps-francs eurent une double origine, D'une part les troupes formées en 1918-19 pour lutter contre l'agitation bolchevique; d'autre part, celles qui furent ramenées, après la guerre, des pays baltes.
«En décembre 1918, rappelle M. Droz, professeur à la Sorbonne, l'Armée régulière, minée par la propagande spartakiste, a été incapable de reprendre Berlin, qui était entre les mains des révolutionnaires. Les troupes du général Lequis ont été contaminées. Le gouvernement, présidé par le nouveau chancelier Ebert, semble être leur prisonnier» (« Le nationalisme allemand de 1871 à 1939». CDU-SEDES, 1967).
Dans ces conditions, un accord secret est conclu avec l'état-major. L'Armée s'engage à soutenir le gouvernement socialiste, pour faire pièce aux «ultras» d'extrême-gauche.
Ernst von Salomon, au début des « Réprouvés », décrit la façon dont le général Maerker, appuyé par le ministre social-démocrate Noske, put rassembler dans une même formation des volontaires chargés de rétablir l'ordre et de défendre les frontières.
Les premiers corps-francs apparaissent en Westphalie. Fin 1919, ils regroupent plus de 300 000 hommes. Berlin est repris. Des soulèvements communistes sont réprimés en Saxe, en Thuringe et à Hambourg. Après l'assassinat de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, les spartakistes perdent le contrôle des Conseils ouvriers.
La République de Weimar s'installe dans un calme trompeur. C'est le temps des contrastes. « Tout suants et essoufflés par la marche, écrit von Salomon, nous percevions le son des mélopées nègres qui s'échappait des bars et des boîtes où l'on s'amuse; nous croisions des profiteurs et des grues ivres et tapageurs; nous voyions les bourgeois que nous étions chargés de protéger assis dans des cabarets chics, avec des filles qu'ils enlaçaient étroitement, devant des tables couvertes de bouteilles et de verres étincelants, ou bien exécutant sur le miroir d'un parquet des danses sensuelles et enivrantes. Et au loin, on entendait encore le bruit assourdi de quelque fusil de nos camarades».
Plus loin encore, il y a le Balticum. Les desperados de la patrie. Au lendemain de l'armistice, l'Allemagne avait été autorisée à se maintenir dans les pays baltes : les Alliés craignaient que les Russes ne s'en emparent. Le général von der Goltz eut alors l'idée de rattraper à l'Est ce que son pays avait perdu à l'Ouest, et de créer, avec l'appui des corps-francs, de vastes colonies à la fois agricoles et militaires, souvenir des chevaliers teutoniques. Les soldats démobilisés affluèrent bientôt. « La patrie, dit von Salomon, continuait à brûler sourdement en quelques cerveaux hardis».
Mais, en 1920, la France et l'Angleterre, ayant favorisé la constitution d'un gouvernement letton, croient pouvoir exiger que les corps-francs soient rapatriés. Décision on ne peut plus mal accueillie. Bon nombre d'officiers refusent d'obéir. D'autres reviennent en Allemagne, mécontents et aigris. En l'espace de quelques mois, la colère du jeune von Salomon et celle de ses amis se reporte sur cette République qu'ils ont sauvée du bolchevisme, et qui veut maintenant se débarrasser de ses alliés trop remuants.
— Je n'avais pas deviné, s'exclame le général von der Goltz, que je tenais un sabre brisé dans mes mains, et que mon pire ennemi serait mon peuple et mon gouvernement!»
A la répugnance pour l'humanisme et les institutions bourgeoises s'ajoutent l'amertume, le goût de la guerre et la nostalgie de l'action : « La guerre les tenait, la guerre les dominait, la guerre ne les laisserait jamais échapper. Ils auront toujours la guerre dans le sang, la mort toute proche, l’horreur, l’ivresse et le fer ».
Et encore, pour dire que la chasse vaut plus que la proie, von Salomon écrit : « Ce que nous voulions, nous ne le savions pas, et ce que nous savions, nous ne le voulions pas. Pourtant, nous étions heureux dans la confusion, car nous avions la sensation de ne faire qu’un avec notre temps » (Les réprouvés).
L’idéologie ne compte guère : « Agir, agir n'importe comment, tête baissée, se révolter par principe, tendre ses énergies par tous les moyens, avec toutes les audaces : le sang ne coule jamais en vain ».
Plus tard, le héros de «La ville» prononcera une parole décisive :
— Peu importe ce qu'on pense. Ce qui compte, c'est la manière de le penser.»
Comme dans toutes les affaires de « soldats perdus», cela aboutit à un putsch.
En mars 1920, le putsch Kapp-Lütwitz correspond au point culminant de l'action des corps-francs. Les Alliés avaient demandé la dissolution de la brigade Ehrhardt. Ce corps, qui avait joué un rôle important, apparaissait comme un centre d'agitation nationaliste.
Son chef, le capitaine Ehrhardt, jouissait lui-même d’une grande popularité. Et ses hommes s’étaient donnés un chant de rage et de colère : « Hakenkreuz am Stahlhelm ». Menacée dans son existence, la brigade entend bien réagir. Le 12 mars, les corps-francs s’emparent de Berlin. Le chancelier Ebert est obligé de quitter la ville. Deux officiers, Kapp et von Lütwitz, essaient de faire « basculer » la Reichswehr. Mais les cadres de l'Armée hésitent. Bientôt, la situation se dégrade. Une grève générale, paralysant la capitale, met un terme à l'entreprise.
Ernst von Salomon a participé au putsch. Il décrit le dégoût qu'éprouvent ses compagnons pour toute activité politique « légaliste ». Pour éliminer les traîtres à la patrie (« Vaterlands-verräter»), décrète-t-il, il n'y a plus que les moyens radicaux. Réduits au « chômage», certains activistes s'intègrent à la petite Armée de 100000 hommes que les Alliés ont autorisé à l'Allemagne. D'autres entrent dans les«Einwohnerswehren», auxiliaires de la Reichswehr, qui constituent une sorte de police locale, officiellement dissoute au 1er janvier 1921. Le plus grand nombre d'entre eux se retrouvent au sein d'associations d'anciens combattants, de clubs de tir, de sociétés sportives ou culturelles.
Dans un climat que l'on imagine à peine aujourd'hui, on voit apparaître une multitude de petits partis et de mouvements, clandestins ou non : Wiking-bund, Bund des amis de l'Edda, Bund de Franconie, Bund Arminius, Wandervogel aryen, etc.
Von Salomon adhère à quelque dix-huit de ces associations. En août 1920, plusieurs sociétés secrètes bavaroises fusionnent, et constituent l'Organisation Escherich, dite communément Orgesch. On y retrouve des anciens du Stahlhelm (« Casque d'acier»), de l'Oberland Korps, des jungdeutscher Orden, etc.
Peu après, apparaît l'Organisation Consul (OC), implantée un peu partout par l'officier de marine Ehrhardt, et qu'animé clandestinement le chef de la police de Munich, Pöhner. Son mot d'ordre : «Pas de négociations, on tire»!
« L'image que l'on se faisait de l'OC, écrit von Salomon, eut pour résultat que l’on crut voir sa main partout. Mais ce qui était étrange et inquiétant à la fois, c'était qu'à l'indignation bruyante, il se mêlait trop souvent une joie secrète, et que l'angoisse apeurée s'accompagnait d'une satisfaction perverse. Il y eut des instants où, même dans le cœur du petit fonctionnaire le plus modeste et le plus loyal, les rumeurs fantastiques qui couraient sur l'OC faisaient monter l'enthousiasme aussi vite que montait la mousse au col de la chope de bière.»
En 1921, les corps-francs se battent en Haute-Silésie. En 1923, ils animent le mouvement de résistance à l'occupation de la Ruhr, dont Léo Schlageter devient le symbole.
Schlageter, comme von Salomon, a participé au putsch Kapp et à la guerre de Silésie. Membre du corps Havenstein, il a aussi adhéré au NSDAP (National-Sozialistische Deutsche Arbeits-Partei), dès 1922. En mars 1923, il fait sauter un pont de chemin de fer près de Calkum, paralysant ainsi le trafic organisé par les occupants. Arrêté par les Français, il est fusillé, après un jugement sommaire, le 26 mai, près de Düsseldorf. A l'âge de vingt-huit ans. Ses compagnons sont envoyés à l'île Saint-Martin-de-Ré, avant d'être déportés à Cayenne. Dix ans plus tard. Schlageter sera déclaré héros national. Des dizaines de monuments à sa mémoire s'élèveront dans toute l'Allemagne.
Parallèlement, les corps-francs créent des tribunaux secrets. Ils s'inspirent, dit von Salomon, de la Sainte-Vehme, cette mystérieuse institution née au XIIe siècle en Westphalie, lorsque s'émiettait le Saint-Empire romain germanique.
De 1919 à 1922, on dénombre quelque 354 attentats politiques. Le 26 janvier 1920, Matthias Erzberger, ministre des Finances, chef du Centrum (catholique), et qui ne cesse de réclamer la stricte application des clauses du traité de Versailles, est grièvement blessé. Le 26 août 1921, il est abattu par deux membres de ('«Organisation Consul», les lieutenants de marine Heinrich Tillessen et Heinrich Schulz. Arrêtés, les « réprouvés» revendiquent leur acte avec fierté.
Puis c'est l'affaire Rathenau, qui va marquer von Salomon pour la vie. Le 24 juin 1922, Walter Rathenau, ministre des Affaires étrangères dans le second cabinet Wirth, sort en voiture de sa villa de Grünewald, près de Berlin. Une autre voiture le rattrape. Les lieutenants de marine Kern et Fischer tirent plusieurs coups de revolver et lancent une grenade. Rathenau est tué sur le coup.
Rathenau n'était pourtant pas un homme de gauche. Le germaniste Edmond Vermeil le classe parmi les doctrinaires de la révolution nationale allemande, aux côtés de Thomas Mann et Keyserling.
Mais cet humaniste à multiples facettes, adepte à la fois de Bergson et de Nietzsche, rêvait d'un « royaume de l'âme», où l'homme mécanisé, le « Zweckmensch» (l'homme qui ne poursuit que des fins extérieures à sa propre vie), serait ramené à sa place; il subordonnait la « démocratie vraie» à l'instauration du « Volksstaat» (l'État adapté à la vie substantielle du peuple). Il était trop subtil pour son temps. Pour les nationalistes de l'entre-deux guerres, Rathenau était le symbole de la défaite, et (surtout) de son acceptation : il était le signataire de l'accord germano-soviétique passé à Rapallo.
Aussitôt après l'attentat, Kern et Fischer sont traqués par la police. On offre un million, puis quatre millions et demi de marks pour leur capture. Ils sont finalement cernés dans un château appartenant à l'écrivain Hans Stem. L'un est tué, l'autre se suicide : « Fischer s'assit sur le second lit, leva son pistolet, l'appuya sur sa tempe, à l'endroit où Kern avait été atteint, et pressa la détente».
Ernst von Salomon avait fourni la voiture avec laquelle les deux officiers ont agi. Après le meurtre, il est allé en vain à la recherche de ses compagnons, afin de leur procurer un passeport. Recherché, arrêté à son tour, il est condamné à cinq ans de réclusion pour sa « participation active», puis à trois ans de prison pour coups et blessures. Il ne sera amnistié et libéré qu'en 1928.
Au bout de trois années passées au « secret», il est autorisé à avoir un livre. Il demande « Le rouge et le noir», de Stendhal. Et il écrit « Les réprouvés».

Dès leur publication, en 1928, chez Rowohlt, « Les réprouvés» exercent sur le monde intellectuel de l'époque une véritable fascination. Bien avant de lire Malraux, des militants politiques de tous bords y découvrent l'éternel romantisme de l'action. Et Drieu la Rochelle, dans ses « Notes pour comprendre le siècle», ne manquera pas d'évoquer « le combattant de la Grande Guerre formé dans les « Sturmtruppen » ou l'aviation, devenu l'acharné des corps-francs, le terroriste assassin de Rathenau, le boy-scout, le « Wandervogel» errant de Maison de jeunesse en Maison de jeunesse, jusqu'à l'autre bout de l'Europe, vers le salut inconnu».
Aux alentours des années soixante, les soldats de l'Algérie française, les militants et les putschistes, réprouvés et abandonnés eux aussi, reliront avec passion ces pages où se profilent les visages fraternels des grands activistes du passé :« Nous étions fous. Et nous savions que nous l'étions. Nous savions que nous serions abattus par la colère de tous les peuples qui s'agitaient autour de notre cohorte téméraire. Mais si jamais une folie eut une méthode, ce fut bien la nôtre. Nous ne voulions pas nous résigner à une époque où le renoncement était la devise du jour. Nous disions non à l'Allemagne de ce temps, parce que nous avions déjà sur le bout de la langue le oui pour celle qui venait. Ainsi notre folie n'était qu'orgueilleuse obstination. Nous étions prêts à supporter les conséquences de cette obstination. Un homme ne peut faire plus».
Pendant un demi-siècle, von Salomon a vécu dans l'ombre de Rathenau. Quelques semaines avant sa mort, à l'occasion du cinquantenaire de l'attentat, les stations de radio lui posaient encore les mêmes questions.
Ernst Jünger, de sa voix un peu traînante, avait été le premier à lui demander :
— Pourquoi n'avez-vous pas eu le courage de dire que Ratheneau fut tué parce qu'il était Juif ?»
Von Salomon a répondu comme il l'a toujours fait :
— Parce que ce n'était pas vrai».
A peine sorti de prison, von Salomon reprend contact avec ses compagnons. Il devient employé d'assurances, agent de change « volant».
En 1932, il vient en France. Il reste seize mois au pays basque. Voyages à Lourdes, à Saint-Jean-de-Luz. Entretiens avec Claude Farrère. En résulte une nouvelle pleine d'ironie, intitulée « Boche in Frankreich», qui sera plus tard annexée au texte du « Questionnaire ».
« Tous les Français qui m'entendent parler français se mettent à sourire, y écrit-il. Je parle avec l'accent du Midi. Je parle donc à peu près français comme mon ami le commissaire de police de Saint-Jean-de-Luz, qui a passé quatre ans dans un camp de prisonniers de guerre près de Dresde, parle allemand. Je jure que je n'abuserai jamais de mes connaissances de la langue française dans le but d'entendre grincer sous mes bottes la sainte terre de France!»
La République de Weimar est à bout de souffle. A Berlin, les cabarets sont toujours pleins. Mais il y a six millions de chômeurs. Une société s'effondre. Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler devient chancelier.
Beaucoup d'anciens corps-francs se retrouvent au Parti national-socialiste : dès 1920, la Ligue pour la défense et l'attaque (Schutz- und Trutzbund) jetait une sorte de « pont» entre le Freikorps (les corps-francs) et le NSDAP, et prenait bientôt une telle importance qu'un livre entier, depuis, a pu lui être consacré (Uwe Lohalm : «Volkischer Radika-limus». Leibniz-Verlag, 1970). L'unanimité est loin d'être la règle. Le niveau de conscience politique des « réprouvés» est souvent des plus bas. D'autre part, il faut compter avec ceux que le Dr Armin Mohler («Diekonservative Révolution») a appelé «les trotskystes du national-socialisme ».
En bon Allemand du Nord, Ernst von Salomon n'est pas très enthousiasmé par les « buveurs de bière». Les « cathédrales de lumière» de Nuremberg retiennent son attention, mais sans le faire vibrer.
A l'instar d'Ernst Jünger et des adeptes du «socialisme prussien», il préfère garder ses distances vis-à-vis d'un mouvement qui lui paraît trop plébéien, et de surcroît marqué par ses origines « méridionales» bavaroises.
Plus qu'un nationalisme révolutionnaire, il professe un aristocratisme rigide : «Je considérais, dira-t-il par la suite, comme trahison infâme du véritable but, la tentative de Hitler de déplacer l'accent décisif de l'État au peuple, de l'autorité à la totalité».
Son frère, Bruno von Salomon, est allé beaucoup plus loin. Après avoir participé au lancement du journal « Der Aufbruch», il adhéra au parti communiste, dans les dernières années de la République. Son état d'esprit correspondait à celui d'un certain nombre d'intellectuels allemands qui, vers 1930, rompirent violemment avec la bourgeoisie.
Estimant qu'une guerre de revanche à l'Ouest ne pouvait être menée qu'avec l'appui de l'Union soviétique, ils se tournèrent soit vers les groupes nationaux-bolcheviques (Ernst Niekish, Karl-Otto Paetel), soit vers la « gauche nazie» de Strasser, soit vers le PC.
En dépit des offres qu'il reçoit, von Salomon refuse de «jouer un rôle» sous le IIIe Reich. Il préfère être lecteur de manuscrits chez l'éditeur Rowohlt, puis scénariste.
A la Chambre des écrivains, présidée par l'ancien expressionniste Hans Johst, il ne fréquente guère que Blunck, Ernst Wiechert, Agnes Miegel, Hans Carossa, Jünger, Kolbenheyer, et surtout Hans Grimm, l'auteur de «Volk ohne Raum» (Peuple sans espace). Quelques-uns de ses textes («Die Front kehrt heim», «Putsch», «Die Verschwôrer») sont alors réédités, notamment aux éd. Moritz-Diesterweg, par Rudolf Ibel et Walter Machleidt.
Le 8 septembre 1935, Pierre Drieu la Rochelle est à Berlin. Il écrit à une amie : « Hier au soir, j'ai passé la soirée avec l'écrivain allemand que j'aime le plus : Ernst von Salomon, qui a été des années en prison pour avoir participé au meurtre de Rathenau. Il m'a parlé avec beaucoup de franchise et de force. C'est beau de voir un homme au-dessus des événements. Il a tout fait pour créer ce régime et il refuse les honneurs : un vrai aristocrate. Nous nous sommes merveilleusement entendus». Trente ans plus tard, le national-socialisme restait chez von Salomon un souvenir indécis. Peu avant sa mort, dans une conversation, il célébrait les mérites des Waffen-SS. Mais c'était pour ajouter :
— Ces hommes étaient des preux. Ils n'avaient donc rien de commun avec le nazisme ».
Dans «Le questionnaire», l'ancien Cadet de la Garde s'avoue incapable de se faire une opinion sur cet étrange « caporal autrichien» venu ramasser en vingt ans l'Histoire de vingt siècles : la lutte pour le pouvoir, l'Imperium, le crépuscule des dieux. Et de s'interroger sur ce « Führer venu de l'ombre», qui « ne trouvera jamais sa place dans l'Histoire». 1945. L'épuration. Ernst von Salomon est à nouveau arrêté. Par les Américains, cette fois. On l'accuse d'avoir appartenu au Volkssturm, où les «territoriaux» non mobilisables étaient enrôlés. Il est emprisonné. Par erreur. Puis relâché.
A cette époque, les Alliés n'ont pas créé moins de 262 commissions de dénazification. Afin d'établir les responsabilités exactes des sept millions d'adhérents du parti nazi, les Alliés font distribuer douze millions d'un imprimé comportant 125 questions détaillées. C'est le fameux «questionnaire». Y répondre donne droit à la carte d'alimentation et au permis de travail.
Von Salomon remplit le sien d'une façon inattendue. Il en fait la matière d'un gros livre interminable et disert. Il y retrace une fois de plus son passé, avec un détachement presque amusé, qui va scandaliser longtemps certains lecteurs. A sa mort, l'hebdomadaire Der Spiegel (600 000 exemplaires) dénoncera encore sa « raideur» et son insuffisante humilité.
Traduit en français en 1953, « Le questionnaire» connaît en Allemagne un succès foudroyant. 60 000 exemplaires partent en six mois. Pour quelques-uns, c'est, comme « La vingt-cinquième heure» de Virgil Gheorgiu, une libération.
Après « Le questionnaire», von Salomon publie « La ville», son seul véritable roman avec « La belle Wilhelmine».
Le livre s'ouvre, comme une fenêtre, sur les régions du Schleswig-Holstein situées au nord de l'Elbe. Dunes, digues, prairies enlevées à la mer. Paysage de polders, comme en Frise et aux Pays-Bas. Pays rural, où les hautes terres, le plateau (« Geest»), s'opposent aux « Marschen», « Ce sont les fermes qui dominent. Les bâtiments de briques avec leurs immenses toits de chaume, leurs petites fenêtres» et la porte qui tient presque toute la façade, s'élèvent au milieu des rectangles étroits des pâtures, séparés par des fossés de drainage. Sur leur terre grasse, l'herbe foisonne, tondue régulièrement par le bétail. Le plus souvent, l'étable et l'habitation sont réunies sous le même toit immense, et l'odeur chaude, pénétrante, des bêtes attachées envahit toute la maison ».
La toile de fond est historique. Sous la République de Weimar, la petite paysannerie, endettée, ne parvient plus à payer l'impôt. Le prix des produits industriels monte régulièrement, celui des produits agricoles ne cesse de baisser. Début 1929, la révolte gronde. Un groupe de paysans préconise la grève de l'impôt. Le meneur s'appelle Klaus Heim. C'est « un gros homme, fort comme un de ses bœufs, avec des poils blonds gris sur sa tête rouge carrée».
« — Que faire ? demandèrent les paysans à Klaus Heim, premier parmi les égaux. Et Heim répondit : — Aidez-vous vous-mêmes».
Les nationaux-socialistes profitèrent de la jacquerie pour s'implanter dans le Nord du pays. Von Salomon rappelle que ce ne fut pas sans heurts.
Le 7 mars 1 929, dans le petit village de Wöhrden, les communistes attaquent un cortège de « chemises brunes». Il y a deux morts et vingt-trois blessés. Six mille personnes assistent aux obsèques. Hitler est venu en personne, accompagné des chefs des SA et du Gauleiter Lohse. La semaine suivante, cinq cents paysans adhèrent au NSDAP. Aux élections de juillet 1932, le parti nazi recueille 76% des voix dans le sud du Schleswig, 95% dans le nord. Le héros de « La ville», Ive, a participé au mouvement de Klaus Heim. Il s'est ensuite rendu à Berlin, dans l'espoir de « renverser le monde des trottoirs». Mais sa quête est restée vaine. Il finit par se faire tuer par un policier, au cours d'une manifestation d'ouvriers. Un autre personnage du livre, Hinnerk, est à la fois national-socialiste et communiste. « II faut, dit-il, établir comme Loi suprême la seule Loi décente : la camaraderie». Et il ajoute : «Tu peux appeler cela socialisme ou nationalisme, je m'en fous royalement ! »
En 1960 paraît «Le destin de A.D. », récit véridique, affirme von Salomon. A.D. est né en 1901. Officier dans la Reichswehr, on l'a accusé à tort de sympathies communistes. Arrêté, emprisonné, il a fini par adhérer effectivement au PC. Mais à ce moment-là seulement. Les nazis l'ont fait transférer dans un camp de concentration. Mais, en 1945, ce sont les Américains qui le suspectent à leur tour. Et le voilà de nouveau condamné, incarcéré, libéré. Ainsi, toute sa vie, A.D. n'a cessé d'être jugé pour des actes qu'il n'avait pas commis. Il a vécu « dans l'ombre de l'Histoire», et n'y a pas résisté. Von Salomon raconte l'histoire de A.D. d'une manière impassible et glacée, qui ne rappelle en rien le style des « Réprouvés». C'est qu'avec le temps, il a lui-même appris à s'observer. « Nous croyons aux instants où toute une vie se trouve ramassée, nous croyons au bonheur d'une prompte décision» écrivait-il dans « Les réprouvés».
Considéré comme un homme d'action, von Salomon n'était qu'un « observateur passionnément engagé». C'est pourquoi A.D., qui n'a connu aucune des aventures auxquelles il a lui-même participé, lui ressemble finalement autant que le Garine des «Conquérants» peut ressembler à Malraux.
Sans cesse accusé lui aussi, et toujours à contre-temps, von Salomon ne semble avoir eu une vie exceptionnelle que parce que cette vie s'est confondue avec des événements qui, eux l'étaient. Venu trop tard ou venu trop tôt, il incarne parfaitement toutes les contradictions et les déchirements de la vieille Allemagne impériale. Son existence n'a été que le reflet d'une époque, et s'il a fait l'objet de tant de polémiques, c'est qu'on a voulu juger cette époque à travers lui»
Dans son « Portrait de l'aventurier» (Grasset, 1965), M. Roger Stéphane associait Ernst von Salomon à T.E. Lawrence et André Malraux. Il voyait en lui, avec Ernst Jünger, le plus grand des écrivains allemands encore vivants.
« Quiconque rencontre aujourd'hui A. D., lit-on à la fin du « Destin», ne se doutera certes pas qu'il a devant lui l'homme qui, pendant vingt-sept ans, a été la victime expiatoire des péchés de notre temps; un homme qui, au milieu des problèmes de notre « passé non surmonté», a parfaitement réussi à surmonter son passé à lui. Un homme d'un certain âge, discrètement vêtu de gris; dans l'oreille droite, un appareil de correction auditive en plastique, fixé sur la monture en corne de ses lunettes. II promène son chien, un chien de taille moyenne et de race indéfinissable, et il s'arrête patiemment avec lui à chaque coin de rue. »
1972. Ernst von Salomon avait, lui aussi, «surmonté son passé». C'était un homme de petite taille, légèrement corpulent. L'œil vivace, le foulard glissé dans la chemise. Il levait l'index, et disait en éclatant de rire : — Je suis un Allemand sans Allemagne, un Prussien sans Prusse, un monarchiste sans roi, un socialiste sans socialisme, et je serais aussi un démocrate s'il y avait une démocratie. La guerre, la révolution, le combat des idées : tout cela a rempli le siècle que j'ai connu, et je l'ai bu comme on boit un alcool».
Fabrice LAROCHE
Sources : Le Spectacle du Monde – Novembre 1972



