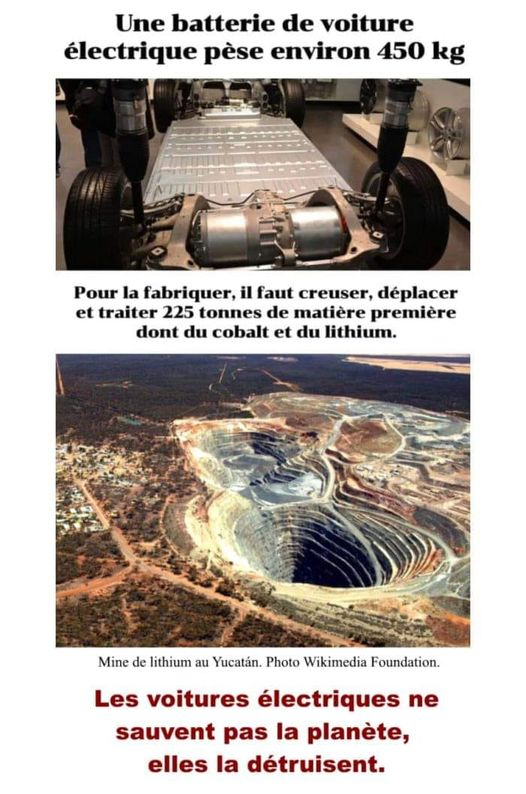Les véritables héritiers de Mai 68
- Détails
- Catégorie : SOCIETE

Mai 1968 est un jalon central dans la formation de notre monde. Un événement qui est souvent célébré comme le seuil d'une nouvelle ère: celle de l'individu libéré et pleinement émancipé. Un exploit progressiste associé à l'héritage sentimental et moral de la gauche. Mais pour être précis, c'est le néolibéralisme - plutôt que la gauche en tant que telle - qui est le véritable héritier de Mai 1968.
De l'État néolibéral à l'État justicialiste
- Détails
- Catégorie : ECONOMIE

« Dans l'état de justice, la vocation à former une communauté est fondamentale. Des liens sociaux stables ne peuvent être construits avec des individus égoïstes et matérialistes », affirme l'auteur.
« Nous ne sortirons pas de cette crise uniquement avec des plans macroéconomiques ou en ajustant le déficit fiscal. Cela va plus profondément, éthiquement, moralement, dans le sous-sol où se construit la société visible de notre époque. Nous devons chercher une issue et trouver comment faire de la Communauté organisée une réalité ».
Antonio Cafiero
Transnistrie, région séparatiste soutenue par la Russie. Pourquoi ?
- Détails
- Catégorie : GEOPOLITIQUE
L'Américanisme des gauches
- Détails
- Catégorie : COLLABOS ET RENEGATS

Considérant le fait que le jeune Marx définissait les États-Unis comme le « pays de l'émancipation politique accomplie », c'est-à-dire comme « l'exemple le plus parfait d'un État moderne », capable d'assurer la domination de la bourgeoisie sans exclure les autres classes de la jouissance des droits politiques, un spécialiste du marxisme a observé « qu'aux États-Unis, la discrimination par la censure prend une forme "raciale" » [1], de sorte que, selon lui, on ne peut manquer de remarquer « une certaine indulgence » [2] de Marx à l'égard du système américain, tandis que « l'attitude d'Engels est encore plus déséquilibrée dans un sens pro-américain » [3].
L'Économie de guerre : Le projet d'Emmanuel Macron avec Didier DARCET
- Détails
- Catégorie : ECONOMIE
Le 13 Juin dernier, en parlant des conséquences économiques considérables causées par l’invasion russe sur le territoire ukrainien, le président Macron déclare que la France est « entrée dans une économie de guerre dans laquelle […] nous allons durablement nous organiser ». Mais qu’est-ce qu’une économie de guerre ? Avec Didier Darcet, nous nous penchons sur les six grandes caractéristiques de l’économie de guerre et ce qu’elle implique pour les ménages et le marché.
Décrypter les étiquettes sur les fruits
- Détails
- Catégorie : Décryptage
Il faut aussi vérifier les agrumes.
De nombreux fruits sont piqués au début de leur développement à l'aide d'une seringue quand ils sont petits. On pique le fruit dans l'axe à l'endroit où se trouvait la fleur vers la queue, pour y injecter des produits chimiques (insecticides, hormones de croissance...).
C'est assez facile à voir, il y a une cicatrice au bas du fruit à l'endroit où le fruit a été piqué et le fruit se répare difficilement dans l'axe de la piqûre où on peut vor des mini-quartiers et des anomalies anatomiques.
Quand vous choisissez vos fruits, regardez le dessous du fruit (opposé de la tige), s'il y a un trou avec une petite cicatrice, c'est que l'orange, la mandarine ou le pamplemousse ont subi une injection. Les fruits qui n'ont pas subi d'injection ont la peau sans cicatrice.
- La farce du nouveau progressisme
- Ballades païennes en Velay par Georges FELTIN-TRACOL
- Mer du nord, le retour des oies sauvages
- Le pagano-christianisme en Suède au solstice
- Eugène KRAMPON a lu: LE MATIN DES PAYSANS de Jean-Claude MARTINEZ
- Rationnements, confinements, interdictions, les plans secrets des états pour gérer les pénuries
- La Grèce au lendemain de la guerre du Péloponnèse
- Le début de la 3e guerre mondiale ? - Michel Midi par Michel Collon
- Nouvelle configuration géopolitique avec Caroline Galacteros, David Baverez et Mériadec Raffray
- Et maintenant ? par Pierre Vial
Page 556 sur 878