
Forte de ses milliers de chars et d'avions, la plus puissante armée de tous les temps campe aux frontières de l'Europe occidentale. Soixante-trois ans après sa création, alors que la révolution de Lénine et de Trotski jetait les bases de l'État soviétique, l'Armée rouge pèse aujourd'hui de tout son poids sur les destins du monde. Force politique autant que militaire, porteuse du messianisme révolutionnaire qui a bouleversé l'histoire du XXe siècle, l'armée de Toukhatchevski et de Boudienny a fait de l'U.R.S.S. une superpuissance dont certaines nations redoutent les visées hégémoniques. Après plusieurs années de recherches sur cette question Dominique Venner publie aujourd'hui (1981), chez Plon, le premier tome d'une Histoire de l'Armée Rouge qui va de 1917 à 1924. Cet ouvrage propose de nombreuses vues originales et contient des témoignages généralement ignorés du public français. Une fois de plus, l'histoire contribue à éclairer l'actualité la plus immédiate, et c'est dans cet esprit qu'Histoire magazine a demandé à Dominique Venner de présenter à ses lecteurs les réflexions que lui a suggérées l'étude de cette armée d'une nature particulière.
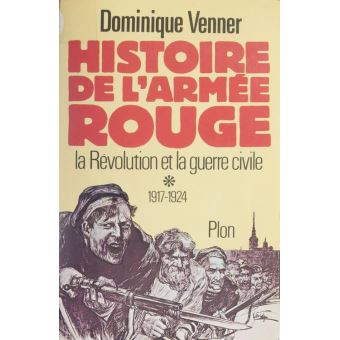
Histoire magazine : Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous intéresser plus particulièrement à l'histoire de l'Armée rouge ?
Dominique Venner : S'il existe un nombre considérable d'ouvrages traitant de la révolution d'Octobre, très peu d'auteurs ou d'historiens français, si l'on excepte Marina Grey et Jean Bourdier, se sont penchés sur l'étude de la guerre civile, qui fut pourtant essentielle pour la genèse de l'État soviétique né des émeutes d'Octobre. De nombreux témoignages, notamment ceux de Français qui furent les témoins de ces événements, ont été longtemps négligés. La naissance d'un ordre nouveau au sortir d'une époque de décomposition chaotique est un phénomène particulièrement intéressant à étudier et l'époque dite du « communisme de guerre » est à cet égard exemplaire. Je pense enfin que l'Histoire détermine largement le présent que nous vivons. L'Armée rouge représente aujourd'hui une puissance formidable, installée à quelques centaines de kilomètres de nos frontières.
Cela inquiète quelque peu, surtout depuis quatre ou cinq ans. On se rend compte que les espoirs de « détente » n'étaient pas compris de la même manière de part et d'autre du rideau de fer. Pour évaluer la menace et mesurer ce qu'elle représente, il faut savoir tirer les leçons de l'Histoire.
Alors que la Wehrmacht commençait sérieusement à inquiéter l'Europe de la fin des années 30, Jacques Benoist-Méchin a écrit une Histoire de l'Armée allemande qui demeure aujourd'hui la meilleure étude sur la question. Je me suis efforcé de faire comprendre ce qui, dans l'histoire tumultueuse de la naissance de l'Armée rouge, pouvait déterminer sa réalité actuelle.
H. M. : On peut se demander pourquoi l'armée tsariste, le fameux « rouleau compresseur » évoqué par la presse française de 1914, n'est pas intervenue pour empêcher le triomphe de la révolution de Février 1917?
D. V. : II faut rappeler à quel point le tsar Nicolas II avait vu son prestige entamé par les conditions lamentables dans lesquelles la guerre était conduite. L'impuissance, la gabegie, la corruption régnaient partout alors que le peuple endurait, du fait de la guerre, au front comme à l'arrière, les pires souffrances. L'omnipotence scandaleuse de Raspoutine avait dressé contre la famille impériale une bonne partie de la noblesse, qui constituait naguère le soutien le plus ferme du régime. A l'intérieur même de l'Armée, et aux plus hauts échelons, il existait un complot pour contraindre le tsar à l'abdication. Il semble qu'il ait trouvé sa source, si on en croit l'historien Grégoire Aranson, dans les cercles maçonniques militaires, attachés à l'idée d'une monarchie constitutionnelle et hostiles à l'éventualité d'avoir à tirer sur le peuple. Les généraux Alexeiev et Krymov animaient ce « complot », dont la mise en œuvre fut devancée par les émeutes de Février. Un député de la Douma, Goutchkov, assura la liaison avec les militaires libéraux, et Nicolas II, non seulement ne put compter, en février 1917, sur un quelconque soutien de l'Armée, mais fut, au contraire, poussé à l'abdication. Certains des généraux impliqués dans cette affaire rejoindront d'ailleurs le camp de la contre-révolution quelques mois plus tard, effrayés par ce qu'ils avaient contribué à déclencher.
H. M. : Quel fut le rôle de Trotski dans la genèse de l'Armée rouge ?
D. V. : II fut absolument essentiel. De tous les bolcheviks, Trotski, devenu commissaire à la Guerre au printemps de 1918, était sans doute le plus intelligent de tous et le plus cultivé. Il comprit immédiatement qu'il convenait de reconstituer une véritable armée, avec ses techniciens, sa discipline, son organisation. Les officiers d'activé demeurés dans le camp bolchevik surent le persuader qu'il fallait restaurer l'ordre dans les unités pour en obtenir quoi que ce fût.
C'est lui qui imagine de redonner leur commandement aux officiers de l'ancienne armée en leur adjoignant un commissaire politique. La loyauté des cadres était garantie par le fait qu'on gardait leur famille en otage.

Pour ce qui est de la discipline dans la troupe, le leader du Soviet de Petrograd n'hésita pas, au nom de la légitimité révolutionnaire, à tenir des discours tels que celui-ci : « On ne peut dresser une armée sans répression. On ne peut mener à la mort des masses d'hommes si le commandement ne dispose pas dans son arsenal de la peine de mort. Tant que les méchants singes qui s'appellent des hommes formeront des armées et batailleront, le commandement placera les soldats dans l'éventualité d'une mort possible en avant et d'une mort certaine à l'arrière. »
Prêt à utiliser les compétences des anciens officiers, Trotski dut compter avec l'opposition du « groupe de Tsarytsine », c'est-à-dire Staline, Vorochilov et Boudienny, hommes beaucoup plus simples qui n'avaient pas l'envergure suffisante pour discuter avec les anciens cadres militaires, chose qui ne procurait, en revanche, à Trotski aucun complexe, étant donné son niveau d'éducation et de culture. Staline et les siens souhaitaient créer une armée prolétarienne où il n'y aurait pas eu de place pour les cadres de l'Ancien Régime. Les événements devaient donner entièrement raison à Trotski sur ce point. Doué d'un sens de l'organisation et d'une capacité de travail hors du commun, le tout complété par une hauteur de vues et une rapide compréhension des problèmes stratégiques, il a incontestablement été le Lazare Carnot de la Révolution soviétique.
H. M. : On a souvent évoqué le poids de l'intervention étrangère dans la guerre civile ? Qu'en fut-il réellement ?
D. V. : Son importance a été surestimée. Les Alliés ont tout d'abord sous-estimé la force du mouvement révolutionnaire qui déferlait sur la Russie. Churchill parlait de « cette répugnante singerie du bolchevisme » et tous pensaient que Lénine et les siens seraient rapidement balayés. Les puissances étrangères songèrent donc surtout à la défense de leurs propres intérêts. Les Anglais soutinrent Koltchak et les jeunes États baltes, les Français aidaient plus spécialement la Légion tchèque, les Japonais occupaient la Sibérie orientale en espérant bien s'y maintenir et, dans cet espoir, ils génèrent toute tentative de constitution d'un gouvernement blanc efficace, en apportant leur appui à l'ataman Semenov contre Koltchak.
Les Américains avaient débarqué à Vladivostok parce que les Japonais y étaient eux-mêmes et ils ne comprenaient pas grand-chose à la situation russe, soutenant indistinctement des alliés des « blancs » ou des bolcheviks au nom de l'aide humanitaire. Quand Clemenceau décida en décembre 1918 d'engager un corps expéditionnaire prélevé sur l'armée de Salonique en Ukraine, ce fut un échec total et il fallut évacuer Odessa au moment où commençaient les mutineries de la mer Noire.
C'est avec l'aide française à la Pologne que l'intervention extérieure fut vraiment efficace.
H. M. : Quels furent les échecs de l'Armée rouge ?
D. V. : L'Armée rouge dut mener trois guerres de nature différente : guerre contre les Blancs (ce qui inclut tous les opposants y compris d'extrême gauche), guerre contre les paysans et guerre contre les nationalités. A ces trois niveaux, l'Armée rouge a triomphé, c'est-à-dire a fait triompher par les armes la volonté politique du parti, sauf lorsqu’elle s'est heurtée à un nationalisme suffisamment fort. Si l'épreuve de la guerre a couronné les bolcheviks en Russie, elle leur a été fatale à trois reprises au cours de la même période, en Finlande, dans les pays baltes et en Pologne. Dans ces trois circonstances, le nationalisme affronté par l'Armée rouge s'est révélé supérieur. Cet adversaire est le seul devant lequel, tout au long de son histoire, le communisme conquérant devra reculer. La guerre civile annonce les formes nouvelles de conflits qui connaîtront tous leurs développements au cours du XXe siècle : la rupture avec la guerre de position de 1914-1918, l’intervention massive de la passion idéologique et des armes psychologiques, l'usage scientifique de la terreur, la guerre de partisans et son corollaire, la contre-guérilla... Dans tous les cas, l'Armée rouge sut faire preuve des qualités nécessaires pour s'adapter et finir par l'emporter, au prix d'une brutalité inouïe, qui était à la mesure du chaos dans lequel avait sombré le pays.

H. M. : Quelles sont, selon vous, les principales causes de l'échec des armées blanches face à un pouvoir bolchevik isolé et encore bien mal assuré ?
D. V. : II faut tout d'abord tenir compte de la division des forces contre-révolutionnaires. La Légion tchécoslovaque, patronnée par la France, apparaît hostile à l'amiral Koltchak, qu'on considère comme l'homme des Anglais. Dans le Sud, Denikine, partisan des Alliés, s'oppose à Krasnov, soutenu par l'Allemagne. Quant aux Cosaques et aux Ukrainiens, tout à leurs rêves d'autonomie et d'indépendance, ils ne peuvent s'entendre avec Denikine, qui jure de restaurer l'unité de la Russie dans ses frontières impériales de 1914. Les Blancs disposaient pourtant de sérieux atouts et leur approche entraînait souvent des révoltes chez les paysans excédés par les réquisitions bolcheviques. Mais le commandement des armées blanches était souvent médiocre, surtout pour ce qui concernait celle de Sibérie. Il y avait pléthore d'officiers attachés aux conceptions les plus conventionnelles. La corruption, le trafic des approvisionnements débarqués par les Alliés à Vladivostok étaient des plaies généralisées. Les rivalités des missions alliées aggravaient encore les choses. Le général français Rouquerol a pu parler d'ignorance du métier militaire, de manque de dévouement, de prévarication, d'abus de boisson, de manières brutales à l'égard des hommes... Certains officiers trafiquaient avec les subsistances de leurs troupes, voire avec les armes et les munitions.
Koltchak était d'une honnêteté irréprochable mais ne disposait pas de l'autorité suffisante pour mettre de l'ordre dans tout cela. Les choses allaient beaucoup mieux à l'armée de Denikine mais, une fois obtenus les succès initiaux, celui-ci va commettre une erreur fatale en divisant ses troupes quand il ordonnera la marche sur Moscou. Les troupes disponibles étaient trop peu nombreuses et ne disposaient pas de réserves organisées dans la profondeur. Avec des lignes de communication trop étirées, elles devaient également faire face aux actions des partisans bolcheviks ou des anarchistes de Makhno.
De tous les chefs blancs, Wrangel apparaît comme le plus capable ; malheureusement pour la contre-révolution, il sera trop tard quand il prendra le commandement des forces blanches du Sud.
Il ne faut pas, toutefois, se contenter d'analyser la défaite des Blancs comme le résultat d'un affrontement militaire classique, ce qu'avaient tendance à faire certains observateurs alliés. Il faut replacer cette défaite dans son contexte révolutionnaire. La Russie avait subi, depuis 1917, un cataclysme d'une dimension qu'aucune autre révolution, si radicale et si brutale fût-elle, n'avait enregistré. En quelques mois, ce n'est pas seulement l'État qui s'était effondré, mais encore la totalité du corps social. Ce fut d'abord un déchaînement spontané, provoqué par la guerre moderne et les contraintes imprévues et insupportables qu'elle imposait à la fragile société russe de 1914. La paralysie d'une machine économique saturée et d'un gouvernement incapable avait exacerbé les tensions jusqu'au déferlement qui commença de tout emporter à partir de février 1917 et culmina après octobre.
La Révolution française n'avait rien connu de semblable. Les groupes sociaux avaient été ébranlés et modifiés, sans être détruits. Après la bourrasque jacobine, les profiteurs de la Révolution feront Thermidor et susciteront Bonaparte pour mettre fin à la crise. En Russie, le cyclone révolutionnaire avait tout rasé. En quelques mois, de la fin de 1917 à l'été de 1918, tous les groupes sociaux autres que le prolétariat et la paysannerie avaient été engloutis par une sorte de séisme social, une désintégration soudaine de l'économie et une jacquerie généralisée, aggravée par les appels à la guerre sociale des commissaires du peuple et par leur brutale tentative de collectivisation.
La Russie de 1918 était devenue la « table rase » des chansons révolutionnaires. L'impossible s'était réalisé. Le corps social avait péri de mort violente. Les représentants des élites traditionnelles avaient disparu, liquidés, affamés, réduits à l'état de sous-prolétariat. Deux millions d'entre eux avaient émigré à l'étranger. Dans leurs rêves les plus extravagants, les dirigeants du Parti n'avaient jamais imaginé, tout en le souhaitant, à l'image des nihilistes du XIXe siècle, que le hasard leur ferait le présent d'un tel génocide social, d'une telle réduction de la société à son niveau le plus élémentaire. Aussi n'avaient-ils rien prévu et devaient-ils tout improviser. Dans l'été de 1918, le Parti bolchevik s'est trouvé être le seul principe organisateur et fédérateur de Russie. C'est la chance que lui offrit l'Histoire. Il devait combler le vide qu'il avait contribué à créer, et le défi de la guerre civile accéléra ce processus ; sans cette épreuve, on peut imaginer que le régime bolchevik, naviguant entre le crime et l'utopie, eût été bien incapable de constituer un pouvoir cohérent débouchant sur autre chose que l'impuissance. La moitié des bolcheviks se consacra à l'édification de l'Armée rouge et à la guerre ; le reste jeta les bases de la bureaucratie que le Parti inventa empiriquement pour remplacer le corps social disparu et fonder la nouvelle société socialiste. Les Blancs, confrontés au même problème sur leurs territoires respectifs, se révéleront incapables d'y apporter une réponse. La guerre est toujours le plus impitoyable des juges. Les mêmes épreuves, qui avaient précipité la mort de l'autocratie et des armées blanches, allaient favoriser l'édification de l'État bolchevik, prouvant ainsi par un remarquable exemple de darwinisme social, son aptitude à vivre,
H. M. : Vous privilégiez donc l'explication politique de préférence aux facteurs militaires ?
D.V. : Faute d'avoir tiré leur justification d'un État, même virtuel, les armées blanches étaient vouées à l'échec. L'Armée est une part essentielle de l'État, mais elle n'est pas l'État. La fonction souveraine contient implicitement la fonction militaire, mais l'inverse n'est pas vrai. En Russie, la fonction souveraine fut vacante de février à octobre 1917. Les bolcheviks en devinrent les dépositaires inconscients, dès lors qu'ils entreprirent d'assumer effectivement le pouvoir. Rapidement et non sans mal, la fonction militaire se reconstitua à leur profit. En revanche, jamais les armées blanches, malgré leur courage, leur patriotisme et la qualité personnelle de tel ou tel de leurs chefs, ne sont parvenues à créer un État. En dehors des Finlandais, seul Wrangel s'y efforcera en Crimée, mais il était déjà trop tard. Cette défaillance avait été clairement perçue par le maréchal Foch qui déclarait en 1919 : « Les armées n'existent pas par elles-mêmes. Il faut qu'il y ait derrière elles un gouvernement, une législation, un pays organisé. Mieux vaut avoir un gouvernement sans armée qu'une armée sans gouvernement. »
Par un extraordinaire paradoxe, sans en avoir aucune conscience, dans leur effort surhumain de guerre et d'organisation, Lénine et les bolcheviks agirent en restaurateurs de l'Etat russe. Ils le firent au nom d'une idéologie étrangère à l'État et avec des moyens odieux. Mais, sans le vouloir, sans doute sauvaient-ils ainsi la Russie d'un anéantissement et d'un partage qu'ils avaient eux-mêmes contribué à déchaîner.
Portés par une ambition contraire aux résultats, ils allaient devenir les rassembleurs de l'ancien Empire. Cela devait coûter cher au peuple russe. Le démographe soviétique Maksudov estime à vingt-sept millions et demi de victimes le bilan de l'holocauste bolchevik (en excluant, bien sûr, les pertes dues à la Seconde Guerre mondiale et en ne retenant que les morts de la guerre civile, des famines, de la dékoulakisation des années 30, du Goulag, des grands procès staliniens...)
Nous touchons ici à l'ambiguïté profonde du rôle historique assumé par le Parti bolchevik et l'Armée rouge : reconstitution de l'État et de l'Empire, et, en même temps, bourreaux du peuple russe, destructeurs de sa substance même et de sa spécificité spirituelle.
H. M. : On a souvent présenté l'Armée rouge comme l'héritière du nationalisme russe. Que pensez-vous de cette interprétation ?
D. V. : La série de hasards qui, à la fin de 1917, porta Lénine et ses partisans à la tête du plus vaste pays de la Terre eut pour conséquence de faire coïncider l'espace géographique de la révolution avec celui de la nation russe, et les bolcheviks identifièrent la défense des frontières à la révolution, dans la mesure où la guerre civile et les luttes qui les opposèrent aux Finlandais et aux Polonais constituaient des menaces périphériques. Les Occidentaux interprétèrent un peu rapidement cette ambivalence russe et soviétique comme un retour au nationalisme et à l'expansionnisme russes traditionnels. C'est ainsi que, pour le général de Gaulle, l'Union soviétique n'était que l'héritière de la « Russie ». Il est vrai que les peuples et les nations sont souvent plus durables que les religions et les idéologies importées, mais la Russie a été victime d'un véritable génocide, doublé d'une entreprise systématique de dénaturation culturelle. Lorsque Staline fit alliance en 1941 avec le nationalisme russe, c'était avec l'intention non pas de renier la révolution, mais de la sauver. Ses successeurs continuent d'entretenir l'équivoque sur la signification du mot « patrie ». La patrie qu'ils invoquent (la patrie des « travailleurs ») est purement idéologique, sans racines nationales. Mais pour mobiliser l'émotivité des masses, ils sont contraints de l'assimiler à la vraie patrie, à la patrie russe de toujours.

Beaucoup ont cru retrouver dans les Lettres du marquis de Custine une Russie qui fût l'ancêtre direct de notre actuelle U.R.S.S. Malheureusement, l'explication du soviétisme par le passé russe résiste peu à l'examen. Les Khmers rouges relèvent-ils du Cambodge éternel comme les bolcheviks de la Russie éternelle ? Il est facile d'observer que la nature du communisme au pouvoir est identique de par le monde entier. La part de l'éternelle Russie dans le système soviétique relève de ce qui n'est pas spécifique du totalitarisme. L'autorité de l'État, l'absence de procédure parlementaire, le goût du secret dans les affaires publiques ne constituent pas les traits distinctifs du régime communiste. Ce qui distingue celui-ci sans équivoque, c'est, d'une part le pouvoir totalitaire d'une idéocratie destructrice de la culture nationale ; d'autre part, l'élimination et le remplacement du corps social par une bureaucratie universelle tirant sa justification de l'idéologie. L'impossible adéquation de l'idéologie et du réel se traduit par la négation de la réalité. Les faits ont tort s'ils ne se plient pas à l'utopie.
La réalité est donc brisée par la force, ce qui entraîne le massacre de catégories sociales rebelles (paysans baptisés « koulaks » pour la circonstance, ou « bourgeois »), la liquidation des nationalités rétives, l'institution du Goulag, le traitement des opposants en asiles psychiatriques, l'asservissement de la pensée à une vérité qui est le privilège du parti assimilé à une caste sacerdotale. Rien de cela n'existait à l'époque de l'autocratie russe. Ce régime autoritaire mais nullement totalitaire laissait s'exprimer les opposants dans la presse et dans les universités pour autant qu'ils n'eussent pas manié bombes et revolvers.
Le caractère idéocratique, Alain Besançon l’a parfaitement montré, du pouvoir soviétique est un obstacle insurmontable pour une évolution en profondeur vers une « russification ». Il faudrait abolir l'idéologie, et ce serait une révolution. Sans doute ne peut-on totalement exclure une telle hypothèse et — pourquoi pas ? — à la suite d'événements exceptionnels, une révolution venue de l'intérieur même du régime ou de l'Armée. En attendant, les hommes du Kremlin ne sont pas des Russes, mais des Soviétiques.
H. M. : Le fait que l'Armée rouge soit une armée « politique » a-t-il des conséquences sur la nature de la stratégie soviétique ?
D. V. : C'est tout à fait évident. Le marxisme a exercé une influence directe sur la doctrine militaire soviétique et pas seulement au niveau des interférences politiques. La prédilection pour l'offensive traduit une mentalité sous-tendue par l'idée de lutte qui domine la vision bolchevique du monde. Marx et Engels ont cherché à asseoir l'utopie révolutionnaire et socialiste sur une œuvre scientifique et à codifier la révolution comme une guerre psychologique totale, menée contre l'ordre social existant. Ils sont ainsi parvenus, par-delà leur mort, à doter des légions d'activistes d'un sentiment subjectif de certitudes qui n'est pas étranger au résultat historique considérable de la révolution bolchevique. La pensée marxiste est avant tout une pensée stratégique, élaborée dans une intention polémique pour écraser l'adversaire, sous l'action conjuguée de la science et du prolétariat jouant un rôle de classe d'assaut. Marx et Engels ont appliqué à la réflexion politique un mode de pensée militaire. Ils sont à la source de ce trait spécifiquement soviétique d'une réflexion stratégique employée systématiquement dans le domaine politique. Les bolcheviks ont ajouté à cet héritage ce qu'ils avaient en propre : un fanatisme de secte, une tradition de la conspiration, le mépris des conventions et de la morale « bourgeoises » et une prédilection pour la violence, héritée de la tradition révolutionnaire russe du, XIXe siècle. Ils se sont forgé une vision militaire des relations internationales, qui, à leurs yeux, relèvent de la guerre. Le conflit entre le « socialisme » et le « capitalisme » peut connaître des phases de détente, mais il ne peut s'écarter de l'impératif final : « Détruire ou être détruit ». Formés à cette école, les dirigeants soviétiques sont avant tout des stratèges. Médiocres économistes, administrateurs défaillants, ils se révèlent en revanche de première force en politique étrangère, lieu privilégié de la lutte contre le capitalisme. Les satisfactions intenses qu'ils tirent de la guerre politique internationale leur font oublier leurs déboires internes.
Quand ils regardent la carte du monde, leurs vassaux plies à leurs volontés, leurs alliés et leurs otages asservis à leurs manœuvres, leurs adversaires en difficulté, quand ils contemplent l'énorme accumulation de puissance de la plus formidable armée que le monde ait jamais connue, comment n'éprouveraient-ils pas les voluptés de l'orgueil ? La puissance est une ivresse. La plus forte que l'homme ait jamais goûtée. Ils en savourent quotidiennement les délices.
Les hommes du Kremlin sont convaincus que l'avenir du monde dépend non pas du niveau de vie à Moscou ou à New York, mais de la puissance des armements. Ils ne croient pas que la force des armes compte moins que la productivité. Ils ont même tendance à penser le contraire et à vouloir compenser l'infériorité de leur économie par la supériorité de leur armée. On est tenté de suivre Raymond Aron quand il craint qu'« un pays qui préfère les canons au beurre aussi résolument doit bien, à l'occasion, encaisser les dividendes de ses énormes dépenses d'armement ».
Interview recueillie par Philippe Conrad
Sources : Histoire Magazine N°18 – 1981.
