
Une cité florissante qui était la gloire et la splendeur de l'Orient a été prise, spoliée, dévastée et complètement mise à sac par les Barbares les plus inhumains... par les bêtes sauvages les plus sanguinaires... Un grand danger menace l'Italie, sans parler des autres pays, si les violents assauts des Barbares les plus féroces ne sont pas arrêtés net... »
C'est en ces termes alarmistes que le cardinal Bessarion, ancien archevêque de Nicée, rend compte au doge de Venise de la prise de Constantinople par les Turcs, survenue le 29 mai 1453. Présents dans les Balkans depuis près d'un siècle, vainqueurs des Serbes et des Hongrois, les envahisseurs ottomans ont, en s'emparant de l'ancienne capitale byzantine, remporté un succès décisif qui prélude à la poursuite de leur expansion vers le Proche-Orient arabe et vers la Perse, mais aussi en direction de l'Occident qui restera soumis pendant plus de deux siècles à la formidable menace que feront peser sur lui les armées du « Grand Seigneur ».
Durant toute l'époque moderne, les relations entre l'Europe et l'Empire ottoman sont demeurées conflictuelles, et quand le « débat universel » opposant les Turcs « au corps entier de la chrétienté » se terminera sur la victoire des puissances européennes, la « question d'Orient » et l'agonie de « l'homme malade » viendront prendre le relais, au moment où les populations martyres des Balkans s'insurgeront, au nom du sentiment national et de la foi orthodoxe, contre un ordre fondé sur la terreur et les massacres institutionnalisés.
Durant tous ces siècles d'affrontement, l'Europe percevra le Turc comme un ennemi naturel. A la fin du XVIe siècle, Alberico Gentili explique ainsi, dans son De jure belli, que « nous avons sans cesse une raison de nous battre contre les Turcs », et la génération du romantisme philhellène s'affirmera solidaire de l'insurrection grecque, quand Byron ira mourir à Missolonghi, quand Delacroix peindra les Massacres de Chio et quand Victor Hugo réclamera pour son Enfant grec « de la poudre et des balles ».
Issus du cœur de l'Asie, les Turcs s'emparent progressivement de l'Anatolie après la victoire remportée à Mantzikert sur l'empereur grec Romain IV Diogène, en 1071. A la fin du XIIIe siècle, Erthogrul et Othman sont les fondateurs d'une lignée de chefs de guerre promise à un destin impérial et leurs successeurs imposent bientôt leur loi à toute l'Asie mineure.
Héritiers des traditions guerrières des cavaliers nomades de la steppe et devenus les nouveaux champions de l'islam sunnite, les Ottomans prennent ensuite pied en Europe, où ils s'emparent d'Andrinople dès 1364. Sept ans plus tard, Serbes, Hongrois et Valaques sont battus sur la Maritza et, en 1389, la bataille de Kosovo entraîne l'écrasement du royaume serbe. En 1396, la croisade occidentale qui se porte au secours de l'Empire byzantin est vaincue à Nicopolis par les janissaires du sultan Bayezid Yildirim (Bajazet la Foudre). Au moment où la chrétienté se trouve directement menacée par ce nouveau péril surgi de l'Orient, l'irruption en Asie mineure des hordes de Tamerlan, victorieuses des troupes ottomanes à Ancyre en 1402, lui donne un précieux sursis. Le répit est cependant de courte durée car, dès 1422, un nouvel assaut, infructueux, est lancé contre Constantinople. Au cours des années suivantes, la résistance chrétienne semble cependant s'affermir aux marges occidentales des conquêtes ottomanes, où le voïvode Jean Hunyadi parvient à préserver la Hongrie. Dans le même temps, Skanderbeg tient tête aux envahisseurs dans les montagnes d'Albanie. Les armées du sultan n'en sont pas moins victorieuses, à Varna, en 1444, des forces de Hunyadi et de Ladislas, le roi de Pologne et de Hongrie, tué au cours de la bataille.
La conquête du Péloponnèse, la mise à sac de Corinthe et la nouvelle victoire obtenue à Kosovo, contre Hunyadi cette fois, augurent mal du sort de Constantinople, finalement prise par Mehmed II le 29 mai 1453, malgré l'héroïque résistance opposée par ses défenseurs grecs, génois et vénitiens.
Devenu l'héritier de l'Etat byzantin, l'Empire ottoman peut tirer un surcroît de puissance du contrôle des Balkans, dont les populations asservies lui procureront, avec leurs enfants régulièrement razziés et islamisés, l'élite de son armée (les janissaires) et une partie de ses cadres administratifs. Disposant désormais de ressources humaines et économiques considérables, le sultan va pouvoir engager, sur le Danube et en Méditerranée, une lutte de longue haleine durant laquelle la chrétienté divisée n'unira que trop rarement ses forces. Au début du XVIe siècle, Sélim Ier Yavouz (le Terrible) tourne surtout ses efforts contre la Perse et l'Egypte pour s'assurer - après la reconnaissance de sa suzeraineté sur les villes saintes du Hedjaz - la maîtrise de tout le Proche-Orient arabe, mais son successeur, Soliman le Législateur (ou le Magnifique), reprend vigoureusement l'offensive contre l'Europe chrétienne.
Deux théâtres principaux voient alors l'affrontement opposant les Turcs aux Habsbourg d'Autriche et d'Espagne : les régions danubiennes d'une part, l'espace méditerranéen d'autre part. La victoire obtenue à Mohàcs par Soliman, en août 1526, transforme pour longtemps en terre de razzia la malheureuse Hongrie. Trois ans plus tard, les Turcs sont en mesure d'assiéger Vienne une première fois.
Au cours des décennies suivantes, le souverain Habsbourg organise tant bien que mal la défense des marges orientales de ses Etats, mais un beylicat ottoman est installé à Buda, alors que la Styrie et la Slavonie sont régulièrement dévastées et que la Carinthie est constamment menacée. Ce n'est qu'après la mort de Soliman, survenue en 1566, que le front danubien retrouve une certaine stabilité.
En Méditerranée, la prise de Constantinople et la conquête de la Syrie et de l'Egypte ont fait de l'Empire ottoman une puissance navale redoutable à laquelle se rallient les corsaires de Tripoli et d'Alger. Le sac d'Otrante, en 1480, et la prise de Rhodes, en 1522, témoignent de la volonté d'hégémonie méditerranéenne des nouveaux maîtres de l'Orient, la présence vénitienne à Chypre et en Crète n'étant que momentanément tolérée pour des raisons d'intérêt commercial.
Charles Quint s'empare de Tunis en 1535, mais échoue devant Alger six ans plus tard, ce qui permet aux pirates barbaresques d'entretenir l'insécurité sur les côtes italiennes et espagnoles alors que l'alliance conclue entre François Ier et Soliman permet aux Turcs de mettre à sac Reggio et Nice, et d'hiverner à Toulon...
En 1563, ils échouent cependant lors de leur tentative de reprendre Oran, espagnole depuis 1509, et ils doivent renoncer, deux ans plus tard, à l'issue d'un siège épique, à s'emparer de Malte. Ils prennent leur revanche en arrachant Chypre aux Vénitiens en 1570, mais, l'année suivante, le 7 octobre, la plus grande bataille navale du siècle est livrée à Lépante, près du golfe de Corinthe, et se termine sur une victoire éclatante des flottes espagnole, vénitienne et pontificale placées sous le commandement de don Juan d'Autriche.
La victoire est saluée dans toute l'Europe chrétienne, mais l'ennemi conserve Chypre et peut reprendre Tunis en 1574. Aucun des deux camps n'est alors en mesure - comme l'a bien montré Fernand Braudel dans sa Méditerranée à l'époque de Philippe II- de remporter une victoire décisive, et l'affrontement perd de son intensité au moment où l'Espagne tourne ses regards vers les Pays-Bas et donne la priorité à la lutte contre l'Angleterre, pendant que le sultan se voit contraint de faire face à l'hostilité de la Perse séfévide. La lutte reprend de plus belle au milieu du XVIIe siècle. Les Turcs entreprennent, à partir de 1645, la conquête de la Crète, mais il leur faudra près d'un quart de siècle pour réussir à s'emparer de Candia. A ce moment, une dynastie de grands vizirs d'origine albanaise, les Köprülü, réforme l'Etat ottoman afin de lui redonner sa puissance d'antan.
Les armées du sultan marchent alors de nouveau contre l'Autriche, mais, le 1er août 1664, le Lombard Raimundo Montecuccoli, qui commande une armée composée de Français et d'Impériaux, les écrase à la bataille du Raab, dite aussi du Saint-Gothard. Une victoire européenne à laquelle participent le duc Charles de Lorraine, le comte de Waldeck et le marquis de La Feuillade. C'est aussi la fine fleur de l'aristocratie française qui se porte au secours de Candia, où l'on verra tomber le duc de Beaufort et le marquis de Tavannes.
L'affrontement décisif aura lieu au cours de l'été 1683, quand les armées du grand vizir Kara Mustapha viennent mettre le siège devant Vienne, défendue par le comte Ernest de Starhemberg. Alors que la ville résiste depuis soixante jours, le duc Charles V de Lorraine et le roi de Pologne Jean Sobieski peuvent réunir leurs forces pour remporter, le 12 septembre, la victoire historique du Kahlenberg.
A partir de ce moment, la vague ottomane entame un reflux qui ne s'arrêtera plus. Buda est reprise dès 1686 et, l'année suivante, la victoire de Mohàcs arrache la Transylvanie à la domination turque. Le 11 septembre 1697, c'est le prince Eugène de Savoie qui porte le coup de grâce aux Ottomans en remportant sur les rives de la Theiss (la Tisza) la grande victoire de Zenta. Le traité de Karlowitz (janvier 1699) donne la Hongrie et la Transylvanie à l'Autriche, alors que le tsar de Russie Pierre Ier s'empare d'Azov, que Venise se voit reconnaître la possession de la Dalmatie et de la Morée, et la Pologne, celle de l'Ukraine subcarpathique.
Désireuse d'accéder à la mer Noire et d'atteindre ensuite les détroits, la Russie apparaît désormais, pour les Turcs, comme un nouvel adversaire particulièrement redoutable. En 1716 et 1717, les victoires autrichiennes de Peterwardein et de Belgrade contraignent le sultan à accepter la paix de Passarowitz, signée en 1718, qui donne à l'Autriche le Banat de Termesvar (Timisoara), la Petite Valachie occidentale et le nord de la Serbie. C'est une première étape vers la vallée de la Morava, dont le contrôle commande celui des Balkans. Les « confins militaires » organisés alors avec des paysans-soldats serbes venus combattre au service des Habsbourg dissuadent désormais toute tentative de retour offensif des Turcs.
La menace russe se précise plus au nord, tout au long du XVIIIe siècle. La mainmise des souveraines de Saint-Pétersbourg sur les côtes septentrionales de la mer Noire précède l'avance de leurs armées jusqu'à Bucarest alors que l'amiral Orlov vient, en 1770, détruire la flotte ottomane près de Chio. Les Turcs perdent la Crimée en 1783 et la tsarine Catherine peut affirmer la mission impartie à la Russie de libérer Constantinople du joug musulman.
La dégénérescence de l'Etat ottoman, demeuré incapable, faute d'un Pierre le Grand à sa tête, de s'occidentaliser et de se moderniser, va favoriser le réveil du sentiment national chez les peuples chrétiens des Balkans qui peuvent compter sur le soutien de la Russie orthodoxe. En revanche, les Anglais, qui ont supplanté les Français à Constantinople depuis la fin du XVIIIe siècle, entendent bien prolonger le plus longtemps possible l'agonie de « l'homme malade » de l'Europe afin de retarder d'autant l'irruption en Méditerranée de la puissance russe, jugée autrement redoutable.
Les révoltes serbes, entamées en 1804, aboutissent, en 1830, à la formation d'une principauté héréditaire au sein de l'Empire ottoman. C'est ensuite la Grèce qui se soulève et son insurrection symbolise la lutte pour la liberté chère à la génération romantique. Le congrès d'Epidaure proclame l'indépendance hellène, mais ses délégués ne sont pas reçus au congrès de Laybach où Castlereagh, le ministre anglais des Affaires étrangères, considère la Turquie comme un « mal nécessaire ». La poursuite de la lutte d'indépendance entraîne pourtant l'intervention des puissances et le sultan doit accepter, lors de la signature du traité d'Andrinople, de reconnaitre la souveraineté grecque et l'autonomie des principautés serbes et roumaines.
En 1833, le tsar Nicolas Ier impose à la Turquie un quasi-protectorat, mais l'Angleterre l'oblige à y renoncer en 1841. De 1854 à 1856, la guerre de Crimée est une occasion pour Londres de donner un nouveau coup d'arrêt à la poussée russe vers les détroits, mais elle aboutit aussi à la complète autonomie de la Serbie et des principautés roumaines.
L'éclatement, en 1875, delà révolte serbe de Bosnie-Herzégovine et la sanglante répression turque fournissent au tsar Alexandre II un nouveau prétexte d'intervention, mais le congrès de Berlin, réuni en 1878 à l'initiative de Disraeli, prive la Russie de la victoire qu'elle avait obtenue en 1877. Confronté aux revendications d'indépendance des peuples chrétiens des Balkans, l'Empire ottoman ne se maintient plus que par la terreur, en perpétrant les « horreurs bulgares » dénoncées par Gladstone.
C'est l'époque qui voit le « Grand Saigneur » Abdul Hamid II lâcher sur la Roumélie, l'Arménie, la Crète ou la Macédoine ses sinistres bachi-bouzouks. C'est d'ailleurs un projet anglo-russe d'imposer au sultan un contrôle européen sur la Macédoine martyre qui déclenche la révolution nationaliste « jeune turque » de juillet 1908.
Il ne reste plus alors que quelques années à l’Etat ottoman qui, à la veille de la Première Guerre mondiale, ne conserve plus que l'Asie mineure et le Proche-Orient arabe, après avoir perdu, à la faveur des conflits balkaniques de 1912-1913, ce qui restait de ses possessions à l'ouest du Bosphore et des Dardanelles où seules Andrinople et Constantinople maintiennent encore, une fois la reconquête accomplie, la fiction d'une « Turquie d'Europe ».
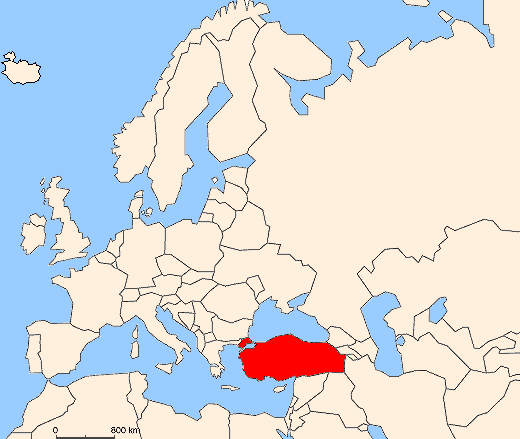
La défaite de 1918 voit le pays entamer une nouvelle phase de son histoire, marquée par l'occidentalisation forcée qu'impose Mustapha Kemal et par la liquidation ou l'écrasement de toutes les minorités - grecque, arménienne, kurde - susceptibles de mettre en cause l'identité exclusive d'une nouvelle nation turque dont la définition s'inspire du modèle jacobin.
L'envahisseur est presque complètement rejeté, mais il a laissé sa marque, que résume ainsi l'historien britannique Paul Coles : « L'absorption dans l'Empire ottoman fut à long terme une tragédie pour l'Europe du Sud-Est (...) Les peuples conquis furent prisonniers durant plusieurs siècles d'un système politique et social incapable d'évolution, dont les élites n'avaient pas d'autre idéal qu'un parasitisme empreint de violence. »
Les Européens perçurent le péril turc comme un danger mortel, comme une entreprise politique et religieuse radicalement étrangère aux sociétés, pourtant diverses, dans lesquelles ils vivaient. Alors que la chrétienté, qui demeure le cadre d'appartenance le plus évident, est déjà disloquée par l'essor de la Réforme protestante puis par la montée en puissance des grands Etats dynastiques opposés les uns aux autre dans d'interminables conflits, ce qui donne aux adversaires et aux victimes des Ottomans le sentiment d'une unité supérieure, c'est sans doute la conscience encore bien confuse d'une identité « européenne » définie par opposition à un ennemi commun.
Le roi d'Ecosse Jacques VI, le futur Jacques Ier d'Angleterre, parle ainsi de la lutte contre le Turc comme d'un « combat commun pour la cause publique », différente dans sa nature des guerres que pouvaient se livrer les princes chrétiens. Une « cause publique » qui prend progressivement le visage de l'Europe, perçue depuis l'Arioste et Le Tasse, non plus comme une simple zone géographique, mais comme un espace de civilisation particulier. Ce sont les « nations d'Europe » qu'Erasme appelle à la croisade contre les Turcs... C'est donc un combat européen réunissant Espagnols, Italiens, Allemands, Polonais, Serbes, Russes ou Français (quand François Ier ne pactisait pas avec Soliman et quand la diplomatie de Louis XV ne jouait pas la Sublime Porte contre la Russie) qui fut ainsi livré pendant plusieurs siècles à un ennemi commun clairement identifié.
Un passé qui ne plaide guère en faveur de l'adhésion de la Turquie d'aujourd'hui à l'Union européenne...

P. Conrad
Sources : Le Spectacle du Monde – novembre 2004.
