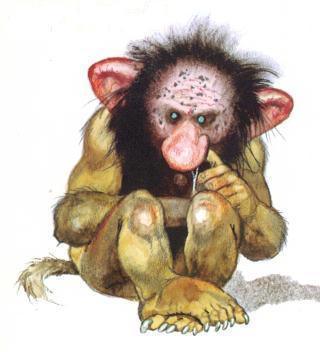Radioscopie : Jacques Isorni (1975)
- Détails
- Catégorie : HISTOIRE
Jacques Isorni s'entretenait avec Jacques Chancel (1975)
L'ÉCOLOGIE politique a-t-elle du SENS ?
- Détails
- Catégorie : ECOLOGIE
Un an après leur victoire symbolique aux municipales, les maires verts ont imposé leur ligne idéologique.
À Lyon, Rennes, Poitiers, Grenoble, Strasbourg, Tours et Bordeaux, ils ont déjà imprimé localement leur marque de fabrique idéologique à travers leurs décisions, suscitant même des scandales nationaux (TDF, Sapin de Noël, etc.).
Jacques Attali dévoile le plan macabre de dictature sanitaire plus de 40 ans à l'avance. (1979)
- Détails
- Catégorie : SOCIETE

EMISSION Parlons médecine : Où va la médecine ? Jean-Paul Escande - Catherine Dolto - Jacques Attali / 1979
Crète, le mythe du labyrinthe
- Détails
- Catégorie : ARCHEOLOGIE
La Crète fut, entre 3000 et 1400 av. J.-C., le berceau de la première grande civilisation du monde grec : les Minoens.
Premier peuple européen à maîtriser l’écriture, ceux-ci ont construit de somptueux édifices dont l’architecture complexe et monumentale n’a cessé d’interroger les archéologues. Les mythes grecs ont ainsi longtemps été exploités pour expliquer ces structures.
Des fouilles récentes dans les monuments de Cnossos, Phaistos et Sissi ont finalement abouti au décodage de ces édifices, notamment grâce à la syntaxe spatiale. Cette méthode révolutionnaire permet de déduire l’usage d’un bâtiment en analysant son accessibilité et les connexions entre les pièces qui le composent.
Le mépris des gens "d'en haut" !!!
- Détails
- Catégorie : SOCIETE

Mathias Wargon, médecin urgentiste, le mari de madame Emmanuelle Wargon la fille de Stoleru, secrétaire d'Etat du rapprochement familial, parle des français…
Le mépris des « biens pensants ».
- La véritable idéologie qui anime les Talibans
- Rushes d'une interview de Julius Evola (01-01-1971), vieilli mais alerte, quelque temps avant sa mort.
- Alexandre Douguine: « Evola, le populisme et la quatrième théorie politique ».
- La pertinence pragmatique de Dominique Venner dans la lutte contre la technocratie
- Bismarck : ce prussien mal-aimé était un visionnaire
- Est-il possible que nous n'ayons aucune sorte d'affinité avec cette nature qui nous enveloppe et nous presse? CHARLES MAURRAS
- Groenland, l'épopée viking
- Les bâtisseurs de Stonehenge - Enquêtes archéologiques
- Henri de Man et la liquidation de l’homme actuel
- Earthshine - My Bones Shall Rest upon the Mountain (Full Album Premiere)
Page 653 sur 859