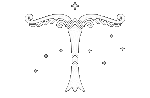Les chrétiens dans Al Andalus par Rafael Sanchez Saus
- Détails
- Catégorie : Islam
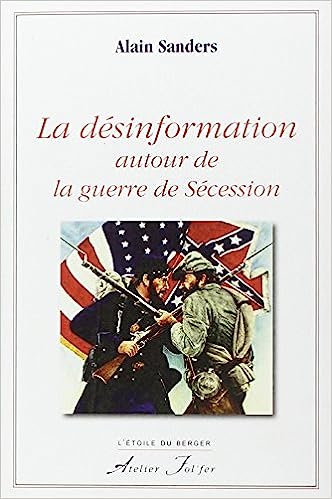
Rafael Sanchez Saus est professeur d’histoire médiévale à l’université de Cadiz. Auteur d’une douzaine d’ouvrages, il est considéré comme l’un des meilleurs spécialistes de la frontière entre Maures et chrétiens dans l’Espagne médiévale. Il a été doyen de la faculté de philosophie et de lettres de l’UCA (1999-2004) et recteur de l’université San Pablo CEU de Madrid (2009-2011). Il est toujours membre de l’Académie royale hispano-américaine des sciences, des arts et des lettres après en avoir été le directeur. Avec ce nouvel ouvrage, sous-titré De la soumission à l’anéantissement (Éditions du Rocher), Sanchez nous présente une vision complète de la situation de ces chrétiens espagnols, appelés mozarabes, unique peuple européen médiéval à avoir vécu pendant tant de générations sous la rigueur de la dhimma.
Lire la suite : Les chrétiens dans Al Andalus par Rafael Sanchez Saus
Les relations raciales dans le Vieux Sud par Alain SANDERS
- Détails
- Catégorie : Décryptage
L’immense majorité des Sudistes blancs n’avait pas d’esclaves. Mais l’immense majorité des Sudistes blancs vivaient au quotidien avec des Sudistes noirs. Comme le dira un professeur afro-américain de Baton Rouge, Louisiane, le docteur d’université L.L. Haynes : « Johnny Reb n’était pas seulement un Blanc, c’était aussi un Noir. Les femmes sudistes – noires et blanches – encouragèrent leurs maris à se battre. »
Lire la suite : Les relations raciales dans le Vieux Sud par Alain SANDERS
CALLAC (22), FACE AU GRAND REMPLACEMENT : LA RÉSISTANCE S'ORGANISE !
- Détails
- Catégorie : IMMIGRATION

Pour le bien de la cause. Une exhortation à la lutte pour une civilisation multipolaire - In memoriam de Darya Dugina
- Détails
- Catégorie : POLITIQUE

Pour le bien de la cause. Une exhortation à la lutte pour une civilisation multipolaire
In memoriam de Darya Dugina
« Cette guerre spirituelle contre le monde postmoderne me donne la force de vivre. Je sais que je lutte contre l'hégémonie du mal pour la vérité de la Tradition éternelle ». Darya Dugina
Oskar Lafontaine demande que l'Europe se détache des États-Unis
- Détails
- Catégorie : GEOPOLITIQUE

Les dirigeants politiques de la coalition « Ampel » sont de « fidèles vassaux des États-Unis » !
Oskar Lafontaine a tenu des propos clairs dans une tribune publiée dans le Berliner Zeitung. L'ancien politicien de la SPD et de Die Linke y attire l'attention sur les dessous du conflit ukrainien, et plus précisément sur « l'image que les Etats-Unis ont d'eux-mêmes, à savoir qu'ils sont une nation élue qui prétend être et rester la seule puissance mondiale ».
Lire la suite : Oskar Lafontaine demande que l'Europe se détache des États-Unis
La novlangue économique au travail
- Détails
- Catégorie : SOCIETE

Dernièrement, il y a eu cinq cas d'utilisation de la novlangue dans le plan économique qui méritent d'être analysés, car pour le lecteur de la presse mainstream, les mots le trompent, ils relèvent de la novlangue.
De plus, celle-ci a atteint un point extrême où les mots dissimulent de terribles plans, un contrôle et une domination des masses impensables il y a seulement quelques années.
- La bataille de Vienne du 12 septembre 1683
- Pio Moa (Les mythes de la guerre d’Espagne) : « Il y a une grande différence entre traiter un historien de menteur et prouver qu’il ment » [Interview exclusive]
- Qui possède les terres à blé ukrainiennes : Cargill, Dupont, Monsanto. Et derrière : Vanguard, Blackrock, Blackstone
- Un modeste hommage à Jack Marchal par Gabriele Adinolfi
- Retour sur un été incandescent par Georges FELTIN-TRACOL
- Le monde idéal d'Attali et des mondialistes...
- Brevets américains pour les technologies de manipulation et contrôle de l’esprit
- Décès de François-Bernard Huygue
- Manif de le résistance, le 17 09 2022.
- Bulletin N°98. Offensive sur Kherson, pseudo-dissidents, crise énergétique. 05.09.2022.
Page 631 sur 1017