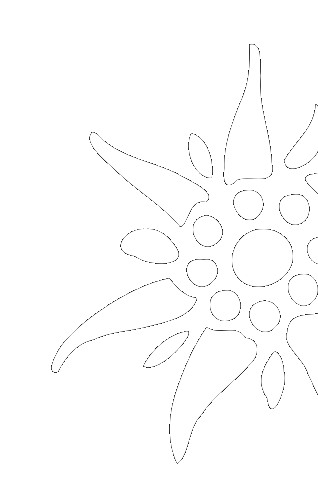Poutine a tiré dans la tête du « roi dollar »
- Détails
- Catégorie : ECONOMIE

L’investisseur américain Lawrence Lepard estime que l’invasion russe de l’Ukraine provoquera un séisme monétaire.
Ce qui s’est passé dans le système financier international au cours des deux dernières semaines est d’une importance exceptionnelle pour le reste de ce siècle et n’est pas encore totalement compris par les investisseurs. C’est l’avis donné par l’investisseur américain expérimenté Lawrence Lepard dans une interview accordée à ZeroHedge.
L’invasion de l’Ukraine par la Russie, les sanctions occidentales et le gel des avoirs équivalent à un véritable « séisme monétaire », estime-t-il. Le seul événement historique comparable à celui-ci serait la mise en œuvre du deuxième système de Bretton Woods, lorsque le président américain Nixon a retiré le dollar de l’étalon-or en 1971.
Lire la suite : Poutine a tiré dans la tête du « roi dollar »
"L'école d'aujourd'hui" (vidéo humour)
- Détails
- Catégorie : SOCIETE
L’Éclipse du sacré - Alain de Benoist et Thomas Molnar
- Détails
- Catégorie : Boutique enracinée
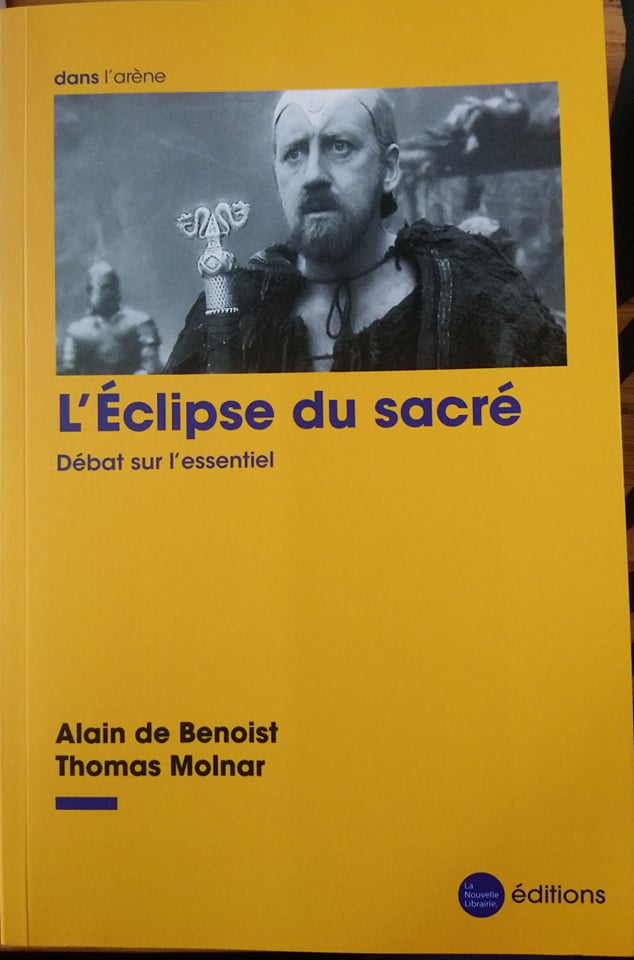
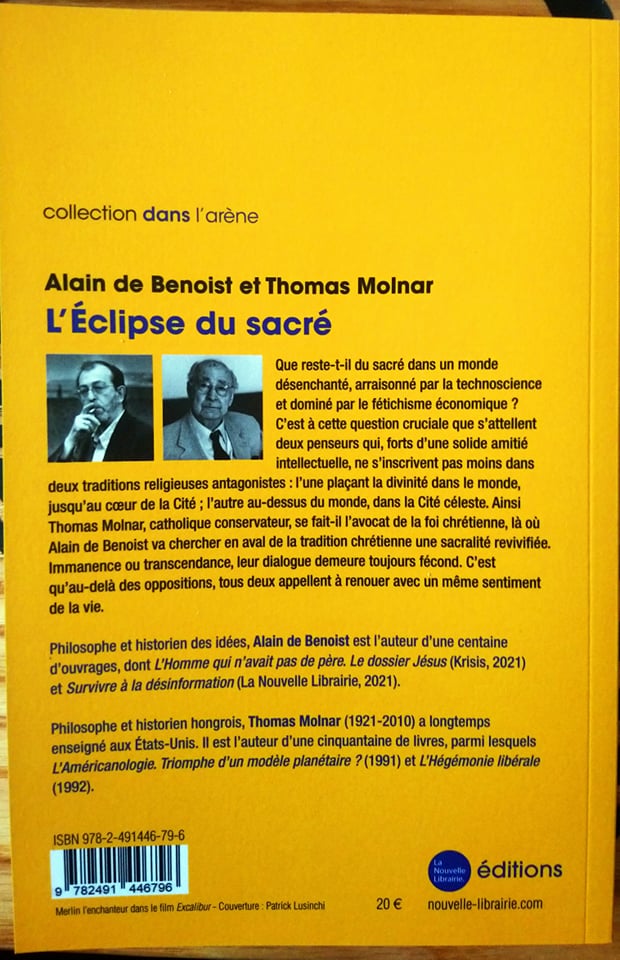
26,50 euros frais de port compris en suivi pour la France, sous enveloppe bulle. Paiement par PayPal ou virement bancaire.
Nous contacter par messagerie
sur Facebook : https://www.facebook.com/boutiqueenracinee/
L’Ukraine fait un massacre de civils à Donetsk (âmes sensibles s'abstenir.....)
- Détails
- Catégorie : ACTUALITE

Ce matin l’Ukraine a lancé un missile sur le centre ville de Donetsk, visant donc directement la population civile. Heureusement le système de défense Russe l’a intercepté mais les débris qui ont chuté en pleine ville ont fait 20 morts; tous civils: Vieillards, femmes et enfants. Sans l’interception et la destruction en vol, tout aurait été dévasté sur un rayon de 500 mètres autour du point d’impact.
Cette frappe a été ordonnée par le commandement ukrainien « en réponse » à la destruction hier par les forces russes de la base d’entrainement des mercenaires étrangers, et on note la différence: Les ukrainiens bombardent le centre ville, la Russie bombarde les bases militaires.
Lire la suite : L’Ukraine fait un massacre de civils à Donetsk (âmes sensibles s'abstenir.....)
Guerre de désinformation, de droite et de gauche, au service de l'OTAN
- Détails
- Catégorie : Décryptage

On entend souvent aujourd'hui des théoriciens de la guerre expliquer que la confrontation cinétique, comme on appelle les affrontements armés dans le jargon militaire, n'est que le dernier maillon d'une chaîne constituée d'actions de différents ordres allant du culturel au psychologique, en passant par l'économique ou le technologique.
Le concept de base est que la préparation d'une guerre implique l'affaiblissement préalable de l'ennemi. L'Art suprême de la guerre consiste à soumettre l'ennemi sans combattre, comme l'a déjà dit Sun Tzu au 6e siècle avant J.-C., et deux millénaires et demi plus tard, c'est toujours le cas.
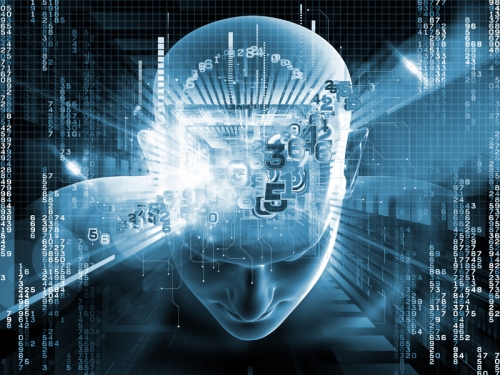
Lire la suite : Guerre de désinformation, de droite et de gauche, au service de l'OTAN
Lorsque les Russes ont conquis la mer Noire
- Détails
- Catégorie : HISTOIRE

L'épopée du napolitain Don Giuseppe de Ribas y Boyonsin parmi les protagonistes des guerres avec les Turcs

Conquête de la forteresse d'Izmail par les troupes russes en décembre 1790 (huile de Mikhail Grachev,1953 - Musée naval de Saint-Pétersbourg)
Dans leur attaque contre l'Ukraine, les troupes russes concentrent une partie importante de leurs forces sur le front sud. C'est la zone où, selon de nombreux observateurs, se déroulent les batailles les plus sanglantes. En outre, la bande de terre qui fait face à la mer Noire est d'une valeur stratégique extraordinaire pour les deux parties. Pour les Ukrainiens, elle constitue le seul débouché sur la mer ; tandis que pour les Russes, elle représente la possibilité de réaffirmer l'hégémonie exercée sur la mer Noire depuis plus de deux siècles.
Brève analyse de la politique étrangère américaine
- Détails
- Catégorie : GEOPOLITIQUE

« Mais je soutiens que les crimes commis par les États-Unis durant cette même période [depuis 1945] n’ont été que superficiellement rapportés, encore moins documentés, encore moins reconnus, encore moins identifiés à des crimes tout courts. » Harold Pinter, Prix Nobel de la paix 2005
Lire la suite : Brève analyse de la politique étrangère américaine
L'Effet C'Est Moi - Templum Victoria
- Détails
- Catégorie : Chants et Chansons
- Le mythe de Thulé dans la littérature européenne – Émile Hinnerk
- Le numéro 59 de Synthèse Nationale est paru !
- Tolstoï, Tchaikovski…Cancel culture sur l’art russe !
- UKRAINE : la FAUTE de l'OCCIDENT ? avec Hervé Juvin
- Eugène Krampon a lu : AFGHANISTAN - LES VICTOIRES OUBLIEES DE L’ARMEE ROUGE Par Mériadec RAFFRAY
- 5 démentis sur l’utilité des éoliennes en mer ou sur terre
- Les Gaulois assis: un mystère archéologique (documentaire)
- Les soldats de la RPD et de l'armée russe évacuent les civils de Marioupol - 10 mars 2022
- Bulletin N°72. Mâchoire russe, sanctions et contre-sanctions, sauvons le lycée français!13.03.2022.
- Ukraine: 11 03 2022, le ministère russe de la Défense présente les documents trouvés...
Page 679 sur 992